Pr. Arts & Design, Université de Toulouse - UR LARA-SEPPIA, Plateforme d’innovation Couleur Matière Design – PI-CDM, Institut Supérieur Couleur Image Design – ISCID.
Abstract
Ce texte se présente sous la forme d’une pensée en pleine déambulation. Chaque partie a été rédigé sur impression, c’est-à-dire par le biais des marques indélébiles que laisse la question de l’ultime, en la personne qui écrit. L’ultime imprime la mémoire et le corps de l’écriture car ici, les propos sont nés d’une expérience personnelle, la mort d’un proche.
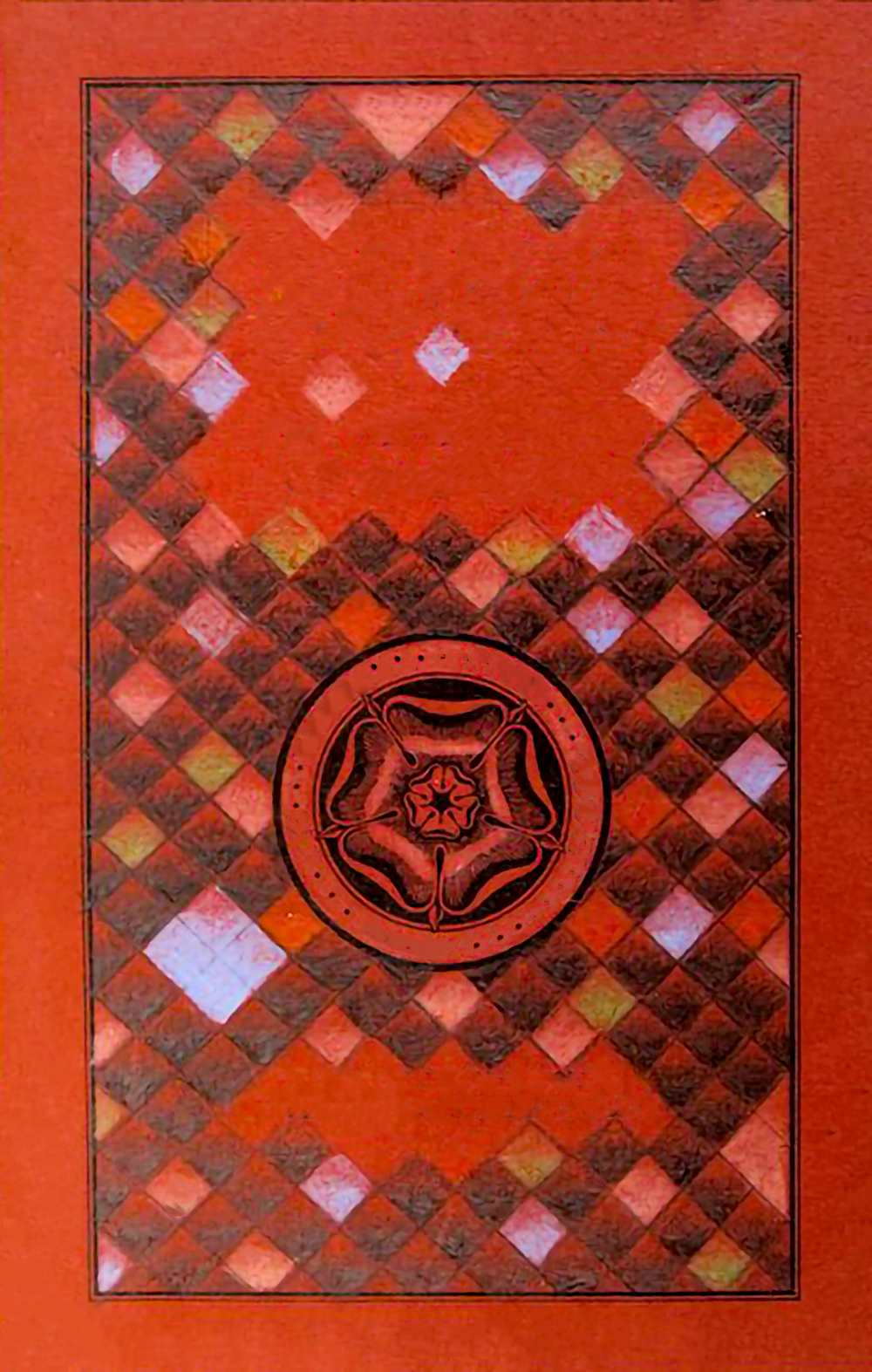
PAR–B–01911–JG: Bertram Park, Roses, The National Rose Society, 1963. Les biblio-graffitis de Roy Gold (1918-2008), artiste outsider de sa collection de livres. Par Nicholas Jeeves (designer, écrivain et professeur à l'école d'art de Cambridge), in D. Graham Burnett éditeur de la série Conjectures, Revue du domaine public (Mai, 2018).
Introduction
« N’y va pas, Sophie est partie » Kostas B., mai 2023.
Ce texte se présente sous la forme d’une pensée en pleine déambulation. Chaque partie a été rédigé sur impression, c’est-à-dire par le biais des marques indélébiles que laisse la question de l’ultime, en la personne qui écrit. L’ultime imprime la mémoire et le corps de l’écriture car ici, les propos sont nés d’une expérience personnelle, la mort d’un proche. Dans cet espace-temps qui a consisté à « accompagner » une fin de vie, le sujet de la couleur est devenu l’objet central de l’investigation. La couleur et plus justement les couleurs, les colorations et les coloris, forment des vecteurs ultimes et visibles du vivant tout autant que des marqueurs post-mortem du corps défunt et du corps survivant. Impressions est donc employé au pluriel car les empreintes que laisse l’ultime sur le mort et le vivant font réflexions. Ce qui fait plus précisément sujet de réflexion est ce qui se reflète dans, et par le temps et l’espace qui enferment l’ultimité de la vie et de ses formes chromatiques. Des états, des affects, des doutes, des interrogations, des éclats de phénomènes, des formes variées de dissolution… Non pas qu’il faille écrire ce texte pour faire gagner la mort sur la vie ou l’inverse, mais plus justement pour poétiser, par le biais du chromatique, cette fin de présence avec un peu de douceur. Une douceur non palliative [1]. Une douceur à l’arrière-goût sublime [2], peut-être.
Par définition, l’ultime se place « à l’endroit le plus éloigné qu’il soit possible d’atteindre, un point au-delà duquel il n’y a plus rien » [3]. Néanmoins, parle-t-on vraiment d’espace, parle-t-on réellement de point ? L’ultime renseigne sur « ce qui se produit juste avant une issue irrémédiable, à l’ultime moment, à l’ultime seconde »[*]. Mais se situe-t-on réellement dans le temps, ou au-delà du temps ? Une autre idée note l’ultime « à la fin d’un processus et qui le clôture définitivement »[*], en le liant à une « question de série, de série progressive qui clôt une démonstration, un raisonnement »[*]. Comment raisonner l’ultime dans une perspective poïétique et chromatique du funeste ou du funèbre ?
L’ultime n’est peut-être pas une fin comme l’indiquent les précédentes entrées définitionnelles mais possiblement, déjà un revenant. L’ultime se reproduit à chaque fin et ni l’accompagnant ni l’agonisant ne peuvent en parler vraiment puisque c’est le « seul événement dont nous ne pourrons faire l’expérience individuellement » [4]. Il n’est donc finalement pas question d’expérience ni de théorisation dans ce texte, mais bien d’imagination prospective comme le suggère Paul Ricoeur dans ses réflexions sur l’avoir-à-mourir [5]. L’ultime naît toujours après coup finalement, c’est-à-dire après l’imaginé puisqu’il n’est irrémédiablement préhensible que lorsque celui qui imagine est mort. Dans ce sens, seuls les fantômes peuvent se souvenir de la mort. Irréversibilité, potentiel ou réversibilité, l’ultime ne pourrait être envisagé par les vivants qu’à travers une suite d’impressions sur, et par les derniers lieux imaginés, les derniers jours rêvés de l’histoire, le(s) prochain(s) état(s) d’une vie autre, comme des notes de bas de page qui nous guident et qui importent…
En tant que vivant, survivant ponctuel, la mémoire guérit l’imaginaire car elle permet le souvenir sans artificialité tandis que la mort se fait l’artifice qui farde et cache ce qui ne se saura jamais, ce qui ne saura jamais être raconté. Or raconter est important. Et pour se faire, il faut écouter les histoires.
« On ne se débarrasse pas des morts, on n’en a jamais fini avec eux » [6].
I. Remarques sur les temporalités de l’ultime
Temporalité n°1 : L’amont
Ressentir la dissolution de l’apparence et garder la beauté des couleurs
Ils sont nombreux les mourants dans une salle d’attente spécialisée. Ce qui fait la différence entre ces êtres qui attendent l’ultime passage devant le juge de la croyance médicale, et un humain bien-portant mais au processus encore incertain, n’est peut-être qu’une question d’apparence. L’existence, dans une salle d’attente de cancéreux, c’est l’apparence des autres. Toutes et tous sont apprêtés pour le moment. Tous et toutes repoussent l’impensable dissolution qui s’affiche, sans faiblesse, derrière les masques anti-virus.
Les humains condamnés par la maladie pressante sont colorés ; certains plus que d’autres. D’un plumage chamarré et parfois sans un poil au caillou, les dénudés capillaires paraissent les plus magnifiques car leur crâne est encore luisant et frais, en bonne santé. Mais même avec un masque comme apparat, on perd réellement de sa beauté lorsque l’on se rend vers le point ultime, à tous les âges. Plus justement, la beauté relève de nouveaux codes esthétiques que ceux imposés par les médias de notre quotidien culturalisé [7]. Les premières minutes passées prêts de ces condamnés sont les plus belles et les font plus beaux. Après un certain temps de scrutation, les visages changent. Celui de l’élu, au plus proche de l’image ultime car libéré des traitements chimiques qui maintenant ne peuvent plus l’aider est, me semble-t-il, le plus rayonnant de la pièce. Dans cette salle d’attente, la beauté est là car, physiquement et psychiquement, la beauté relève du don. Dans l’entreprise de la mort certaine, dans les doutes des moments ultimes, la pureté et la patience deviennent des vertus qui modifient le regard et qui participent à des formes de beauté. Au milieu des malades, le sain bien-portant prend conscience que l’être est devenir-autre et que les mimiques des condamnés sont sentiments singuliers. Dans ce temps de l’avant rendez-vous médical faisant office de chronomètre de la vie, le regard s’attarde sur les mourants tout autant que sur la prospection de leurs temps finissant. Chacun sait bien qu’animé par la lenteur de l’impassable, de l’éternité infaisable, personne ne guérira vraiment. Alors, ici et maintenant, il est utile de profiter de ce qu’il reste et de ce qui relève du beau, du vivant, en ce moment précis, sur les visages et par les apparences.
Le passé, l’actuel et le futur des présents se devinent. En examinant comme le ferait un anthropologue les futures victimes, le regard du sain se demande laquelle ou lequel d’entre-nous partira le premier. La mesure réalisée par l’oeil s’évalue craintivement. La vision analyse celle ou celui qui semble le plus mourant, au bord du précipice, ultime représentation publiqueavant le grand saut. Mais cette projection vers la mort certaine, vers l’ultime apparence de notre corps physique et de notre psychisme ne peut, dans cette salle d’attente, être vraiment réelle. Ce qui chutera ultimement, in-fine, est un double ombré et irréel. Pourtant, nous sommes toutes et tous ici pour le rendez-vous. En cela, la beauté est à craindre. Et craindre c’est beau car cela oblige l’être à profiter du temps présent avant que n’apparaisse dans le dernier tournant, la jumelle mourante ou le jumeau mourant, notre double. En baissant la résistance dans ce lieu composé de numéros pour le secrétariat et les médecins de l’hôpital, numéros qui une fois affichés sur l’écran led au centre de la pièce donneront le go de la rencontre avec le Dieu médical, on se prend à se dire que tout est maintenant magnifique, que tout est accompli, que cette « expérience de beauté rappelle un paradis perdu et appelle un paradis promis » [8] , plus besoin de courir à la recherche du temps, d’un temps perdu [9], c’est trop tard !
L’ultime de la mort est-elle une dissolution crûment authentique de la beauté ? La simplicité du beau est peut-être la plus pure et la plus belle des sensations d’une vie qui ne renonce pas à elle-même et d’une mort qui ne sera jamais là.
Il, elle, je, nous, sommes condamnés[10] quoi qu’il arrive.
« J’ai compris que la mort était de nouveau dans mon avenir, à l’horizon du futur » [11].
Temporalité n°2 : Pendant
La dissolution comme héritage et la naissance du coloris
L’agonisant est aussi parfois, consciemment, parmi nous. Lorsqu’apparaissent ses grands yeux bleus et que sa bouche s’entrouvre, il s’exprime. Comme un tisserand de famille, il projette toujours et brode encore du vivant en croisant les fils de ses souvenirs, de ses ancêtres tout comme de ses contemporains. Il colore la trame d’un canevas familial qui dessine le début bien entamé d’une fin, ultimes souvenirs, ultimes songes. Mais ce n’est pas la dissolution de sa lignée.
Quand une personne commence à mourir, elle laisse déjà derrière elle un certain passé, une certaine mémoire des autres défunts auxquels elle a survécu. Si elle n’a pas d’enfant, pas de famille, elle part avec toute une tapisserie de souvenirs et de savoirs qu’elle n’a pas pu transmettre. Dans cet artisanat du peu, dans ce travail minutieux des aiguilles qui font l’ouvrage familial et le blason, les tissages opérés générations après générations peuvent devenir des fumées. Ils se consument au rythme du souffle qui s’échappe du dernier corpsmourant de la filiation. L’ultime héritier représente l’arbre de la descendance qui savait le passé et qui, peut-être, ne l’aura jamais transmis au futur. Être la plus vieille ou la plus jeune des branches… La dissolution de la vie fait apparaître spontanément le coloris ultime qui comprend le tout d’un passé. Le passé n’a pas de longueur, pas de durée, il devient instant. On peut éteindre plus ou moins rapidement une lignée. Cela peut se faire en une micro seconde lorsqu’une famille entière est emportée. Cela peut se produire sur plusieurs siècles, sur quelques générations, sur une seule, au même endroit géographique où dans le monde entier. Le tableau qui représente cette étape ultime de l’anéantissement familial impressionne et imprime la généalogie dans le néant du temps qui se peint maintenant sans étendue, sans dimension. L’ultime vivant sedésagrège. Sans suite, sans progéniture, sans héritier, la dernière dissolution engendre l’éparpillement mémoriel dans l’invisible nébuleux ; plus de disegno, place au colorito brouillé des souvenirs. Mais le nom de famille d’un mourant ne disparaît pas si vite de nos jours. Par la faveur puissante et moderne de l’administration, du courrier et des réseaux sociaux [12], la trace perdure quelques temps. Grâce à la puissance de la vie, un enfant peut aussi naître pour venir fleurir le grand chêne qui représente certaines familles.
Le temps des familles relève d’une durée comme la symbolique portée par un arbre. Il y a bien des manières d’aimer sa famille. Il y a bien des manières d’aimer plus surement les arbres et de s’y reconnaître en eux. Ce n’est alors plus un végétal résineux qui fait identité ici mais une immersion dans ses feuilles, ses racines, son tronc expérimenté, ses tonalités fusionnées dans un ensemble bientôt gelé. Le coloris de l’ultime est aussi naturel que les coloris des arbres finalement. Le coloris de l’ultime est autant poétisé par l’humain qu’irrémédiablement magique. Le chêne est un arbre magique et emblématique pour de nombreuses familles.
Dans l’histoire symbolique, le chêne est ch-, « charges lourdes et portées par la robustesse ». Le chêne, tout comme le mourant, portent des charges lourdes qui les rendent dignes de confiance -surtout si cela est réalisé sans plainte-. Leur persistance, leur volonté et leur obstination qui mènent inexorablement à l’épuisement ultime apprennent l’endurance. L’homme et l’arbre endurent toute leur vie. L’homme et l’arbre résistent avec vigueur, courage ou folie, avant d’acquiescer. Il faut soixante à quatre-vingts ans au Chasne, à l’Arbré, au Châgne, au Cassé, synonymes de ce chêne de nos forêts européennes à feuilles caduques, pour produire ses premières fleurs. À cet âge, il est dit noueux car émérite des nombreuses vicissitudes qui expriment les étreintes d’une vie toujours courbe, jamais droite. Des vicissitudes qui, comme pour l’humain, manifestent tout aussi surement les marques et les empreintes laissées dans le corps et l’esprit de sa sève par les différents vampires croisés qui lui permettent sa grande vitalité.
Mais la délicatesse du fleurissement en pleine dissolution serait-elle le point ultime pour le Chasne ? Quand arrive ses grands yeux bleus et que sa bouche s’entrouvre, c’est pour nous dire que dans l’ultime instant qui dissout le grand tout, nous sommes toutes et tous les enfants d’un chêne. Morbidezza [13].
« Comment conserver quelque chose de la temporalité vécue (passé, présent, futur), mais comme ‘‘schème de l’éternité’’ ? C’est la dimension temporelle du fondamental» [14].
Temporalité n°3 : En-cours
Les états polychromes de la dissolution et le deuil des cinq éléments
Jason de Caires Taylor[15] est un sculpteur anglais célèbre pour ses sculptures de figures humaines plongées dans la mer et vouées à devenir l’habitat de la faune et la flore sous-marine. Ces récifs artificiels grisés mettent en valeur les processus écologiques, le temps qui passe, le blanchiment, le verdissement, le bleuissement. Dans cette polychromie de l’usure et de la dissolution, de la décomposition, de la prolifération de la nature autour, et sur les corps en pierre créés par l’artiste, l’éclat de l’aura [16] des personnages immergés racontent notre quotidien d’humains et de nos processus vitaux. Réversibilité de l’ultime, des femmes et des hommes marchent sous l’eau, afférés à la vitesse des sociétés modernes ; des migrants échoués dans les profondeurs azuréennes évoquent le « radeau de la méduse ». Toutes et tous sont à l’échelle réelle, grandeur nature. Les personnages en attente, espérant, se languissant, regardant l’infini profondeur ou l’infini au-dessus. Jason Taylor aime à parler d’un rapport positif et symbiotique de l’homme à la nature. Il observe comment l’objet change avec son environnement, comment la couleur naît et disparaît dans cette mort douce. L’eau salée, dans le temps, modifie l’apparence de ses sculptures. « J’aime la beauté de ce qui se transforme, fane et se délabre, nous dit l’artiste. Les éponges ou les madrépores qui se fixent sur mes statues leur font comme un réseau sanguin, des cheveux, une chair, leur insufflent une vie qu’elles n’auraient jamais eue ailleurs. Tant mieux s’ils finissent par tout recouvrir ! ». La nature revient à la nature…
L’eau difracte la lumière, ses mouvements déforment les visions de l’ultime et les corps ; elle amplifie comme une loupe. La loupe grossi la vitesse de la vie et finalement, la mort sans point ultime, chemine, parle et touche. Le microbiote marin de James de Caires Taylor tire la décomposition vers la putréfaction poétique. Comme sur un cadavre allongé dans le cercueil de sa sépulture urbaine, les sculptures aquatiques présentent des taches vertes au niveau de leurs estomacs. Comme sur un cadavre, les lividités (livor mortis) des premières heures exposent des traces violacées par la stagnation, par la température abaissée pour se confondre au milieu ambiant. Comme tous cadavres, les organes vivent ensemble et meurent séparément, à des vitesses et des intensités différentes. Comme pour l’humain, la circulation sanguine de la pierre, la respiration et la régulation thermique de l’anatomie sculpturale dysfonctionnent ; la rigidité (rigor mortis) fige les muscles, congèle la mâchoire, solidifie les régions corporelles en passant par toutes les chromaticités. Au fond de l’eau, la catastrophe ultime se rejoue chaque matin car la température diminue dans une multitude de colorations d’une ultime vivacité, à l’image que nous avions du corps de l’être de chair, vivant. Mais qu’il s’agisse du proche ou de ces magistrales sculptures, il n’est ici représenté, finalement, que le passage naturel et temporel des vestiges de notre ère et de nos vies [17]. La mort est doucement, douce, sensorielle et poétique. Elle se colore et colorise nos imaginaires et notre droit d’embellir un processus ultime non maîtrisable.
Le bruit humide s’est intensifié, le corps s’est mis à râler. Le son est aquatique. L’atmosphère l’est aussi. Dehors, le silence et l’air légèrement frais calment, apaisent. La terre semble humide. Au loin résonne l’orage. Le ciel de l’horizon s’illumine de rouge strident. Le feu est-il loin ?
Lorsque se termine la vie sur terre, la démonstration de la dissolution ne cessera de se poursuivre par-delà les éléments, à jamais.
« C’est la mort de demain, au futur antérieur en quelque sorte, que j’imagine » [18] .
Transition entre le temps et l’espace
Les feuilles rouges
« Penche-toi, penche-toi encore, celui qui meurt a perdu son harmonie, n’est-ce pas ? Il a perdu ce qui accordait son corps à son âme. Apprends à aimer les fleurs qui poussent seules, semées par une main invisible. Le pollen qui s’élève, les fleurs en bouquets, l’écume portent le dieu diffus, évaporé, comme des bulles éclatées, laissant derrière lui autre chose que tu ne comprends pas. Alors seulement, cette femme qui va fermer les yeux ne mourra pas. (…) Tu seras, comme elle, réduit à cette feuille ou cette porte entrouverte sur le petit jardin » [19].
En Chine, de nombreuses villes se défendent de passer à la saison de l’automne en premier. Cette primauté de passage est l’occasion d’une fête. Dans le Sichuan, certaines cités connaissent même leur « festival des feuilles rouges ». Le rougissement de la peau du monde naturel évoque la transition, et la carnation des feuilles qui commencent à s’échapper de la vie par le rouge appellent la question du changement d’état. Les feuilles vertes rougissent avant de mourir en brun. En cette période précise, le rouge de la nature chinoise symbolise la couleur du solstice, situé entre la 18eme et la 19eme saison du calendrier lunaire, lunaisons. L’action de transition qui s’opère se remarque dans, et par la nature ; mais finalement, les feuilles de l’homme appartiennent de manière similaire à une forme cyclique, une forme équilibrée par des intervalles temporels et saisonniers. Du vert au rouge, du jaunissant au rougissant, des rouges à l’absence de couleur, on revient chaque année en Chine à cet événement transitionnel et festif, au point que la ville finira bientôt par se nommer « Wushan la rouge ». Sur les flancs de la montagne Wushan [20], au bord du fleuve Yangtze, l’activité engendrée par le rougeoiement des arbres tout au long du fleuve bleu, qui lui-même devient jaune au fil de son chemin, est, pour beaucoup d’habitants et de touristes, un festival mélodique, c’est-à-dire chromatique. La chromatique est, selon le Trésor de la Langue Française, un terme féminin appartenant au domaine de la musique, qui évoque « l’air qui (se) joue avec son milieu ». L’air se remplit de tonalités pour concevoir une création musicale harmonieuse. La chromatique engendre l’harmonie. Or l’harmonie appartient au vocabulaire de la couleur tout comme à celui de la mélodie. Le point d’accroche pour concevoir cette euphonie sont la temporalité et la spatialité. Le temps qui passe concourt à un même effet d’ensemble, in situ. Cet effet est de l’ordre de l’unité et de l’organisation. Être en harmonie avec, convenir à, correspondre à une logique organisée, s’harmoniser avec l’environnement. Les rapports entre les parties d’un tout enchaîne des sons et des couleurs dont le résultat est agréable à la vue et aux sens. La régularité du festival des feuilles rouges instaure une logique naturelle, temporelle et spatiale. La peau du corps humain joue, elle-aussi, avec son milieu et son cycle. En cela, regarder la mort s’approcher doucement revient à regarder les feuilles de nos arbres environnants se métamorphoser pour disparaître ensuite. Il y a une logique des états de la nature tout autant que des états de l’humain, peut-être de l’humanité.
Chaque saison et chaque couleur portent des bonheurs et des maladies nous disait la médecine d’autrefois. Plus de doute, dans le nord du pays du levant, l’hiver est bien là. Mais plus au sud, dans la région de Wushan, c’est encore l’automne. A l’instar de l’été indien au Canada, les feuilles rouges sont, en Chine, des présages d’avenir prospère. La précision et la constance du rouge permet d’évaluer le présent et le futur. L’harmonie de la couleur entre en symétrie avec le temps. Le rouge annonce la fin et le début de quelque chose. Une correspondance s’opère dans cette logique, dans l’unité du paysage et des coutumes des habitants. Chacun sait, à ce moment précis, que le balancement entre un état et un autre n’est plus coïncidence, mais logique. Tous acceptent aussi que cette logique soit cohérence et relève d’une conséquence de la vie naturelle tout autant que de la durée humaine de la vie. Dans ce festival des rouges, des rouges sombres aux rouges clairs, des rouges verdis aux rouges brunis, des rouges encore jaunes, le paysage et l’ambiance urbaine sont d’une beauté innommable. L’académicien François Cheng note que « si nous revenons au thème de la beauté, nous pouvons dire que dans la durée qui habite une conscience, la beauté attire la beauté, en ce sens qu’une expérience de beauté rappelle d’autres expériences de beauté précédemment vécues, et dans le même temps, appelle aussi d’autres expériences de beauté à venir » [21].
Le cycle de la nature recherche constamment l’harmonie en toutes saisons tandis que la vie humaine court toujours après. Dans cette course effrénée, la perspective d’un équilibre pour l’homme semble fondamentale. Or la beauté ne s’obtient pas par l’argent ou la volition, mais par l’ouverture et la réception. « Plus l’expérience de beauté est intense, plus le caractère poignant de sa brièveté engendre le désir de renouveler l’expérience, sous une forme forcément autre, puisque toute expérience est unique » [22], nous dit encore l’écrivain.
C’est pourquoi, finalement, il faut bien reconnaître que la beauté de la mort est possible puisque l’on accepte bien que les feuilles rouges soient belles…
II. Remarques sur les spatialités de l’ultime
Spatialité n°1 : La maison
Les âmes chromatiques et la non-dissolution de l’être
La maison parentale était en transition. Tout ce qui lui [23] avait appartenu, tout ce qui reste, avait perdu son possesseur. Dissolution. Un passage était en cours. Le passage d’un corps en un espace. La chambre était en transition. Le propriétaire était parti, on effaçait les ultimes traces de son visible. Une recherche était en cours. Rechercher ce qui est lisible de lui. L’ultime ménage opéré dans cette maison au ventre cimetière, offrait maintenantaux survivants l’occasion d’interpréter les traces, au risque de vivre des fables, fabuleusement. On ne pouvait n’avancer que par les images... Garder l’image, celle de l’odeur, de la vision, du toucher, du goût, du souvenir comme enjeu. Fonder des émergences sensorielles pour forger la mémoire, au risque d’inventer des fantômes. Forger pour garder précieusement la non-ultime image, il fallait, il faudra déchiffrer prochainement les pistes. La vie familiale était, finalement, en transition.
Certaines croyances populaires racontent que le coquelicot naîtrait du sang des victimes. C’est pour cela qu’on ne peut pas, une fois cueilli, le garder en vie. Il faut donc, pour entretenir en mémoire la beauté et la couleur du coquelicot, s’orienter dans un monde plus profond. L’image spectrale, c’est-à-dire l’imagination, est incarnée lorsque l’on tente de créer des ponts entre des choses lointaines et inconciliables. Pour se faire, il faut transiter. Transiter dans un monde sous-terrain crypté et revenir à un état sauvage, dans l’ancrage de l’imprégnation globale. Entre soi et l’autre, il n’y a plus de frontière, plus de dissolution, l’invisible nous unie.
Il faut dorénavant s’entraîner dans la maison et collecter les espaces de l’irréel. Il ne faut plus flotter dans l’impression vécue de l’accompagnement aujourd’hui terminé, mais s’imprégner au futur pour reconsidérer l’humain spatialisé, chez lui. La transition qui s’effectue après l’étape ultime de la vie engloutie dans une nouvelle consistance de la vie et du monde. L’invisible est tellement visible lorsqu’il est prégnant. Il fait transition, passage entre actes de foi et actes de choix, réversibilité de l’ultime. Le non-visible, le non-dicible crée des effets dans l’esprit du voyeur en devenant voyant de l’autre, en donnant une valeur aux images invoquées.
Chaque être possède différentes identités chromatiques lorsqu’il est vivant, lorsqu’il est malade, lorsqu’il est mourant, lorsqu’il est mort, lorsque sa maison est en transition. Aujourd’hui la demeure reste, malgré l’effacement volontaire opéré pour moins souffrir de la dissolution, ponctué par une collection de couleurs locales. Cette dernière entraîne sur les vivants des effets spatiaux, des touchers symboliques propres aux aspects de surfaces variables, et des affects, des réactions physiologiques associées à des moments, aux événements, aux objets, à des choses comme la chaise devant la télé ou comme la parure mal repassée du lit parental, aux gestes, au temps qu’il fait et à l’espace qui situe. Une forme d’énergie de l’anti-ultime persiste. Une forme d’énergie égrégorique est en résistance, constamment. Une forme d’énergie ascendante et de descendance est incrustée pour permettre de dépeindre le mort malgré les différentes matérialités absentes de sa présence.
La maison était en transition pour conscientiser et permettre d’inventer son mort. La déflagration des perceptions mémorielle, visuelle et émotionnelle opérée par la perte ultime de l’être proche place le survivant dans le vrai et le faux. L’homme vit dans la fiction et ne peut rien contre la nature de son cerveau malgré tous les savoirs et les maîtrises de ses cultures. Or accepter de laisser l’imagination prendre le dessus, au plus profond, accepter de déchiffrer et de revoir les couleurs perdues, les couleurs déjà oubliées, c’est admettre la vie par les petits récits pour reconstruire la mémoire traumatique. L’illusion permet de parvenir à une vérité ; vrai, la fin est déjà le début. Quand la dissolution est le début, infiniment, ∞.
L’ultime n’existe plus après son mort marquant car l’écart entre le réel et la réalité s’incarne. L’être n’y pouvait rien, n’y peux plus, n’y pourra plus jamais. L’écart entre la mimésis et la fiction disparaît une fois l’âme touchée, car l’œuvre du mort naît comme un art de la magie. Mais si la vie est une œuvre, l’ultime de la mort ne la mettrait-elle pas en stimulation ? Une transition spatiale s’opère après l’ultime. Une métamorphose de la vision puis du goût, de l’odorat et du toucher, jusque dans l’apparence et les gestualités mémorisées des choses extérieures et justement placées.
« On dira que nous sommes dans l’imaginaire rhétorique, le même que celui qui engendre la prosopopée, cet artifice rhétorique qui fait surgir les morts se présentant eux-mêmes et tenant discours » [24].
Spatialité n°2 : L’hôpital
La dissolution par le tableau et le paysage sonore
« Le plus beau paysage du monde, c’est toi. Il est en toi. Si de tels arbres, montagnes, personnes, animaux sont beaux, ce n’est pas par eux-mêmes mais par toi » [25]. Une belle mort est probablement la transformation naturelle d’un corps qui a peut-être réussi à devenir paysage…
Pour se souvenir de son mort, pour arrêter cet ultime tableau, il faut se créer un espace mémoriel, un paysage. L’auteur-acteur sélectionne, sans le savoir, ce qui le marque par émotion et révélation dans l’amont de l’ultime, par les moments passés auprès de l’agonisant. Comme un artiste qui ajusterait sa vision du monde pour la centrer dans une peinture, le paysage qui se construit dans l’âme et le corps du veuf, de la veuve ou de ses proches, vient de préférences et d’élections qui ont marqué dans le vécu de la dernière impression. Il faut probablement être présent lorsqu’un être cher part vers l’ultime découverte. Être en présence, c’est imprimer. Imprimer, c’est porter l’empreinte de son fantôme. Le fantôme est une forme avec laquelle on va s’habiter de vivre, un nouveau-moi.
Tout comme en peinture, le paysage marquant naît de l’ambiance du tableau, c’est-à-dire des moyens techniques par lesquels des résonances effectives se mettent à toucher/imprimer l’entourage. Quand « l’ambiance fait l’œuvre » dit Etienne Souriau [26]. L’ambiance est ici liée à la question du ressenti ainsi qu’à celle du dispositif. Dans les moments propres à la dissolution ultime, différents éléments importent : le lieu, les bruits, les lumières, les nuits, le climat météorologique qui s’installe mais aussi celui affectif des accompagnants, les chuchotements, les voix off, les pleurs étouffées, etc. La mort produit l’effet et l’affect à l’œuvre et, chaque chose, chaque individu a une place qui importe pour produire l’effet lorsque l’on s’approche du moment ultime même si le spectateur-acteur en situation ne le sait pas. Tout ce que porte le dispositif dans cette ambiance naît d’un mélange de réalité et de rêve. Tout ce qui importe, tout ce qui a importé dans cet instant de l’ultime départ ne s’adresse maintenant plus à nous mais à l’ultime arrivée des résonances fantomatiques.
Roland Barthes parle de « Fading : épreuve douloureuse selon laquelle l’être aimé semble se retirer de tout contact, sans même que cette indifférence énigmatique soit dirigée contre le sujet amoureux ou prononcée au profit de qui que ce soit d’autre, monde ou rival » [27] . L’éclipse de l’autre se produit, doucement ou brutalement. Le « fading mental » psychologique, arrêt progressif des propos du patient, évanouissement du cours de la pensée puis reprise du rythme normal sur le même thème, ou sur un autre ; « fading moteur » d’un dispositif qui s’arrête quoi que l’on en dise, brutalement, pour incruster un paysage à jamais ultime. Hanté. À l’hôpital, l’effet de « fading », cet effacement, cette fadeur sublime et progressive qui décolore la relation avec l’être cher se fait dans une durée, plus ou moins longue ou structurée, et le plus souvent par le biais de soins de confort. Dans ce temps situé, la vie continue, celle de l’accompagnant est réelle et motrice au point de faire défiler en-lui les images, les sensations, les émotions, les bruits dans le corps et le cerveau. « Les voix du récit vont, viennent, s’effacent, se chevauchent» [28] .
Il y a d’abord eu les voix de l’hôpital lors des allers et retours entre l’extérieur et l’intérieur du bâtiment. Ceux quotidiens des défilés d’ambulances et de leurs rituels devant la grande porte d’entrée. Les brancardiers jouaient une musique qui, à chaque passage de la roue caoutchouteuse, traçait au sol des bruits presque muets. Les pas des malades, du personnel médical, des visiteurs, des passagers divers ; les différentes intensités des sonorités numériques des téléphones mobiles, des ascenseurs, des machines à café, celles manuelles des pages des journaux en train d’être lues, celles motorisées des voitures signifiant une arrivée ou un départ. Tous ces exemples forment une sérénade métronomique qui montait en crescendo jusqu’en milieu de journée avant de s’atténuer le soir venu, lorsque les visites se font de plus en plus rares, et que ne restent, dans les lieux, que les professionnels de garde et les familles en attente de leur propre drame. Il y a aussi eu les échos des notes s’amplifiant dans le couloir principal du rez-de-chaussée qui accueillait un piano à partager, comme c’est le cas dans les entrées de gares ; celles des paroles qui se réverbéraient sur l’acier Corten [29] du parvis. Il y a eu la machinerie, celle extérieure des souffleries et des climatisations diverses ; et celle de l’intérieur, sortant des machines médicales, des électrocardiogrammes ou de ces boitiers qui libèrent les produits contre la douleur et le stress. Chaque mécanisme qui délivre un soin possède son propre organe à bourdonnement, à chuintement, ses clapotis spécifiques, ses cliquetis. Clic, clac. L’ambiance sonore est un élément très important lorsque l’on accompagne un proche vers la mort. Les moindres bruissements extérieurs ou venus du corps en attente importent. Ils sont un indice de l’état de santé et forment une étape décisive dans le processus de l’existence qui s’éteint, ultimement. Clappement, claquement, craquement, crissement… jusqu’aux cris avoisinants d’une chambre qui vient d’apprendre que la fin est proche ; le sonore importe, il est fondamental dans cette expérience.
On le sait trop bien, lorsque le bruit a cessé, la vie aussi. Lorsque le moment arrive, le silence, tant attendu et redouté en même temps, voit la dernière respiration retentir, celle qui se révèle en relevant le corps, celle qui pétarade avant d’être rumeur, celle qui aspire la vie et expire l’aphasie éternelle. Est-ce que ces ultimes bruits importent autant au vivant qu’au mourant ?
Le paysage ultime naît du fading qui est à l’intérieur de soi, dans la tête, dans le corps ; mais qui vient aussi de l’extérieur, dans l’espace de l’œuvre qui se joue.
« Dire adieu à l’oubli » [30].
« Parce qu’il n’est pas question d’expérience mais d’imagination, toujours après coup, toujours imminente » [31].
Spatialité n°3 : Le corps
Suivre la ligne de la dissolution et voir la pleine décoloration
Constater une mort à l’hôpital est probablement devenue, de nos jours, un geste peu marquant pour un médecin ou un légiste expérimenté. La constatation de cette dissolution ultime de l’être est une chose habituelle pour un fait divers que nous savons. L’action ne représente qu’une démarche mécanique consistant à formuler, sur des registres, un incident fraîchement arrivé dans les lieux. L’opération est sure et rapide, sans dire mot à la famille. La plupart des personnes meurent à l’hôpital aujourd’hui. Pas de thaumaturgie, simplement la confirmation que la ligne de l’assistance médicale est devenue plate et que la vie a finalement disparue de l’écran.
La ligne plate connaît trois significations
La ligne plate c’est la mort numérique. La machine, si elle est encore allumée, montre que rien ne bat. La mécanique des outils médicaux et de celle humaine ne bronchent plus. Mais l’appareil de mesure resservira bientôt. Le souffle lui, ne réapparaitra pas. Lorsque l’ultime ligne de vie s’arrête, une forme de surdité symbolique apparaît. Le temps et les sons se désagrègent. Ils s’étendent et ne résonnent plus de la même manière tandis que des bruits de vie persistent dans la tête du bien-portant, en sourdine, continus. Mais lorsqu’apparaît sur la mécanique le trait aplati et mince, c’est la mort, le silence dans l’espace, tout simplement.
La ligne plate c’est aussi l’horizon. Le mort est loin maintenant. Il chemine vers, dans, à jamais. Ce point de fuite, le survivant l’imagine en amont de nombreuses fois. À l’image de la pratique du dessin, la composition de cette ligne est une question de regard, de point de vue. L’image de l’ultimité qui s’est mille fois structurée dans le cerveau donnait, à chaque fois, la sensation de lignes parallèles qui suivaient rigoureusement un cheminement menant à un final unique. Mais dans cette perspective chimérique, l’impression de convergence s’achevait toujours non pas sur une ligne mais sur une tâche noire et plutôt floue. Comme un tableau sans profondeur arrêtée, comme un miroir magique réalisé par Maurits Cornelis Escher, la vision inatteignable de la ligne avait maintenant, concrètement trouvé en son lieu et son temps, l’ultime point de chute. Au-delà.
La ligne plate, c’est encore le trait gravé au crayon par le médecin et son assistante qui annonçaient, il y a peu, la fin d’une part de l’histoire familiale. Le corps médical était maintenant revenu dans la chambre avec l’étiquette de légiste pour reconnaître la mort vers midi. C’est cet horaire qui est maintenant donné pour acquis, officialisé sur tous les papiers qui suivent le corps froid et l’administration. Le temps ultime n’est donc pas juste, il est décalé. À l’hôpital, c’est une quinzaine de minutes qui diffèrent du réel afin, certainement, de s’assurer que le mort est bien mort.
Comme la ligne plate, la couleur de la maladie connaît trois états
Elle est soit profonde, soit surface, soit volatile. La surface est ce qui est donné au monde, ce qui est vu et visible. La profondeur est ce qui s’exprime, ce qui évolue sans qu’on le visualise, mais qui détruit de l’intérieur. Elle remonte des entrailles tandis qu’à la surface, elle s’étale. La couleur volatile est organique. Elle ressort du corps en indiquant son impureté, sa détérioration, ses éjections.
Les couleurs profondes qui diffèrent de celles de surfaces ou de celles volatiles sont les plus complexes à comprendre et à repérer. Elles interviennent depuis un processus interne duquel découle des modifications physiques externes. Lorsque la dissolution approche, les pieds et les chevilles palissent et enflent. Cette transformation est opérée par un travail des reins qui est ralenti et qui, de fait, accumule dans le corps des liquides. Les zones éloignées du cœur agonisent et gonflent ; les pieds, les mains et le visage peuvent paraître bouffis et clairs. Les couleurs profondes sont des conséquences et non des raisons de la maladie lorsque c’est la maladie qui mène l’autre à l’ultime seconde. Elles se lient aussi à d’autres facteurs, comme la perte de température ou le changement d’apparence de la morphologie. Ainsi, dans le temps précédent l’ultime toquant à la porte, la circulation sanguine se retire de la périphérie du corps pour se concentrer sur les organes vitaux. Les extrémités deviennent froides et les ongles palissent ou bleuissent. La peau, qui jusque-là avait présenté un état uniformément pâle ou cendré, développe maintenant un modèle chromatique distinctif. Les lignes naissent, la chair se marbre. Les couleurs sont piquées. Des linéarités blanchies, violacées, un peu rouges, un peu bleues, apparaissent à la surface. Le sang et son oxygène ne circulent presque plus.
Ce qui reste alors, quand la vie et la couleur se dissolvent, ce n’est pas l’absence complète de couleurs, mais plutôt leur rétraction en des demi-teintes dégradées et brouillées comme des bigarrures. L’harmonie visuelle se dégrade. Le futur cadavre exhibe une carnation sans éclat sur laquelle se dessinent des lignes-motifs dans une juxtaposition de teintes mal assorties, entre tranchants et amas. L’œil qui scrute découvre des zones de glauque, cette tonalité de vert tirant sur le bleu et qui, ici, est né d’un mélange organique non connu. Le regard peut aussi lire des tracés ultimes portés par des nuances vives. À l’image de la minéralité propre à la pierre de marbre ou de granit, il n’y a pas vraiment d’uni, seulement un ensemble homogène de loin qui, si l’on s’en rapproche, devient points, touches et mitoyennetés d’albâtres malaxés de jaspes. Les couleurs du corps humain sont, au moment ultime, je crois, assez proches de celles des stucs et des marbres qui architectureront la dernière demeure. Ces derniers se déclinent en plusieurs tons, des plus classiques comme le blanc et le gris aux plus originaux comme le vert, le rouge et le noir. La seule différence entre l’épiderme et la pierre vient que la carnation est encore un peu chaude. Néanmoins, le blanc de Carrare étincelant, qui possède des veines grises très marquées ne montre pas, sur la chair qui se fane, l’éclat si caractéristique de sa qualité inorganique.
Le blanc devenu grisé d’ultime vient maintenant sur tout le corps. La non-couleur en tâche s’étend malgré la persistance d’une possible linéarité de la couleur-motif. Être bigarré par l’uniformité des marbrures qui se dessinent sur le corps, la mort avance en lignes floues sur toute la longueur du gisant, mais aussi sur sa largeur. Le point le plus haut du ventre semble encore luisant et jugeable comme un presque-uni ; mais désormais, les joues forment un rhizome enchevêtré de teintes variantes que l’on déchiffre avec difficulté, même en suivant une droite de veinules précise. Ces veines, ces lignes qui ont pris naissance sur une base sanguine[32] se transforment, au fil de leurs longueurs, en bleues, puis violacées, puis noires, puis transparence. La dissolution ultime du corps est fanée sur une base de jaune-grisâtre même s’il persiste du multicolore tramé. Les marbrures mutent maintenant en damier. L’effet varice se propage comme sur un treillis de radicelles et de fibrilles pour transformer la chair en carroyage. Cet échiquier émaillé ici ou mat par-là, alterne des clairs et des foncés. Il permet de repérer des intenses et des faibles qui combattent Éros et Thanatos tout en dessinant simultanément des formes nodulaires en des localités ciblées.
La couleur s’entrelace, le corps est en pleine ultimité. Le regard croise quelques derniers nœuds de vie, des tâches ultimes de résistance avant l’envahissement. S’achemine-t-on alors, dans la dissolution, vers la couleur originelle du marbre, vers l’inclassable beige ?
Plus ou moins beigeâtre, plus ou moins jaunâtre tendant vers le gris ou le vert, le sujet se décolore par toutes les nuances en se dirigeant, ultimement, vers la teinte mère, l’ultime couleur qui restera en mémoire.
« L’adjectif invulnérable fait d’entrée de jeu la différence avec ce que je dirai plus loin, plus tard, vers la fin, si mon discours y arrive, sur la joie de vivre jusqu’à la fin, donc sur l’appétit de vivre coloré par une certaine insouciance que j’appelle gaieté » [33].
Ultime Réflexion, ultime reflet
« Ah ! elle est changée, elle est changée » murmurait Rose au sujet de Nana, l’héroïne éponyme du roman d’Émile Zola [34]. Ce dernier s’achève sur la description du cadavre de Nana, alanguie sur des coussins, éclairée par la clarté de la bougie tel un charnier, un tas d’humeur et de sang note Zola. La scène est détaillée, les mots sonnent. Le rose vénus « d’un aspect grisâtre de boue » a changé, la joue s’est couverte d’une croute rougeâtre tel un « masque horrible et grotesque du néant ». Il ne reste de la Nana d’avant qu’une chevelure comparable à une « flambée de soleil ».
La mort ne s’arrête pas lorsque le cœur ne bat plus, lorsque le cerveau n’est plus irrigué. Elle poursuit son chemin, de plus en plus vite, de plus en plus remarquablement sur le corps. Alors que la vie « en rose » s’est éteinte, les machines à oxygène, le cerveau… la couleur continue à virer. Faire virer, fondre ou éteindre sont des notions nobles de couleur que l’on utilise lorsque l’on est artiste. En faisant virer la couleur, le peintre change sa valeur, invente une demi-teinte, plus douce, moins brusque. Il rompt la pureté en rabattant ou éteignant la luminosité, en jouant les camaïeux et les tons-sur-tons, il efface avec lenteur et préciosité.
« The reflecting pool » [35] est une œuvre du vidéaste américain Bill Viola, qui fait imaginer la disparition et l’ultimité par la couleur comme chez le peintre. Dans cette œuvre, un homme sort d’une forêt et s’arrête devant un bassin d’eau. La piscine naturelle se dessine au premier plan, noyée dans un milieu glauque où se déploient des centaines de nuances portées par l’environnement. Le spectateur aperçoit l’homme vêtu d’une chemise jaune et d’un pantalon vert. Des bruissements d’eau et d’avion forment la bande-son. Tout à coup, l’individu plonge dans le milieu liquide de la piscine et, à cet instant, le temps s’arrête. Arrêt sur image. Plus rien ou presque ne bouge. Arrêt sur l’espace. Les mouvements de la scène immobile se limitent à la vibrance des reflets verts, blancs et bleus, des impressions et des ondulations matérialisés à la surface du bassin. Arrêt sur la couleur. L’homme, stoppé en l’air, verdit par transparence. Il se fond dans le paysage. L’eau et les oiseaux font le son. Le regardeur est maintenant envahi par le coloris chromatique et sonore tandis que le tableau, à demi-figé, se brouille des verdissements. Seule l’eau olivâtre du bassin continue à bouger, à haloter et à vibrer. Quelques secondes plus tard, une ombre humaine se met à refléter derrière une brume imaginaire. Alors que le spectre en suspension est toujours figé dans le paysage, un homme sort de l’eau, nu. C’est l’homme ; il est à l’état de nature. Le corps qui était en lévitation s’est maintenant totalement dissipé dans le décor de la forêt, plus justement dans l’air. La brume était de l’air. L’imagination était de l’air. C’est alors que deux êtres éclosent en reflet dans l’eau de la piscine maintenant noircie. Étreinte, éteindre, se retrouver. La vidéo se termine. La dissolution de la couleur est-elle une manière humaine de disparaître et d’apparaître ?
« On ne meurt pas, on change de lieu. On change d’état. C’est toujours le même être, mais autrement » [36]. L’ultimité est-elle alors réellement une dernière fin ? L’ultime ne pourrait-il finalement pas devenir, comme le vert de Bill Viola, une méthode de restructuration de, et, pour la vie ?
« Jusqu’à la mort. Du deuil et de la gaieté » [37].
Notes
[1] La société tendrait à taire tous états désagréables engendrant une peur généralisée de la douleur. Cette hypothèse défendue par différents penseurs comme, par exemple, le philosophe Byung-Chul Han in, La société palliative. La douleur aujourd’hui, Paris, PUF, 2022, montre que l’aglophobie actuelle repose sur un changement de paradigme. « Nous vivons dans une société de la positivité qui cherche à se débarrasser de toute forme de négativité. La douleur est la pure et simple négativité (…) Il faut éviter les pensées négatives. Elles doivent être immédiatement remplacées par des pensées positives », p.11. Or une vie sans douleur et dans le bonheur permanent ne serait plus une vie humaine. La mort et la douleur vont de pair comme le montre le philosophe en notant, en conclusion, que « dans la douleur, on anticipe la mort. Qui veut éliminer toute douleur devra aussi supprimer la mort. Mais la vie sans mort ni douleur n’est pas une vie humaine, c’est une vie de mort-vivant », p.106. L’idée de palliatif est donc ici acceptée comme moyen d’atténuer les symptômes d’une maladie ou d’un deuil, sans les guérir, et non comme objectif de taire le sentiment et l’expérience constructive de la douleur.
[2] Le sentiment de sublime est éprouvé devant ce qui excède toute forme, présentant la nature comme immensité ou force. Dans la philosophie kantienne, le sublime est un mode de présentation immédiat et négatif du suprasensible. Il en résulte un plaisir négatif, car l’harmonie se réalise dans une douleur qui rend impossible le plaisir, du fait que la raison et l’imagination ne peuvent s’accorder que dans une tension. « Le sublime est un sentiment qui nous fait saisir à la fois l’impuissance de notre imagination à donner une représentation adéquate à l’Idée de la raison, ainsi que le caractère supra-sensible de notre destination ». « Ce ne sont pas les objets de la nature qui sont sublimes en eux-mêmes, mais les Idées qu’ils éveillent en nous (…) », in, J-M. Vaysse, Le vocabulaire de Kant, Paris, Ellipses, 2020. Le présent texte oscille constamment entre le sentiment de beau comme état poétique constructeur en s’éloignant des propos de Kant pour qui le beau n’est pas agréable, et de sublime au sens kantien, comme état d’incompréhension, d’impuissance, incapacité de l’imagination à saisir ce qui se passe, afin de montrer toute la dualité contenue dans la douleur et dans l’idée d’ultime. Voir E.Kant, Observations sur le sentiment du beau et du sublime, Paris, Vrin, 1992.
[3] et * Entrées définitionnelles du terme « ultime », Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, CNRTL informatisé. Consulté en mai 2023.
[4] Cité par P. Ricoeur in, Vivant jusqu’à la mort, Paris, Seuil, 2007, p. 61. Le philosophe Paul Ricoeur, âgé de 83 ans en 1996, laisse sur son bureau différentes notes regroupées, suite à sa disparition, dans un ouvrage de méditations intitulé, Vivant jusqu’à la mort. Ricoeur évoque dans ce manuscrit la vie et les écrits de l’écrivain et homme politique espagnol, Jorge Semprun, décédé en 2011. La citation employée note 4 dans le présent texte est celle de Semprun. Ricoeur évoque Semprun pour son idée de configuration imaginaire portée par la désignation de la mort elle-même comme un personnage agissant. Il s’inspire en partie de ses écrits pour déployer cette idée, au travers de son expérience relatant les guerres du XXe siècle, et autour de la question de l’indicible. Les propos de Ricoeur suivent le présent texte comme des pensées tournées vers une esthétique de la finitude et une anticipation de l’avoir-à-mourir.
[5] Pour Paul Ricoeur, s’il est nécessaire de soumettre la visée éthique de la « vie bonne » à la norme morale du devoir, c’est parce qu’il défend l’idée que le mal est une réalité. Partant de cette idée, la « vie bonne » peut se poser en termes de visée pour un vivant. Mais, dans le même temps, la mort étant réelle, on peut tout autant examiner les conditions de sa venue. L’ouvrage, Vivant jusqu’à la mort, est une réflexion sur le mourir -l’avoir-à-mourir-, sur le moribond et son rapport à la mort, ainsi que sur l’après-vie.
[6] P. Ricoeur, Ibid, p.37
[7] Les codes de la beauté sont aujourd’hui éphémères et portés par une « esthétisation du monde » véhiculée par l’image. L’esthétisation est en accélération constante comme soulevé par la philosophie de Gilles Lipovetsky et Jean Serroy, in, L’esthétisation du monde, Paris, Gallimard, 2016. En prenant l’industrie créative comme exemple, en effaçant les frontières culturelles, le capitalisme est présenté dans cet ouvrage comme une machine de déchéance esthétique et l’homme, comme un « Homo Aesthéticus » condamné aux effets de mode, effets de beau, éphémères.
[8] F. Cheng, Cinq méditations sur la beauté, Paris, Albin Michel, Le livre de poche, 2008, pp.41-42.
[9] À la recherche du temps perdu (1906-1922) est un roman de Marcel Proust relatant une réflexion en sept tomes sur la littérature, la mémoire et le temps.
[10] C. Malabou écrit : « Quelque chose arrive, qui précipite le sujet dans la vieillesse, qui imprime au devenir-vieux une chute qui est et n’est pas son actualisation. Un accident idiot, une mauvaise nouvelle, un deuil, une douleur, et le devenir se fige, brusquement, qui fabrique un être, une forme, un individu inédits ». In, Ontologie de l’accident, Paris, Léo Scheer, 2009, p.43.
[11] P. Ricoeur, Ibid, p.70.
[12] Après le décès d’une personne, sa trace et sa vie perdurent. Sans mot de passe, difficile d’effacer les profils multiples créés, de son vivant, sur les réseaux sociaux. Sans clôture volontaire des dossiers administratifs ou publicitaires, difficile de ne plus recevoir de courriers adressés au nom du ou de la défunte.
[13] Le terme morbidezza est souvent employé pour désigner le moelleux et la délicatesse des coloris d’un tableau dans le domaine des Beaux-Arts. Morbidezza est dérivé de morbido, morbide, issu de « malade » et « maladie ». Un lien évoquant la question du sublime uni les deux approches car, « de manière morbide », morbidezza renvoie tout autant la grâce alanguie qu’à l’avoir-à-mourir.
[14] P. Ricoeur, Ibid, p.83
[15] Jason de Caires Taylor est un sculpteur anglais ayant créé, en 2006, le parc des sculptures sous-marines à la Grenade, aux Antilles ; en 2009, le plus grand musée subaquatique du monde à Manchones Reef, près de Cancun au Mexique. Son travail participe à une critique de la société. Ses œuvres visent à concrétiser une forme de méditation entre les mondes construits par l’homme et le monde naturel. En évoquant la beauté de la mortalité, il questionne l’inévitable et la décadence de l’homme par la nature.
[16] La notion d’aura renvoie ici au travail de Walter Benjamin qui introduisit ce terme dans son essai, Petite histoire de la photographie, ainsi que dans, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique. Benjamin utilise le terme pour caractériser « l’ipséité » de l’œuvre d’art, unique et liée à un espace et un temps qui l’inscrivent dans l’histoire. Le sentiment qui se dégage alors de l’aura n’est pas reproductible. Comme si, d’un côté existait la singularité, la contemplation ou la résonance de l’aura et ; de l’autre, la réplique, la distraction, la masse entraînant la perte de l’aura. L’aura est inaccessible par la reproduction et non rééditable. Sans réduire la pensée de Benjamin, dans la magie du hasard que la nature opère sur les sculptures de James de Caires Taylor et malgré la reproductibilité de la technique employée par l’artiste, une forme d’aura peut se refléter. Aucun environnement marin, aucune installation ne se colore ou se décolore de manière identique, ne touche de la même façon à l’image de la mort marquante qui, située, peut par certains côtés revendiquer une forme de sentiment singulier ou de résonance contre l’accélération du monde esthétisée, de nos ressentis falsifiés et pour l’aptitude à se laisser toucher et transformer.
[17] Le travail de James de Caires Taylor critique l’accélération constante du monde (Voir le travail du philosophe H. Rosa autour de, La résonance comme sociologie de la relation au monde, Paris, La Découverte, 2018) et l’usage du « care » comme palliatif qui en découle faussement (Voir B-C. Han, La société palliative. La douleur aujourd’hui, Paris, PUF, 2022).
[18] P. Ricoeur, Ibid, p.37.
[19] G-P. Effa, Le dieu perdu dans l’herbe, Paris, Presses du Châtelet, 2015, p.74.
[20] J’ai eu la chance lors d’un voyage à Wushan à l’automne 2019, de participer au « festival des feuilles rouges ». Lors de cet événement, la ville se pare des couleurs du feu et les coutumes propres au moment, transforment le rythme des habitants. De nombreuses photographies sont prises lors de déambulations dans la montagne comme une ode/offrande au rouge.
[21] F. Cheng, Cinq méditations sur la beauté, Paris, Albin Michel, Le livre de poche, 2008, p.41.
[22] F. Cheng, Ibid, p.42.
[24] P. Ricoeur, Ibid, p.52.
[25] G-P. Effa, Ibid, p.119.
[26] E. Souriau, Vocabulaire d’esthétique, Paris, Presses universitaires de France (PUF), 1990, seconde entrée définitionnelle « Ambiance », p.91.
[27] Roland Barthes, dans « Fragments d’un discours amoureux », in, Oeuvres complètes, t.V, 1977-1980, Paris, Seuil, 2002, p.147, écrit : « Le fading de l’autre se tient dans sa voix. La voix supporte, donne à lire et pour ainsi dire accomplit l’évanouissement de l’être aimé, car il appartient à la voix de mourir. Ce que fait la voix, c’est ce qui, en elle, me déchire à force de devoir mourir, comme elle était tout de suite et ne pouvait être jamais rien d’autre qu’un souvenir. Cet être fantôme de la voix, c’est l’inflexion ».
[28] Mais l’ambiance funèbre ne pourrait exister sans que, en amont, « dans le texte, le fading des voix est une bonne chose ; les voix du récit vont, viennent, s’effacent, se chevauchent » nous dit encore Barthes. L’effroyable panne qui vient de toucher l’ultime sommet culminant de la vie maintenant morte plonge le survivant dans la trace sensible qui s’est ainsi inscrite comme une cicatrice qu’il faudra apprendre à dompter, des brisures qu’il faudra négliger.
[29] L’acier Corten encore appelé acier patinable, est un matériau utilisé en architecture pour sa qualité esthétique qui consiste à s’oxyder dans le temps. Il débute son exposition extérieure dans une teinte de gris noirci pour progressivement se patiner dans des couleurs rouilles.
[30] P. Ricoeur, Ibid, p.69.
[31] P. Ricoeur, Ibid, p.62.
[32] « Sanguine » est ici utilisé comme métaphore pour évoquer le domaine des sanguins. Le terme « sanguine » correspond, dans le champ de la couleur, à une famille de pigments de couleur rouge terre. La sanguine se décline également en orange, ocre, marron et beige. Dans le texte, le terme renvoie à la palette du sang.
[33] P. Ricoeur, Ibid, p.39.
[34] É. Zola, Nana, Paris, Gallimard, 2002, dernière page.
[35] Bill Viola est un plasticien américain reconnu en particulier pour ses installations vidéo. Son travail interroge le médium de la vidéo comme message. Pour cette raison, le son importe autant que l’image ou la mise en scène. Nombreuses de ses réflexions abordent les questions de la vie et de la mort. « The reflecting pool » est une vidéo réalisée entre 1977-1979. 7 min.
[36] G-P. Effa, Ibid, p.88.
[37] P. Ricoeur, Ibid, p.31.