Hidehiro Tachibana travaille principalement sur les littératures francophones et, en particulier, les littératures antillaises et québécoises. Il s’intéresse aux intellectuels francophones et asiatiques qui se sentent déchirés entre leur culture d’origine et leur connaissance de l’Occident. Il est l’auteur ou co-auteur notamment de Québec si lointain, si proche (2013). Les intellectuels au XXIe siècle (2009). Hidehiro Tachibana s’est consacré à plusieurs traductions : Pierre Bourdieu, Dany Laferrière, Aimé Césaire, Édouard Glissant, Julio Cortázar et de nombreux poètes québécois. Il est professeur émérite de l’université Waseda à Tokyo, président de l’Association japonaise des études québécoises et membre de la Société internationale de mythanalyse.
Abstract
L’auteur s’interroge : pourquoi le Japon, si attaché à ses traditions culturelles ancestrales, est-il si disposé à adopter des us et coutumes et des créations culturelles d’avant-garde de l’Occident ? N’y-a-il pas là une étrange contradiction, du moins aux yeux des Occidentaux. C’est paradoxalement dans les mythes anciens du shintoïsme que l’auteur pense trouver une explication à cette singulière fascination pour l’innovation, qu’elle soit technologique ou culturelle.
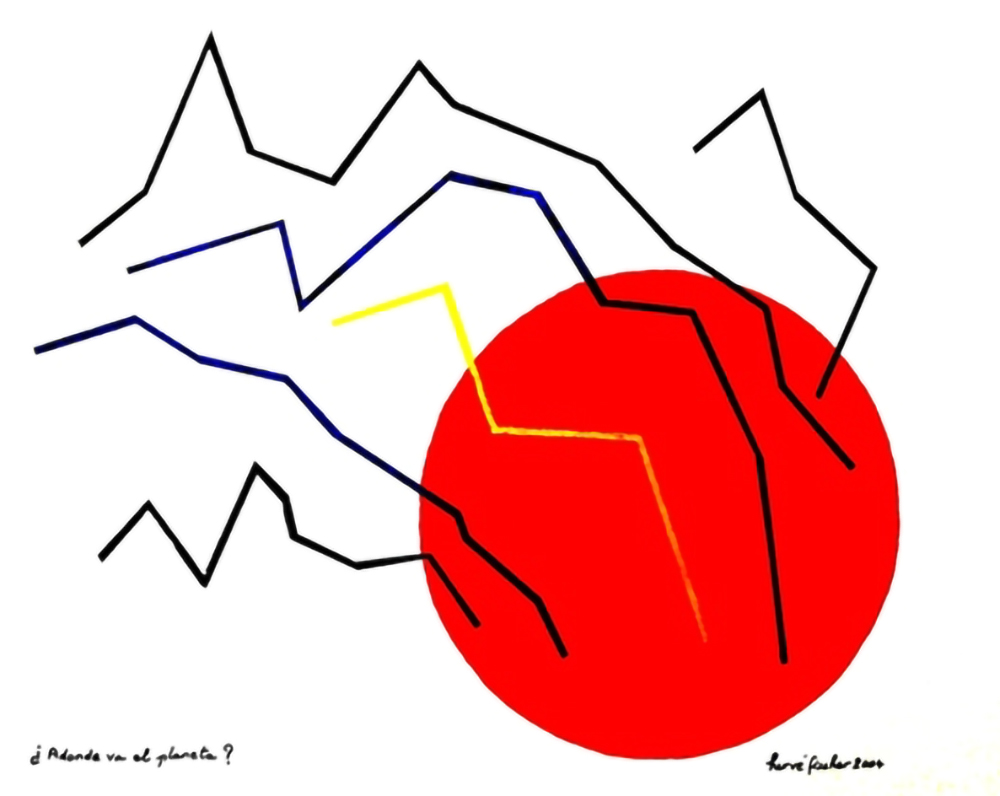
Hervé Fischer, ¿A dónde va el planeta? [ Où s’en va la planète?], acrylique sur toile, 2004.
Qu’en est-il de l’art au Japon ? Quand je me pose cette question, je crois nécessaire de remonter aux origines. Je suis conscient des dangers qui accompagnent ce genre de démarche, mais je ne pense pas que tous les secrets de l’art japonais aient disparu avec l’ancien temps. Ce pays a évolué et évolue encore, réceptif aux grandes influences du monde extérieur. Je ne crois pas à un « Japon éternel » ni à un Japon qui deviendrait étranger à lui-même avec la modernité. Ce qui caractérise ce pays d’Extrême-Orient, c’est sa mutation profonde sans cesse renouvelée depuis les temps préhistoriques. Les habitants de cet archipel ont eu toujours un modèle à suivre, jadis la Chine, aujourd’hui les États-Unis. Il faut, bien sûr, nuancer, car les Japonais sont peut-être moins américanisés que les autres peuples asiatiques. Depuis l’ère Meiji les Japonais n’imitent pas seulement les Américains mais aussi d’autres pays occidentaux. Au milieu du XIXe, lorsque la modernisation du pays a commencé, ils ont adopté plusieurs modèles occidentaux, en particulier, l’Angleterre, les États-Unis, l’Allemagne, la France et la Russie. Ces cinq pays ont beaucoup contribué à diversifier la modernisation de nos institutions et de notre société. La France a surtout eu une influence culturelle, et l’Allemagne une influence scientifique. La France a été longtemps le pays de référence pour établir au Japon la prédominance d’une langue nationale, notamment littéraire (le pays était divisé selon les classes sociales et des sous-groupes dialectaux) et pour la création d’un art japonais moderne, tandis que la Chine, qui fût un modèle millénaire, a cessé d’être de l’être. Ce furent ces renversements de valeurs qui accélérèrent l’émergence de la modernité japonaise.
Malgré ces mutations incessantes, certains traits de la culture japonaise sont demeurés beaucoup plus présents que d’autres. Il n’est pas facile de les nommer ; je tenterai néanmoins de les discerner, dans une perspective plus large qu’on ne le fait d’habitude, en réexaminant les idées qui m’ont assailli au Centre Georges Pompidou en 1987 en visitant l’exposition « Japon des avant-garde - 1910-1970 »[1]. Ce fut l’une des premières fois où m’apparurent clairement ces éléments durables de l’esthétique japonaise et les caractéristiques générales de l’esprit japonais.
Je déplorais que l’intérêt des Occidentaux envers le Japon se limite trop aux traditions et que ses aspects modernes soient négligés. Or, cette grande exposition prouvait enfin que les Occidentaux s’intéressaient aussi à la modernité japonaise. Il est vrai que le Japon, comme d’ailleurs beaucoup d’autres pays, est plein de contradictions et de conflits perpétuels. Et je suis conscient que ma vision ne correspond pas nécessairement à celle des Occidentaux, qui conçoivent les contradictions japonaises tout autrement.
Comment se fait-il, par exemple, que les Japonais se montrent à certains moments, dans certains domaines scientifique, artistique, littéraire ou philosophique, si innovateurs en dépit de leur esprit conservateur et de leur attachement présumé à de vieilles traditions ? En réalité, le Japon a du mal à conserver ses « bonnes traditions ». Actuellement la famille, l’unité fondamentale des structures sociales japonaises, est en décomposition irréversible, ce qui n’est pas forcément négatif en soi, mais qui entraîne, me semble-t-il, une déshumanisation qui déstructure les relations humaines générales. Mais laissons de côté cette transformation sociale et humaine du Japon : ce qui nous intéresse, ce sont les rapports entre la modernité et la tradition.
2. L’exposition « Le Japon des avant-gardes, 1910-1970 » en 1987 au Centre Georges Pompidou
Avant d’aborder cette problématique, il est nécessaire d’analyser les aspects les plus avant-gardistes du Japon moderne. Au moment de cette exposition, nous étions en pleine époque postmoderne. Nous étions aussi à la veille de la chute du mur de Berlin. Et la prospérité économique qui a suivi la Seconde guerre arrivait à son terme. Prenons ici quelques repères. Le Japon avait vécu la version japonaise de mai 68 : de nombreuses universités étaient restées barricadées par les étudiants durant des mois, au moins jusqu’au début de 1969. Le Japon avait aussi vécu le suicide théâtral de Yukio Mishima le 25 novembre 1970. Après l’échec des dernières manifestations de rue, gauchistes ou de gauche, et la mort de Mishima qu’on peut considérer non seulement comme un des actes les plus spectaculaires et revendicatifs de la droite culturelle, mais aussi comme l’annonce involontaire de la mort de la littérature nationale, le Japon vivait les années 1980 sous la dominance de la « postmodernité ». Et les Japonais se voyaient économiquement et technologiquement comme les pionniers d’une nouvelle ère, d’un nouveau mode de vie avec le baladeur (walkman) de Sony et les images emblématiques de prêt-à-porter, de jeux vidéo, d’alimentation et de librairie des grands magasins Seibu.
C’est dans ce contexte socioculturel que l’exposition sur le Japon des avant-gardes a été organisée au Centre Pompidou, avec l’objectif de présenter l’histoire de l’art japonais de 1910 à 1970. Cela ne voulait bien sûr pas dire que les avant-gardes japonaises avaient pris fin en 1970. D’ailleurs 1970 y fut une année cruciale, marquée par l’Exposition universelle d’Osaka, indubitablement un des événements les plus importants sur le plan culturel et artistique du Japon moderne, avec sa symbolique Tour du Soleil, dressée par Tarô Okamoto sur la colline de Suita au nord de la ville d’Osaka.
Quant à l’année 1910, date choisie pour le début de l’exposition, elle coïncidait avec l’époque du Manifeste du futurisme de Marinetti paru dans Le Figaro le 20 février 1909, dont le texte avait été traduit et publié dans une revue japonaise dès le mois de mai par Ôgai Mori, une grande figure littéraire, et avec le cubisme qui fit l’objet de débats dès le mois de novembre 1911, alors même que le terme de cubisme était largement diffusé en Europe cette même année lors du Salon des indépendants en avril. On voit que le Japon moderne était en grande demande de nouveautés européennes. 1912 fut même l’année du premier tableau abstrait japonais, intitulé « Sans titre », de Tetsugoro Yorozu[2]. Et parmi les premiers avant-gardistes du Japon, il faut nommer, entre autres, Seiji Togo, Tomoyoshi Murayama, Kazuo Sakata et Minoru Nakahara.
2 - 1. Premiers avant-gardistes japonais
Présentons brièvement ici ces quatre artistes pour mieux saisir les premiers pas de l’avant-garde japonaise.
Seiji Togo expose en 1916, à l’âge de 19 ans, Femme au parasol, un tableau très abstrait aux couleurs vives, au centre duquel apparaît un visage féminin entouré de nombreux motifs courbes et en forme de croissants, bien qu’on n’y voie de parasol nul part. À partir de 1921, Togo séjourne sept ans à Paris, d’où il rend visite à Marinetti en Italie.
Tomoyoshi Murayama est un homme emblématique des premières avant-gardes japonaises, fortement attiré par le constructivisme russe. Après avoir séjourné un peu plus d’un an en Allemagne, il crée le groupe célèbre Mavo en 1923, à l’âge de 22 ans. Dans un manifeste, Murayama écrit : « nous sommes debout sur un point pointu. Et nous serons toujours debout sur un point pointu ». Le tableau intitulé Konstruktion (1925)[3] fut ressenti comme un choc par les jeunes artistes japonais. C’est un tableau rectangulaire, composé d’épaisses lignes croisées. Et en haut à droite du tableau s’ouvre une large fenêtre avec des collages d’images découpées dans des journaux allemands. Aujourd’hui, cela ne paraît plus si original en soi, pour qui connaît bien les mouvements européens, mais son audace, sa témérité furent à l’époque ressenties au Japon comme une provocation. Sa révolte artistique se manifestait en particulier par un poteau de couleur vive sortant audacieusement du cadre du tableau, perçu comme un signe d’irrespect total. Murayama n’est cependant pas longtemps demeuré dans le domaine des beaux-arts. Artiste multiforme, il travailla par la suite comme metteur en scène et finit par devenir un dramaturge communiste prolifique.
Kazuo Sakata partit pour Paris à l’âge de 22 ans et y rencontra Fernand Léger en qui il trouva le maître qu’il recherchait. En 1925, il crée Portrait cubiste[4], qui marque une nouvelle étape de l’avant-garde japonaise, alors que beaucoup de peintres modernistes se sont tournés vers le fauvisme.
Minoru Nakahara est certainement un des plus originaux peintres du Japon. Son père est dentiste et lui-même le devient. Il part pour les États-Unis à l’âge de 23 ans, en 1916, pour s’inscrire à l’école de dentisterie d’Harvard, puis l’année suivante il se rend en France pour travailler comme dentiste à l’hôpital militaire de Paris. Rentré en 1923, il présente un grand tableau composé d’images scientifiques complexes : Un coup de dé (Kenkon). Il s’agit, à première vue, d’un assemblage d’images multiples qui nous invite à nous recueillir devant un vaste espace imaginaire de couleur bleue. Aujourd’hui, on découvre pourtant que le peintre y avait soigneusement et secrètement inséré des références aux plus récentes connaissances scientifiques de l’époque, depuis la biologie jusqu’à la théorie des quanta. Le tableau montre, au centre, un grand cercle ressemblant à la fois à une ammonite et à l’œil humain, connecté aux replis finement peints d’un cerveau. Et à l’entour apparaissent des éléments multiformes, plutôt surréalistes, tantôt biologiques, tantôt physiques, évoquant l’évolution de la vie et sa fécondité, en lien avec les derniers acquis de la physique et de la chimie, dont l’illustration est accompagné d’une référence au système atomique (ces figures bizarres et énigmatiques font allusion aux recherches de R. A. Millikan, prix Nobel de physique en 1923, de H.R, Hertz, physicien allemand, ainsi qu’aux travaux de W. D. Coolidge, connu pour les innovations que nous lui devons dans le développement du tube à rayons X). On y remarque aussi un peu plus bas de petits points rouges flottants, évoquant l’amour et la fécondité. Et sur le bord droit, le tableau est cadré par un grand spectre solaire vertical, tandis qu’on voit en haut à gauche une galaxie s’éloigner (celle découverte en 1923 par E.P. Hubble) et à droite la comète Halley qui décrit une courbe ascendante. La couleur dominante est le bleu accompagné de rouge, jaune et marron.
2 - 2. Verbe ou énergie ? Où les artistes japonais, puisent-ils leur force moderniste ?
À la vue générale de l’exposition « Le Japon des avant-gardes », j’ai eu de curieuses impressions que je n’aurais pas eues si j’étais demeuré à Tokyo. Le modernisme japonais me semblait montrer des traits communs ne venant ni forcément du modernisme européen, ni forcément des « traditions japonaises » avec leur esthétique minimaliste et elliptique. Au fond, les arts japonais s’inspirent traditionnellement de deux esthétiques opposées, celle du théâtre nô et celle du théâtre kabuki. Le premier est emblématique de la classe des aristocrates guerriers, les samouraïs, tandis que le second est celui des classes populaires et des commerçants. Et on observe que les avant-gardistes japonais ont le plus souvent recouru à l’esthétique populaire. Ils se révoltaient contre l’esthétique du pouvoir dominant. Mais est-ce que ces révoltes avant-gardistes peuvent être réduites à des inspirations populaires ou commerçantes ? Il ne semble pas. Qu’est-ce qui les pousse alors à rechercher des sources d’inspiration étrangères à leur propre culture ? D’où leur vient cette quête ?
On observe que ces recherches esthétiques aboutissent très rarement à des formes ou à des compositions équilibrées ou symétriques. Il semble, sauf cas exceptionnel, que cette recherche formelle ne trouve jamais son plein aboutissement chez ces artistes japonais. D’ailleurs, le néoplasticisme n’a jamais été vraiment à la mode. On pourrait parler plutôt d’une absence de figuration objective ou réaliste. On y décèle toujours une subjectivité débordante ou lyrique qui empêche l’artiste d’aboutir à un formalisme objectif comme on le constate chez Matisse ou Picasso. Je dirais même qu’on peut y découvrir des formes fluides, quelque chose de visqueux, chaud, liquide ou animal, qui n’est pas forcément désagréable, lié peut-être au climat humide et pluvieux du Japon, et qui génère parfois un rythme particulier et même des chants de joie. Je me demande de quelles sources souterraines viennent ces forces indéfinissables ?
À cet égard, la peinture moderne japonaise semble plus proche de Klee que de Kandinsky. Finalement je dirais même que l’avant-garde japonaise est sans doute à la recherche secrète de la vie et du cosmique. En outre, les artistes japonais aspirent manifestement à une rénovation de la société et des rapports humains au moyen des beaux-arts ; ils veulent libérer leur voix, qu’ils jugent opprimée par le féodalisme persistant de la société. On peut comparer la société japonaise du milieu du XIXe siècle à un vase rempli d’eau presque débordante. La révolution politique a fait émerger des mouvements culturels nouveaux. Les jeunes générations étouffaient non seulement politiquement mais aussi culturellement. Les traditions culturelles de la société ont connu un grand bouleversement. Imaginez seulement l’étonnement populaire lorsque loi exigea que les samouraïs se fassent couper les cheveux et abandonnent leur coiffure traditionnelle! Et ce n’était qu’un début. L’occidentalisation du Japon à l’ère Meiji sembla n’avoir pas de limites. Un fossé se creusa entre le peuple et les tenants de l’occidentalisation, tandis que le pouvoir gouvernemental demeurait autoritaire. Pour les artistes, recourir aux derniers mouvements culturels de l’Europe fut donc un geste évident de libération.
La modernisation du Japon fut vécue comme une rupture profonde à tous égards, une véritable implosion sociale et culturelle. Il peut arriver que la société soit bouleversée et passe à une autre étape. À cet égard, la modernisation japonaise semble avoir obéi aux lois habituelles de l’évolution sociale. Mais du fait d’une logique spécifiquement japonaise, souvent invisible, ce bouleversement a consisté à associer des éléments culturels étrangers et japonais au sein des structures complexes de la société sans la bouleverser en profondeur.
Il faut d’abord constater l’évidence et insister sur la mobilité de la société japonaise. Ce n’est pas une société figée ; historiquement, elle n’a jamais cessé d’évoluer. Par exemple, entre les VIIe et VIIIe siècles, le pouvoir a décidé d’introduire massivement des modes de fonctionnement de la société chinoise, jugés plus rationnels. Les dirigeants japonais ont su changer totalement de cap à plusieurs reprises au cours de leur longue histoire. Ils ont ainsi adopté le chinois comme langue d’administration du fait que la langue japonaise ne connaissait pas l’écriture. Mais on inventa au terme de deux ou trois siècles d’efforts un nouveau système d’écriture japonaise à partir du chinois, finalement très différente. La modernisation des XIXe et XXe siècles peut être comparée à cette transformation ancienne. L’important, pour la société japonaise, c’est d’évoluer sans cesse. Et vers la fin de l’époque féodale, celle des samouraïs, le Japon était mûr pour se transformer. La bourgeoisie était devenue économiquement plus puissante que la classe guerrière qui contrôlait encore le pouvoir administratif. Le capitalisme commercial se développait rapidement. Beaucoup d’intellectuels se tournaient vers les sciences. Ces évolutions ont préparé la révolution moderne du XIXe siècle. Rien ne surgit du néant. Et il faut souligner qu’au Japon les religions n’ont pas étouffé cette curiosité intellectuelle ni ce capitalisme naissant. Le Japon a connu des condamnations politiques certes, mais pas de grande condamnation religieuse, sauf dans le cas du christianisme au XVIe siècle.
Il existe un autre facteur important en faveur de la modernisation, même s’il peut paraître paradoxal. C’est l’école de pensée nationaliste (Kokugaku) qui se développe du XVIIIe au XIXe siècle. Elle s’est formée à partir des études philologiques des œuvres classiques, en particuler Kojiki (littéralement, Écrits des choses anciennes). C’est la chronique la plus ancienne du pays depuis la création mythique de l’archipel jusqu’au règne de l’impératrice Suiko de 576 à 585. Le Dit du Genji date du début du XIe siècle. La langue japonaise est une langue fortement dominée par la langue chinoise, en particulier sur le plan du vocabulaire. Le travail d’un grand philologue consista alors, pour ainsi dire, à annoter le texte de Kojiki, ces écrits très particuliers de la mythologie, illisibles à son époque, en rétablissant le vocabulaire de l’ancien japonais. A mon avis, ce fut une grande tentative du ressaisissement de la poétique japonaise basée essentiellement sur le vocabulaire japonais et non plus chinois. Appuyé sur ses études philologiques, Motoori tenta de sauver « l’âme japonaise » en la distinguant de « l’âme chinoise » marquée par le confucianisme. C’est à partir de cette interrogation sur la langue et la littérature japonaises que se déploya l’école de pensée nationaliste qui réclama de rétablir les pouvoirs de l’empereur et au milieu du XIXe siècle et d’expulser les Occidentaux. Il faut souligner cependant que ces révolutionnaires nationalistes, dont les idées fondamentales reposaient sur le shintô, ont reconnu à un moment donné leur erreurs et ont accéléré l’ouverture du pays vers la civilisationmoderne Le shintô de l’ère Meiji ne refuse pas, de façon générale, le rationalisme tant qu’il ne met pas en cause la stature de l’empereur.
Revenons à nos avant-gardistes. Le Japon vers 1910 était en quelque sorte à un sommet après sa victoire dans la guerre russo-japonaise de 1905 et une révolution industrielle, surtout sidérurgique, spectaculaire. Mais les structures sociales profondes demeuraient encore trop traditionnelles pour que le Japon puisse se constituer comme une vraie nation moderne en accord avec ces nouveautés « civilisationnelles » qui se développaient à Tokyo. Les artistes avant-gardistes japonais voulurent donc construire leur liberté de pensée et de création au sein d’une société en transmutation et prise dans une effervescence politique et culturelle discordante.
C’est dans ce contexte que je me demande si les avant-gardes japonaises ne cherchaient pas inconsciemment à renouer avec la puissance imaginative des sources antiques de la mythologie japonaise, d’autant plus - nous le comprenons maintenant et nous l’avons souligné plus haut - que la force mythique ne s’oppose pas à la liberté ni à la rationalité. Les mythes déploient au cœur de nos sociétés une puissance apte à s’exercer de multiples façons. Les artistes les plus modernes, sans être religieux, y puisent inconsciemment leurs forces créatrices. Autrement dit, ils cherchent leur inspiration dans ces sources mythiques parce que celles-ci leur permettent paradoxalement de penser librement. Ce qui est en jeu, ce n’est pas telle ou telle figure mythique, mais une énergie qui fonctionne comme source abstraite, sans être identifiée à des récits exclusifs. Je tends à penser que c’est surtout de ce chant, de ce lyrisme montant des temps oubliés, que ces œuvres d’avant-garde sont imprégnées[5]. Cette libido en œuvre dans les avant-gardes japonaises s’exprime en hommage à la force vitale de la mythologie oubliée. Et c’est cette force vitale et libre qui tente de renverser la puissance oppressive de l’ordre japonais de l’époque, même si elle est beaucoup plus ancienne que ce vieil ordre persistant.
Les forces révolutionnaires politiques sont foncièrement shintoïstes. Elles s’opposaient idéologiquement au régime de shogunat d’Edo, qui cherchait sa légitimité dans la philosophie confucianiste. Mais elles s’opposaient aussi, d’une façon plus voilée, à la vision pessimiste du bouddhisme japonais, qui ne peut être un culte de la vie ni du moi en tant que sujet, puisqu’elle exige l’abolition du moi : en ce sens, aucun mouvement moderniste ne peut se réclamer du bouddhisme. Je simplifie certes excessivement, car la conscience japonaise s’est constituée dans un long cheminement mêlant des interférences de courants religieux qu’il est impossible de séparer, et que ce sont ces éléments mixtes qui ont engendré la culture japonaise tout au long de son histoire. Cela étant dit, comme le nationalisme japonais de l’ère Meiji a été porté par le shintô, on peut considérer que tout mouvement, toute pensée modernistes se sont plus ou moins nourris des éléments émotifs propres au shintô ou qui venaient de la mythologie japonaise. Par ailleurs, il ne suffit pas de dire que le modernisme a lutté contre le système féodal. Il a lutté aussi contre les visions bouddhiste et confucianiste.
2 - 3. La mythologie antique et les temps modernes au Japon
La mythologie japonaise est peu connue en Occident. Elle est essentiellement consacrée à la force et à la joie vitales. Le shintô est généralement considéré comme une religion d’ablutions, du moins de mon point de vue. Même si d’autres couches culturelles s’immiscent déjà dans ces récits, pris en compte par des hommes proches du pouvoir naissant, la mythologie japonaise est foncièrement étrangère au bouddhisme et au confucianisme. Les sources fondamentales de la poésie japonaise se trouvent dans la mythologie, surtout au niveau de la sensibilité. Toute œuvre littéraire, surtout jusqu’au XIIe siècle, trouve sa source dans les premiers textes écrits et structurés de la mythologie japonaise. Cette richesse littéraire s’est développée en particulier dans les anthologies poétiques, les journaux tenus par des femmes et les œuvres romanesques écrites en japonais également par des femmes, alors que les hommes écrivaient surtout en chinois.
Les sentiments religieux des Japonais contemporains sont ambigus, Le syncrétisme du bouddhisme et du shintô est certes socialement dominant : surtout au niveau des mœurs. Les Japonais contemporains disent n’avoir aucune religion et être athées. En fait, ils sont inconscients de l’influence complémentaire de ces deux religions : le bouddhisme et le shintô. Comme le boudou et le christianisme dans la société haïtienne.
Le shintô est essentiellement le culte de la vie. Et face à la mort, c’est au bouddhisme que les Japonais pensent. Les Japonais se sont rendus compte, dans une époque reculée, me semble-t-il, que le culte de la vie ne suffisait pas pour préciser les frontières entre la vie et la mort et assurer leur développement politique et social face à l’empire chinois. Le Japon antique a eu besoin du bouddhisme pour se rénover, consolider sa conception de la vie humaine et sociale et établir des valeurs éthiques stables. Il fallait encadrer les désirs humains pour maintenir l’ordre social et le bouddhisme a servi à introduire la notion de péché. Le bouddhisme a été un facteur social fondamental, pour réprimer les désirs humains, du fait de sa vision plutôt pessimiste du monde réel et de l’après-vie qui n’accueille que les morts qui le méritent. Quant au confucianisme chinois, qui est une philosophie politique, il a séduit très tôt le Japon qui y a puisé pour élaborer avec un certain rationalisme son système politique, économique et social.
À mon avis, dans ce contexte historique, la modernisation japonaise a pu émerger grâce à un passage révolutionnaire d’une conception aristotélicienne à une vision platonicienne. Durant ses premières années, on a vu émerger des visions cosmiques qui ne se réduisaient ni au bouddhisme, ni au confucianisme, mais évoquaient plutôt une vision nietzschéenne. Là, c’est trop rapide comment apparaissent soudain Aristote, Platon et Nietzsche comme chez Tokoku Kitamura, critique littéraire qui a écrit Sur la vie intérieure (1893). Et cette vision de l’univers dépasse largement celle du Shintô au sens étroit. C’est une vision sans frontières qui permet toutes sortes de pensées innovantes étroitement liées à la liberté des actions humaines. Si une mythologie met en scène des figures divines plus ou moins liées, elle dispose toujours de diversité et liberté latentes, parce qu’elle est intimement attachée au sacré. Or, on sait que le sacré n’est pas verbal, qu’il est irréductible à un concept ; c’est plutôt un éclat sans limite, sur lequel repose la liberté humaine fondamentale (je l’oppose à celle conçue par les philosophes de la Nature du XVIIIe). En ce sens, les Japonais antiques disposaient de la notion et de l’énergie de la liberté, même si elle n’était pas conceptualisée. Et il va sans dire que tous les Japonais ont une forte conscience de leur liberté, même s’ils sont opprimés dans chaque coin de la société comme d’ailleurs les autres peuples. Le sacré se métamorphose irrésistiblement sous diverses formes dans la mythologie japonaise des dieux, des paysages et des phénomènes naturels.
J’insiste sur l’importance de la mythologie japonaise d’autant plus qu’on a tendance à trop chercher l’esthétique japonaise dans la philosophie bouddhique. C’est négliger le génie fondamental japonais et sans doute le sceller sous une vision monochrome.
La culture japonaise est éclectique. Elle est constituée de multiples couches superposées, introduites du monde extérieur. Et ces couches peuvent se fracturer de temps en temps pour faire exploser au besoin cette vieille force vitale toujours latente.
2 - 4. La Tour du Soleil comme intégration des mouvements avant-gardistes du Japon
Comme je l’ai déjà mentionné, l’exposition « Le Japon des avant-garde » couvre les années 1910 à 1970 et l’année 1970 est marquée par l’Exposition universelle d’Osaka dont le symbole demeure la Tour du Soleil de Tarô Okamoto. Celui-ci intègre les mouvements avant-gardistes qui émergent vers 1910. Sa déclaration la plus connue demeure sans aucun doute : « l’art, c’est une explosion ». D’autre part, on connaît l’importance des études ethnographique qu’a menées l’artiste. La Tour du Soleil a échappé exceptionnellement à la démolition après l’Expo 1970. Elle a été restaurée et on peut pénétrer à l’intérieur depuis 2018.
Cette tour blanche, tachetée d’éclairs rouges en zigzag et mesurant 70 mètres de haut, ressemble à mes yeux tantôt à une étoile atterrissant sur la planète, tantôt à une bête monstrueuse s’approchant de l’humanité, ou même à un grand oiseau primitif, rapace, prêt à reprendre son vol comme un ange venu du ciel. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il s’agit là d’un monument dédié au soleil, source de toute vie. Et ce qui y est extraordinaire, c’est que cette tour, singulièrement courbée, munie de deux ailes ou bras, se présente comme un être vivant qui ne cesse de se transformer, tout en conservant sa forme originelle et fixe. Elle est dotée de trois visages du soleil, situés au sommet de la tour, qui représentent le futur, le présent (attaché au ventre de la tour) et le passé (Soleil noir dessiné sur le dos). Le visage du présent est légèrement incliné et semble défiguré, mécontent et même révolté contre un présent conflictuel et incertain, et elle suggère que le futur n’est pas forcément harmonieux comme le prétend le thème « Progrès et harmonie pour l’humanité » de l’Expo 70. À l’intérieur de ses entrailles on découvre de multiples mondes, en particulier une grande installation de « l’Arbre de la vie » qui abrite des espaces féeriques habités par des protozoaires et autres êtres vivants évoquant toute l’évolution de la vie depuis sa naissance jusqu’aux mammifères et allant vers l’avenir. À l’étage supérieur une autre installation est réservée aux hommes.
Tarô Okamoto n’est pas un homme qui pratique l’équivoque ni le compromis. Mais je crois qu’il est convaincu de puiser son inspiration dans les mêmes sources que celles du peuple. Il dit que tout le monde possède un sens artistique, qui est opprimé dans la plupart de cas. Il croit cependant qu’un artiste peut avoir le privilège de partager sa joie artistique avec le peuple, même si ce n’est pas assuré. Ses œuvres sont certes très poussées, complexes dans les détails, mais faciles aussi à saisir au premier coup d’œil.
Ce grand hommage à la vie est une sorte de conclusion de l’avant-garde japonaise. La vie est à la fois opprimée et exaltée au Japon. Elle est la force révolutionnaire de la société, mais en même temps, dans la mesure où elle bouleverse la société en s’incarnent en mouvements socioartistiques, elle est opprimée. Même le shintoïsme est une religion de l’État, prête à tordre le cou à la vie pour servir le pouvoir. Il demeure que la vie est massivement célébrée au Japon comme la valeur suprême, surtout dans la société d’après-guerre.
2 - 5. Un aperçu sur la vie de Tarô Okamoto et sur le Japon d’après-guerre que l’artiste a voulu provoquer
Tarô Okamoto est le fils d’un illustrateur-journaliste, très à la mode à l’époque, et d’une poète-romancière célèbre et lue encore aujourd’hui. Il est né en 1911, hors mariage. Car, malgré la colère familiale, sa mère Kanoko, fille très protégée d’une famille richissime, décida de vivre avec Ippei Okamoto sans se marier avec lui. Les années de 1912 à 1925, appelées « Taishô » selon le nom de l’empereur, constituent peut-être une des périodes les plus libérales du Japon, sinon au niveau du régime politique, du moins de l’esprit. On y a vu des gens beaucoup plus audacieux que les Japonais du XXIe siècle, des mouvements démocratiques très actifs, et la formation de plusieurs partis politiques. En 1925, une nouvelle loi électorale a été adoptée, permettant à tous les hommes de plus de 25 ans de voter (le suffrage féminin date de 1945). On appelle aujourd’hui cette époque « La démocratie de Taishô ». C’était aussi le début de la société de consommation. Les femmes se mirent à se coiffer dans le style européen. On vit apparaître la « modern girl de Taishô » et on s’étonna de son audace. Les premières féministes sont apparues en 1911, avec leur revue Bas bleus, dont le manifeste déclarait : « À l’origine, les femmes étaient le soleil », une allusion à la déesse du Soleil de la mythologie japonaise, qui trône au ciel.
Enfant libre, Tarô ne s’adapte pas à la vie scolaire. En 1930, sa famille décide de faire un long séjour à Paris. Sur le bateau, sa mère est accompagnée de son époux et deux assistants (à vrai dire, ses amants). Tarô restera en France plus longtemps que ses parents, jusqu’au début de la Seconde guerre mondiale. Il y suit les cours du grand sociologue Marcel Mauss, rencontre des artistes surréalistes, et surtout Picasso qui le décide à s’associer à l’avant-garde. Il aurait même été un moment membre de la revue Acéphale de Georges Bataille, qu’il connaissait bien.
Après la guerre à Tokyo, comme avant la guerre à Paris, Okamoto se consacre aux études ethnographiques, en particulier au trésor ethnique d’Okinawa ou de Ryukyu, îles occupées alors par l’armée américaine, situées au sud-Ouest de l’archipel japonais, ainsi qu’aux vielles fêtes ou danses japonaises. Il lit en même temps Mircea Eliade et s’intéresse à l’hiérophanie, ou manifestation du sacré, qu’évoque Eliade dans son Traité d’histoire des religions. Dans plusieurs textes consacrés au Japon ancien, alors que le pouvoir politique état encore d’inspiration chamanique, il analyse la relation entre l’arbre et la pierre comme un « circuit primitif de communication entre l’homme et les dieux ». Cette association du modernisme et de la « pensée primitive » est présente dans toute sa recherche artistique. On se contentera de relever : Homme Arbre (peinture à huile, 1951), Mythe du Soleil (mosaïque, 1952), Le Saut secret (peinture à huile, 1963), Je suis au ciel (peinture à huile, 1967), Mythe de Demain (peinture à huile, 1968), Esprit d’arbre (peinture au pistolet 1970), Soleil et Lune (1975, peinture murale et au pistolet, 1975).
Pour prendre la mesure de ses positions politique et artistique, il faut bien comprendre la société d’après-guerre où il a vécu. La guerre, et l’épuisement extrême des ressources nationales à tous les niveaux ont déclenché un renversement des valeurs et un changement profond de la mentalité populaire. On s’indigne de cette perte massive de jeunes hommes due à la guerre et aux attaques suicidaires des kamikazes. Cette tragédie irréparable fait redécouvrir par les Japonais la valeur incommensurable de la vie humaine. Si le sacrifice de la vie humaine en l’honneur de l’empereur a été exalté durant la guerre, désormais c’est le respect de la vie qui devient une valeur inviolable dans la société d’après-guerre. En témoignent maintes œuvres et récits liés aux expériences de la guerre. On associe désormais la démocratie d’après-guerre à la valeur de vie. Si la droite politique n’a pas réussi jusqu’à aujourd’hui à obtenir une modification de la constitution pacifiste du Japon et de son renoncement à toute guerre, promulgué en 1947, c’est parce que la mentalité pacifiste des Japonais est profondément enracinée dans cette société traumatisée. Tarô Okamoto s’est toujours tenu à l’écart de la politique. Il n’en est pas moins vrai que laTour du Soleil est un des symboles de cette démocratie, dont la valeur suprême est la vie humaine ; elle se veut donc emblématique de la vie, devenue le symbole idéologique très caractéristique de la société japonaise d’après-guerre.
Mais l’œuvre de l’artiste qui a dit : « l’art, c’est une explosion », ne peut pas être un simple hymne à la paix et à la vie ; elle exprime un ensemble d’oppositions et conflits qui dépassent le cadre ordinaire du modernisme. Sur la base de ses études ethnographiques, Tarô Okamoto mêle les revendications les plus modernes aux valeurs les plus anciennes, de sorte que la culture traditionnelle n’est plus en opposition avec l’esprit moderne. Il le dit dans son texte intitulé Ce qui est en jeu à l’exposition universelle (1971) : « Pour la plupart des Japonais, il n’y a que deux valeurs principales : le modernisme occidental et le traditionalisme qui s’y oppose. J’ai exclu ces deux concepts pour créer un espace immense, et la Tour du Soleil trône au milieu »[6]. Ces mots expliquent bien l’espace artistique qu’il a voulu créer : c’est un espace ouvert aux temps les plus reculés ainsi qu’aux futurs qui se dessinent dans le présent. Et il semble dès lors que la notion d’origine n’a plus de sens, car une origine vient d’origines antérieures, qui viennent du fonds de la nuit préhistorique et en-deçà de l’humanité d’autres êtres vivants.
À cela s’ajoute qu’Okamoto est l’un des premiers ethnographes à s’être sérieusement intéressés aux céramiques de la période Jomon. Jo signifie « cordes » ; mon « lettres » ou « dessin ». Cette période préhistorique se caractérise par une céramique typique à décor par impression de cordes. Ce qui saute aux yeux, c’est que cette céramique est fabriquée selon une esthétique très différente de celles qui suivirent. La poterie est surchargée de cordons en anneaux superposés. Qui sont ces Japonais qui fabriquaient des poteries décoratives ? On en connaît peu de choses.
3. Mythologie japonaise, monde renversé ou monde universellement ouvert ?
La vision occidentale du Japon a une racine profonde. Elle remonte à Marco Polo mais aussi à cette image de « monde renversé » introduite par Toscanelli et Las Casas à travers Christophe Colomb. Les Occidentaux ont encore tendance de considérer le Japon comme appartenant à un « monde renversé ». De plus Hegel affirmait que les pays asiatiques étaient de sociétés stagnantes. De toute façon, les Occidentaux peuvent imaginer que le Japon est un « monde renversé » puisqu’il est à l’antipode de l’Occident. L’imaginaire a la vie dure. Il faudrait analyser plus amplement cet imaginaire développé en Occident vis-à-vis de l’Orient. Est-ce pour cela que le Japon semble encore quelque peu schizophrénique ? Par exemple, comment peut-on expliquer le succès du Japon technologique alors qu’il conserve si jalousement, comme on le croit très souvent, ses traditions anciennes. Mon point de vue est le suivant : s’il a réussi à se moderniser, c’est parce que le Japon le plus archaïque contenait dès le début des éléments permettant d’évoluer à travers les siècles sans rencontrer aucun obstacle infranchissable, et par exemple de développer les sciences et les technologies dont les Japonais d’aujourd’hui sont fiers. Nous pourrions poser cette même question dans le domaine artistique. Évoquant la métamorphose du Japon millénaire, pourrait-on en déduire que les éléments culturels les plus anciens influencent encore aujourd’hui les aspects les plus avant-gardistes des arts contemporains ? Je me pose cette question pour tenter de discerner quels sont les courants permanents qui traversent le Japon moderne au milieu de tendances si multiples ? Ma démarche peut paraître contradictoire, parce que j’ai contesté tout au début de ce texte l’idée d’un « Japon éternel ». Ce que je voudrais démontrer, c’est que les mouvements les plus avancés du Japon moderne ne sont possible que grâce aux valeurs du Japon le plus ancien ; et je crois donc que c’est la mythologie japonaise qui nous donnera la clé de ce paradoxe.
L’histoire socioculturelle du Japon peut être considérée de ce point de vue comme une longue juxtaposition d’éléments importés de l’extérieur et que le Japon s’est appropriés grâce à la pensée mythologique de ses origines, celle qui raconte la création de l’archipel japonais et les gestes de ses dieux et héros. Le monde mythique japonais est rempli de récits extravagants, insolites, tissés par les désirs humains et l’amour. J’y découvre les Japonais antiques créatifs et d’autant plus singuliers en raison de la liberté de leur imagination.
3 - 1. Quelques récits mythologiques du Japon
Pour décrire brièvement les caractéristiques de la mythologie japonaise, je vais privilégier le mythe d’Izanagi et Izanami, frère et sœur incestueux. Ce qui est excentrique chez ce couple divin, envoyé du ciel dans le but de créer le Japon au milieu de la mer, c’est qu’il enfante des îles et d’autres dieux ou esprits représentant des phénomènes naturels (pluies, vents, brouillards, vagues entre autres). Izanami enfante finalement le dieu du feu, par qui elle se fait brûler les organes génitaux et elle en meurt.
Son frère Izanagi, tellement affligé, descend en pleurant dans le pays des morts pour la ramener sur terre. Sa sœur accepte de remonter à la surface de la terre ; mais le frère viole l’interdiction qu’elle lui a imposée. En perçant une porte avec une aiguille rougie au feu, il regarde à l’intérieur et y voit dans l’ombre le cadavre pourri de sa sœur, rongé par des vers et sur lequel dansent des éclairs-démons. Effrayé, il s’enfuit, mais sa sœur, réveillée, le fait poursuivre par des sorcières jusqu’à ce qu’il réussisse à arrêter leur poursuite en leur lançant une grande roche. Izanami, redevenue elle-même, déclare par rancune qu’elle tuera tous les jours milles êtres humains. Son frère Izanagi, riposte en lui annonçant qu’il fera naître tous les jours mille cinq cents êtres humains. C’est le moment symbolique de la grande division entre le monde des vivants et celui des morts.
Rentré, Izanagi purifie son corps en se lavant dans une rivière. Et quand il s’essuie l’œil droit, naît de cet œil la déesse du Soleil, Amaterasu-Ômi-kami (le mot « kami » peut se traduire par dieu). Mais il faut reconnaître que la notion de kami japonais est fort différente de celle de dieu occidental. Les kamis japonais peuvent mourir. Izanagi lui ordonne d’aller trôner au royaume du ciel. Cette déesse du Soleil s’installe ainsi sur le territoire céleste comme la première des kamis japonais. Il faut savoir aussi que ces kamis mythiques sont vénérés dans des temples shintô dédiés à chacun d’eux, Le culte de la déesse du soleil, Amaterasu-Ômi-kami se célèbre dans le temple appelé « Ise », sans doute le plus important temple shintô, construit dans la péninsule de Kii.
Le dernier récit que je tiens à évoquer est celui d’une grande éclipse produite par la déesse du Soleil Amaterasu. Elle ne supportait plus Suanoo, son frère, dieu de la mer et du vent. Celui-ci, jaloux, monte au ciel pour détruire la rizière de sa sœur et lui fait subir des dégâts de plus en plus graves. Amaterasu, dont le nom signifie qu’elle éclaire le ciel, s’enferme alors dans une caverne du ciel, ce qui entraîne la disparition de la lumière sur terre et dans le ciel. Les huit cents dieux du ciel se réunissent alors pour trouver le moyen de la faire sortir de la caverne et une déesse se met à exécuter une danse lascive qui fait éclater de rire les dieux. Intriguée, la déesse du Soleil sort de la caverne pour voir ce qui se passe dehors. Et c’est ainsi les rayons solaires réapparaissent dans le ciel et sur la terre. Une des fêtes les plus anciennes, appelée « Kagura » (littéralement, « musique ou joie divine ») et qui se célèbre encore aujourd’hui dans divers villages ou villes du pays remonte, dit-on, à cette éclipse momentanée d’Amaterasu-Ômi-kami.
Pleine de scènes obscènes et comiques, la mythologie japonaise ne connaît pas la décence ni la pudeur. En un mot, elle est très humaine, avec une grande liberté d’imagination. Ce qui nous frappe dans ce récit d’Izanagi et Izanami, c’est le grand amour qui les unit pour enfanter l’archipel du Japon. Leur dialogue d’amour fait dire à Izanami : « Quel bel homme! » et à Izanagi : « Quelle belle femme! ». Quelques détails donnent à penser que la femme n’est pas complètement l’égale de l’homme. Dans une conférence qu’on m’a un jour demandé de donner à Paris, j’ai abordé ce récit d’amour mythique. Et lorsqu’on me l’a fait remarquer, j’ai été très étonné par l’anachronisme de cette remarque. Est-ce qu’on reproche à Jupiter d’abuser des femmes ? Au fond, Izanagi aborde son épouse avec beaucoup plus de respect et d’admiration. Tous deux se comportent le plus souvent d’égal à égal dans leur amour.
Ce sur quoi je voudrais pour finir attirer l’attention, c’est qu’on découvre dans ces récits mythiques un autre Japon. Ces expressions « spontanées » contrastent avec l’esthétique dite « traditionnelle » du Japon. D’ailleurs le Kojiki dit que le premier poème est lu par Suanoo, frère d’Amaterasu, quand il s’est marié avec une de ses sœurs qu’il a sauvées, en tuant un grand serpent python qui venait les dévorer. C’est donc un poème de joie, d’amour. Le point de départ de la littérature japonaise est là.
Si on me le permettait, je voudrais dire qu’on y trouve un esprit libre et fécond, à une époque où les contraintes sociales étaient moins fortes. Il est très important que les Japonais aient su créer à l’aube de leur histoire ce monde mythique. Ce qui y compte, ce ne sont évidemment pas telle ou telle figure, mais la source d’énergie et de vie d’où émerge spontanément l’élévation de l’esprit. Et dès l’origine, ce mouvement libre a toujours su finalement, lorsque nécessaire, faire évoluer la société japonaise, sa culture et son art.
Notes
[1] Exposition au Centre Georges Pompidou en partenariat avec la Fondation du Japon et avec le concours du quotidien Asani, du 11 décembre 1986 au 2 mars 19867. Catalogue Japon des avant-garde 1910-1970, sous la direction de Françoise Bonnefoy, Centre Georges Pompidou, Paris, 1986, 543pages.
[2] Ibid., p.68.
[3] Ibid., p.85.
[4] Ibid., p.108.
[5] À ce sujet, Shuji Takashina souligne le caractère lyrique de l’avant-garde japonaise à propos de Harue Koga et Yasunari Kawabata qui se ressemblent selon lui. Harue Koga est célèbre surtout pour ce tableau intitulé la Mer (1929, p.113 dans le catalogue). La composition du tableau incluant des machines modernes et une femme en maillot de bain, a fortement frappé l’attention du public. Takashina le dit : « Pour nous, ce qui fait l’attrait de ces tableaux, c’est essentiellement ce lyrisme limpide et un peu singulier, qu’on retrouve aussi dans les œuvres de Kawabata, et qui est peut-être une des " constantes " de la sensibilité japonaise ». (Shuji Takashina, « Introduction » in Japon des avant-gardes 1910-1970, p.27. Takashina dit que « ce lyrisme limpide et un peu singulier » coule dans les veines des modernistes japonais. Je découvre donc que nos points de vue ne sont pas très éloignés, encore que ce soit dans les traditions bouddhiques que Takashina cherche la source de ce lyrisme, tandis que je considère qu’il provient de sources plus anciennes. A vrai dire, sur le plan culturel, le bouddhisme et le shintô se mélange tellement et ont tellement évolué ensemble qu’il n’est pas facile de distinguer les éléments bouddhiques des shintoïstes, mais je crois que le lyrisme archétypique vient du shintô.
[6] Tarô Okamoto, « Bankokuhaku ni kaketa mono », Nihon Bankokuhaku kenchiku, zōkeï, Kanbunsha, 1971. Cité par Hidenori Sasaki, Influence de Marcea Eliade sur Tarô Okamoto. The Japanese Society for Aesthetics Aesthetics, No.18 (2014) : p. 38-52.