Philosophe et artiste multimédia, de nationalité française et canadienne, son travail a été présenté dans de nombreux musées internationaux et biennales; fondateur et président de la Société Internationale de Mythanalyse (Montréal, Québec-Canada); directeur de l’Observatoire international du numérique, Université du Québec ; ancien élève de l'École Normale Supérieure, pendant de nombreuses années il a enseigné la Sociologie de la culture et de la communication à la Sorbonne, et il a aussi été professeur à l'École Nationale Supérieure des Arts décoratifs.
Abstract
L'art a pu être une célébration ou un divertissement pour les fêtes aristocratiques, bourgeoises ou populaires. Mais dans les sociétés « premières », c'était avant tout un rituel sacré multimédia de solidarité tribale et de communication avec les esprits. Des règles strictes excluaient toute esbroufe ou tricherie. C'est demeuré vrai dans l'art iconique religieux. Mais depuis l'exposition à Paris en 1882 des Arts incohérents, le mouvement Dada et l'Urinoir de Marcel Duchamp en 1917, c'est la liberté d'expression de l'art qui est devenue sacrée. Et plus que jamais individualiste. Cette liberté inclut depuis Les horreurs de la guerre de Goya et les gravures des caricaturistes à la Daumier au XIXe siècle un droit de contestation sociale qui était exclu par le statut traditionnel de courtisans des artistes en quête de commandes pour créer. Aujourd'hui, les arts visuels se partagent entre l'art ordinaire des galeries commerciales touristiques, l'art des artistes audacieux sans galerie ni marché pour assurer leur subsistance, et l'art comme produit financier de spéculation des courtisans du capitalisme au pouvoir. C'est à partir de ce constat désolant qu'on pourra comprendre les propos qui suivent.

Rojo (Rouge) peinture spray sur bâche industrielle, 353x253cm, 2019, donation au MSSA, Museo Salvador Allende de la Solidaridad, Santiago du Chili, par solidarité avec la révolte chilienne dans les rues de Santiago en octobre 2019, exposée sur la façade du MSSA en commémoration du coup d’État du 11 septembre 1973 (photo MSSA).
L’art a toujours reflété l’évolution de la société, instrumentalisé par le pouvoir du moment, magique, religieux, militaire, dictatorial, royal, bourgeois, communiste, et maintenant capitaliste et consumériste. Nous notons bien quelques exceptions notables d’artistes s’intéressant au petit peuple, peignant des célébrations villageoises hollandaises, des paysans, et même dénonçant les horreurs de la guerre. Mais soyons clairs, ce thème du monde ordinaire ou en souffrance est longtemps demeuré très marginal. Ce n’est qu’au XIXe siècle, et en Occident seulement, que simultanément au triomphe institutionnel de l’art néo-classique promu par la bourgeoisie capitaliste montante, l’art a osé devenir contestataire, principalement avec les caricaturistes des journaux politiques, tels Daumier, Gavarni, André Gill. Et c’est alors aussi que des peintres impressionnistes, du moins quelques-uns d’entre eux, qu’on compte sur les doigts d’une seule main, sont devenus anarchistes ou communards, tel Pissarro, Signac, le critique d’art Félix Fénéon, Henri-Edmond Cross et surtout Courbet. Il a fallu attendre « le pot de peinture jeté à la face des bourgeois » des peintres fauvistes, les provocations politiquement très diverses des futuristes italiens, le mouvement Dada dénonçant les horreurs de la première guerre mondiale et son hypocrisie, la célébration du monde ouvrier par Fernand Léger, les photomontages de John Heartfield, les dénonciateurs allemands de la bourgeoisie et de la guerre, Otto Dix, George Grosz ou encore Max Beckmann, le Guernica de Picasso, pour que le vent tourne, et occasionnellement seulement.
Au lendemain de la seconde guerre mondiale nous avons vu émerger aussi quelques artistes anticonformistes, libertaires, comme les peintres du mouvement Cobra, de la Beat Generation face à la guerre du Vietnam, plusieurs artistes de Fluxus, notamment George Maciunas et George Brecht. Mais nous avons surtout assisté au triomphe financier international du Pop art américain d’Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Jasper Johns, George Segal, Claes Oldenburg, qui ont célébré la société de consommation. Certains, il est vrai, se sont engagés selon des convictions simplement éthiques, voire politiques, souvent en adhésion avec le parti communiste, tandis que paradoxalement d’autres, derrière le Rideau de fer, tentaient de critiquer clandestinement le régime soviétique et de survivre. On pense à la « coopérative d’artistes toxiques » en France, Les Malassis, Henri Cueco, Lucien Fleury, Jean Claude Latil, Michel Parré, Gérard Tisserand et Christian Zeimert sous l’ère pompidolienne, à Art Language en Grande-Bretagne, à Serge Pey au Chili, à Felipe Ehrenberg au Mexique, au photographe sud-africain dénonciateur de l’apartheid David Goldblatt, à la Franco-Polonaise Lea Lublin, à Nil Yalter, (Turquie et France), à la Brésilienne Lygia Clark, à l’Australien Gordon Bennett qui remettait en question les stéréotypes raciaux et valorisait la culture aborigène, aux artistes indiennes Nalini Malani et Shilpa Gupta, aux affichistes situationnistes de Mai 68, tous attachés à dénoncer le fascisme, le racisme, le machisme, les abus du pouvoir capitaliste, impérialiste, colonialiste, macro-médiatique, et le conformisme idéologique. On pense à Gérard Fromanger[2], à Joan Rabascall qui a fui le franquisme, aux innombrables poètes visuels sonores, spatialistes contestataires ou subversifs, notamment Julien Blaine, Jean-François Bory, aux poètes de la revue Attaques, incluant ceux d’Amérique latine et du monde arabe.

Les chemins de la démocratie sont parfois douloureux, acrylique sur toile, 92x92cm, 2018.
Bref, nous avons bien vu des artistes contestataires déclarés de « l’ordre des choses ». Mais ces artistes, toujours minoritaires, souvent demeurés peu connus, ont-ils seulement reflété les scandales et les horreurs du monde ? Ou ont-ils contribué à changer ce monde ? L’artiste chinois contestataire Ai Weiwei changera-t-il la Chine ? La question se pose et la réponse ne semble pas pencher immédiatement du côté d’une quelconque efficacité. Le capitalisme a manifestement la capacité de récupérer comme des marchandises et de négocier à grand prix les œuvres le plus contestataires, incluant les boîtes de « merde d’artiste » de Manzoni, une affiche de Mai 68, ou une banane scotchée sur une cimaise de Maurizio Cattelan (encore un Italien). C’est ce « Market Art »[3] que j’ai dénoncé dans un livre éponyme. Nous avons vu des artistes comme Jeff Koons, les Takashi Nakamura et Murakami célébrer sans retenue le capitalisme de spéculation financière, de consommation et de divertissement souvent infantile, comme d’autres avant eux ont célébré Dieu ou Louis XIV, la révolution industrielle (les Futuristes), ou la révolution communiste (les Constructivistes), mais, quant à eux, en héros du capitalisme néo-libéral débridé, avec évidemment un succès financier mondial. Ils relèvent de l’art instrumentalisé par le capitalisme conquérant qui a écrit l’histoire de l’art moderne et contemporain et régi son marché de haute spéculation sous la férule des grandes galeries américaines. Ce ne sont certainement pas ces stars du marché de l’art d’aujourd’hui qui changeront le monde. Nous devons certes beaucoup de chefs d’œuvres, dans tous les moments de l’histoire de l’art à cette soumission qui n’a rien de nouveau, quelles qu’aient été les civilisations. Laurent Cauwet en analyse la déclinaison actuelle[4].
Mais ce dont nous voulons parler ici est beaucoup plus puissant et remarquable que ce lien générique de l’art qui se conforme à la société dominante de son temps, ou qui s’y oppose terme à terme, sans regarder ailleurs. Ce qui nous intéresse ici, au-delà de ces célébrations et de ces frictions, c’est l’art qui diverge fondamentalement. Car c’est alors, qu’il peut changer le monde. Et nous ne parlons pas ici seulement d’évidences. Certes, l’impressionnisme a changé notre perception de la nature ; on en dira autant de la photographie ou du cinéma. Il s’agit pour nous de changements beaucoup plus radicaux. Revenons aux impressionnistes. Ce n’est pas par des postures politiques, mais en adoptant la peinture de plein air qu’ils ont changé l’histoire de l’Occident. Certes, ils étaient, à cause de cela, honnis par la bourgeoisie au pouvoir, mais ils n’avaient pourtant, pour la plupart, pas de conscience politique marquée, nous l’avons souligné, encore moins d’engagements militants. Même si beaucoup d’entre eux ont vécu dans la misère, ce fut sans se révolter. Sortant des ateliers traditionnels, ils ont changé radicalement notre sensibilité non seulement à la nature, mais au monde rural, celui des paysans dans les champs, des mangeurs de pommes de terre, des lavandières et, dès lors aussi au monde ouvrier, celui des repasseuses de linge, des raboteurs de parquet, des pêcheurs. Ils nous ont obligés à regarder et prendre en considération le monde pauvre, inexistant dans la culture dominante, aristocratique, puis bourgeoise.
Dans un autre ordre d’idées, mais tout aussi fondamental, les peintres cubistes ont renouvelé notre conception de l’espace-temps et annoncé par leur manière de recomposer et synthétiser notre relation aux objets comme aux visages, ce que nous avons depuis appelé la phénoménologie. Une révolution copernicienne dans notre rapport au monde, qui se décline aujourd’hui jusque dans la mécanique quantique. Nous savons que l’influence des peintres surréalistes et des peintres abstraits n’a pas tenu aux engagements politiques incohérents d’André Breton, ou à l’affabulation freudienne d’un hypothétique « inconscient », mais à l’exploration audacieuse du monde onirique de nos rêves et de nos folies, que nous considérions jadis comme des messages initiatiques des esprits ou des dieux, et depuis comme des aberrations, un monde lui aussi, inexistant, si ce n’est comme un aspect pathologique du monde normal, mais qui pourtant est désormais le monde alternatif de notre vie psychique, qui détermine notre conscience du monde autant, si non plus, que l’économie ou les technologies numériques. À son tour et tout à l’opposé, le ready made duchampien a changé le rapport au monde des artistes du XXe siècle, puis maintenant de tout un chacun, en le relativisant et en le conceptualisant radicalement. Tandis que les provocations des futuristes italiens ou les enthousiasmes communistes du constructivisme russe n’ont fait qu’accompagner le monde qui changeait, refléter son évolution technologique, politique, sociologique.
Soyons donc ici bien clairs : l’art ne change pas souvent le monde. Bien au contraire, il l’a représenté selon le pouvoir en place pendant des millénaires et il reflète encore aujourd’hui les excès du capitalisme tout aussi bien – ou mal - que l’émergence des technologies numériques.
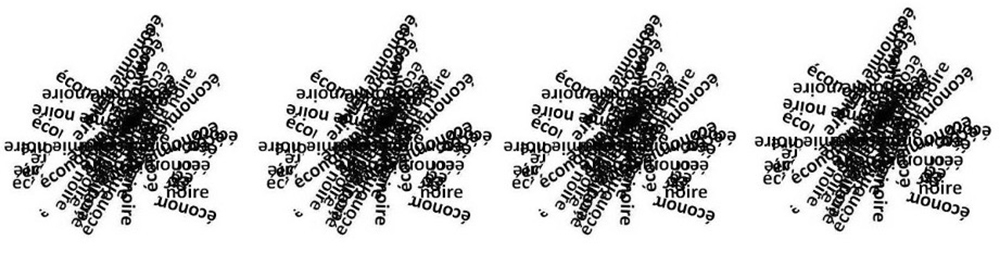
Tweet art, 2011.
Mais nous constatons que lorsqu’il a divergé en imposant une nouvelle sensibilité impressionniste de la nature et de la société, le regard phénoménologique cubiste, l’alternative onirique surréaliste, l’analyse conceptualiste duchampienne, il l’a changé profondément. Et toute divergence n’est pas a priori un progrès. Une divergence répond à une saturation des idées, un immobilisme ou un conservatisme toxique.Et ses effets peuvent être positifs, néfastes, ou souvent ambivalents. Ainsi, le mouvement Fluxus a constitué l'une des récentes divergences de l’art. En se banalisant, en se dématérialisant, et en s’effaçant lui-même l’art en est venu à célébrer la vie et la nature. Nous lui devons beaucoup : l’art a esthétisé le monde, ses bruits, ses silences, ses petites sensations, ses gestes quotidiens, la beauté de la vie ordinaire et même sa misère. Ce fut, dans la foulée de l’impressionnisme, une nouvelle étape de notre sensibilité au monde. Bravo. Mais jusqu’à devenir « gazeux » et invisible, comme l’a souligné Yves Michaud. Et là, la divergence nous a fourvoyé. Car l’art, ainsi désacralisé, banalisé dans le vécu, s’évapore dans l’air, ou se noie comme le poisson dans l’eau. Illusion, simulacre, mirage, naïveté, accomplissement utopique ou suicide de l’art dans sa quête de simplicité ontologique ? Qu’importe le qualificatif de ce qui n’est plus. Après la fin de l’Histoire de l’art avant-gardiste qui se mordait la queue avec exacerbation jusqu’à plus faim, c’était l’effacement de tout langage différentiel de l’art, en perte irrémédiable de conscience de lui-même et a fortiori de toute posture critique. En se dissolvant dans la réalité il perdait tout pouvoir de la changer. L’art demeure nécessairement un langage qui exige son autonomie symbolique pour représenter la réalité et pour y agir. « Ici, on ne copie pas », aurait dit Gauguin à Pissaro qui voulait exposer des paysages. Il avait totalement raison. Cela n’a pas empêché Duchamp d’exposer l’original de la réalité la plus triviale qu’il ait trouvée, l’urinoir, et de catalyser ce renversement du rapport de l’art à la réalité, qui plus encore qu’esthétique est fondamentalement mental. C’est le mental qui programme la perception, ce que l’on voit et ce qu’on ne voit pas, la sensibilité et l’esthétique, comme l’a analysé la phénoménologie. Et c’est la société qui programme le mental. Duchamp l’a compris et c’est pour cela qu’il est devenu le symbole d’une divergence civilisationnelle irréversible. Il a changé le monde occidental. Il a été à mes yeux le premier artiste « sociologique » de l’histoire de l’art.
Peu importe l’appellation d’art sociologue que je me suis donnée au début des années 1970, tout simplement parce que j’enseignais la sociologie de l’art et fus de ce fait contraint de me demander ce que pourrait être un art (théorie et pratique) qui tiendrait compte de cette sociologie que j’enseignais. Les interrogations de ce que j’ai donc appelé l’art sociologique ont été abordées diversement et sous diverses dénominations selon les moments politiques et les contextes sociaux. Le contraire aurait été une contradiction en soi. Je me dois de rappeler ici avec insistance la situation désespérante des artistes des pays sous dictature en Amérique latine et en Europe communiste, communiquant marginalement entre eux et avec les artistes des démocraties occidentales pour survivre comme citoyens libres et comme artistes. Les réseaux sociaux n’existaient pas encore et ils ont recouru à la poste pour échapper à la censure et communiquer à distance, dans la foulée de Dada et de Fluxus, avec des objets dérisoires, des tampons d’artistes parodiant les institutions officielles, usant de la litote souvent, ne serait-ce que pour dire : « j’existe ». J’en étais et j’ai documenté ces échanges dans une anthologie[5].

Stamp your emails, posts and drops, une feuille de timbres-poste planétaires.
Le concept d’art sociologique n’est qu’un mot-outil générique : faussement déclaré conceptuel en Amérique du Sud, contextuel avec résignation en Pologne communiste, dada ou fluxus au Canada avec Anna Banana ou Mr. Peanut, marginal, périphériste, art-action ou actionnisme, artiviste, engagé, politique ou sans nom dans bien des démarches pourtant significatives. Mais il faut nommer aussi, dans l’Occident libre, des artistes aussi pionniers et engagés dans ce questionnement sociologique que Hans Haacke, Antonio Muntadas, Urs Jeaggi, Joseph Beuys, Gustav Metzger, Wolf Vostell, Klaus Staeck, Adrian Piper, André Cadéré, John Latham ; face aux dictatures latino-américaines Clemente Padin, Guillermo Deisler, le groupe de Rosario (Tucumán arde), Horacio Zabala, Carlos Altamirano, et les artistes du réseau RedCSur ; les Québécois Denys Tremblay, Dominique Blain ; en Europe de l’Est sous la chape communiste, des artistes clandestins, tel Giorgy Galantai, archivés par Artpool avec le soutien incessant de Julia Klaniczay à Budapest, Jan Swidinski en Pologne; les artistes du body art, Michel Journiac et Gina Pane, qui considéraient que le corps est sociologique ; des artistes pionniers des arts de la rue, Jean-Michel Basquiat, Ernest Pignon-Ernest, Keith Haring, du street art tels Jef Aérosol, Shepard, Fairey, Adrian Doyle et les Blenders Studios de Melbourne ou le populiste Bansky ; l’artiviste urbain JR, des graffeurs éthiquement engagés comme le collectif RBS Crew au Sénégal.
Le Centre Pompidou a réuni à l’automne 2020 sous le titre Globale résistance et en lien avec le thème Black Lives Matter les œuvres de plus d’une soixantaine d’artistes, réunies au cours de la dernière décennie, dont une majorité issues des Suds (Afrique, Moyen-Orient, Asie, Amérique latine), et se donnant pour ambition d’examiner les stratégies contemporaines de résistance. « Global(e) Resistance pose également des interrogations théoriques, qui vont de l’articulation de l’esthétique et du politique au rapport même du musée au politique, au sein des mondes de l’art ». C’est sans compter le Tunisen Wadi Mhiri qui dénonce le mépris de l’islam pour les femmes dans son œuvre « Jihad Annikah » (le Jihad du sexe), ceux qu’inévitablement j’oublie, ceux que je ne connais pas, passés ou présents. J’en découvre sans cesse de nouveaux, témoignant souvent haut et fort de leur malaise social. Tous nous avons pris conscience du pouvoir de nos sociétés par rapport à l’art et tous nous avons tenté de le questionner, de le critiquer, de le subvertir, d’y échapper ou de le changer. D’où mon choix pour cette publication de ce titre générique, minimal commun dénominateur : Art versus SOCIÉTÉ.
Lorsque je critique dans mon Manifeste pour un art actuel le « n’importe quoi en art », ce n’est pas sa matière triviale ou la désacralisation de l’art que je conteste, mais son propos trop souvent insignifiant. Un ticket d’autobus, un débris de plastique, un ventilateur, un geste peuvent devenir de l’art aussi bien qu’une image ou un son. L’art peut s’exprimer avec n’importe quoi, de la terre, même de la poussière, mais pas n’importe comment. Car il est mental. Même et surtout lorsqu’il s’exprime avec un objet banal ou sans objet, avec un simple concept, un regard, l’art exige une puissance d’expression, que ce soit par la litote, la métaphore, le point d’interrogation ou en forçant le trait. Et c’est précisément pour cette raison, quoi qu’on en ait pu dire négativement par timidité ou par résignation, qu’il peut changer le monde. Certes, pas de la même manière globale que la maîtrise du feu, la Révolution française, la machine à vapeur, le colonialisme, le nucléaire, une guerre mondiale, le capitalisme, le communisme ou le numérique. Pas de la même manière que des hommes et des femmes qui avec des idées et des attitudes de vie, ont changé le monde, en bien ou en mal, tels Bouddha, le Christ, Luther, Gandhi, Mandela, tels Alexandre le Grand, Catherine II de Russie, Napoléon, Hitler, Churchill, Staline, tels Pasteur ou Edison, Einstein, Marie Curie ou Alan Turing. L’art n’a jamais eu le pouvoir de s’imposer lui-même. Mais il peut célébrer, comme il le fit pendant des millénaires, et désormais aussi contester et dénoncer, ce qui est nouveau. Car on dit qu’il est une création esthétique, mais même dans l’émotion visuelle ou sonore, son fondement est mental. Il est conscience, une conscience capable de se questionner, non seulement elle-même, mais aussi la société qu’elle déchiffre et l’image du monde qu’elle met en scène, qu’elle questionne ou qu’elle veut changer.

Tweet art, 2014.
Ce manifeste et cette publication, ne seront peut-être qu’un témoignage marginal ; mais une démarche interrogative, qu’elle soit artistique, gestuelle ou textuelle, importante, ou naïve et vouée à l’échec, est nécessairement philosophique, et aujourd’hui éthique. Quel que soit son questionnement, elle célèbre la liberté d’expression. Mais toute démarche éthique a aussi vocation à l’universalisme si elle est fondée sur le respect des droits fondamentaux de l’homme, incluant le droit irrépressible à la différence, aussi longtemps que celle-ci - j’y insiste - n’entre pas en contradiction avec le respect des autres droits universels de l’homme. Bien des lecteurs rapides sautent sur leur pistolet pour dénoncer toute évocation de l’universalisme, et croient faire mouche en grinçant des dents. Ils ne voient pas à quel point l’universalisme que je nomme n’est que celui, moins que minimaliste, des droits humains fondamentaux. Dans le détail, où se cacherait toujours le diable dont ils font argument, je dis bien que l’eau potable n’est pas la même partout, que le toit peut être de tuiles, de tôle, de ciment ou de paille, que la liberté d’expression s’exerce dans des milliers de langues diverses. Mais il faut universellement que chaque être humain ait un toit pour se protéger, de l’eau potable, la liberté d’expression. Sont-ils contre l’universalisme de ces droits fondamentaux ? Je ne le crois pas. Et leur objection est sans objet. Je n’écris pas en diagonale. Il ne faut pas me lire en diagonale.
La crise planétaire actuelle exige à nouveau ce questionnement philosophique sur nos valeurs et le sens que nous pouvons donner à l’aventure humaine. L’art continuera certainement et majoritairement à célébrer le monde des puissants, même les plus toxiques, comme il l’a fait pendant des millénaires. Mais il peut aussi contester les dérives perverses des pouvoirs du moment et prioriser le respect fondamental de l’Homme. Et c’est ce qu’il a commencé à faire depuis le XIXe siècle. C‘est là un fait incontestable, même s’il demeure encore exceptionnel. L’art a un lien incontournable avec l’évolution de chaque société. Il n’y a pas de progrès en art, mais l’art change le monde. Il doit changer le monde. Il le faut, c’est urgent.

Timbre pour la poste email, 2020.
Et il doit décider aujourd’hui de diverger alors que la planète va mal et que la majorité de l’humanité en prend conscience et s’interroge. Chaque artiste décide librement des options de sa création et assume son choix, festif, ludique, égotique, libertaire, commercial, critique, subversif. Selon moi les enjeux les plus importants de l’art aujourd’hui ne sont plus d’ordre esthétique : ils sont devenus avant tout philosophiques et éthiques pour imaginer et créer le monde de demain. Et c’est bien la liberté du philosophe, au-delà du questionnement, de prendre position, et de l’artiste de rêver, malgré toutes les objections des réalistes, des esprits conformistes, des prophètes de malheur, d’évoquer et de revendiquer une nouvelle sensibilité éthique et planétaire. Personne n’est mort d’avoir assisté au ridicule puis au triomphe planétaire de l’impressionnisme. Et contre les entropistes intelligents et réalistes, il est permis de se déclarer néguentropiste.

L’art change le monde, acrylique sur toile, 61x122cmn, 2018.
Une éthique planétaire
L’hyperhumanisme n’est-il qu’une naïveté ? J’entends les critiques immédiates. Ce n’est pas avec des bons sentiments qu’on fait de la bonne littérature écrivait Gide. Mais ce sont les « bons sentiments » de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King et de Nelson Mandela, qui ont révolutionné sans violence des sociétés dont le scandale était permanant. On les prenait pour des utopistes ou des ennemis de l’ordre établi. Pourtant, c’est avec des paroles pacifiques et optimistes, que Gandhi, King et Mandela ont fait imploser la logique cynique et implacable des réalistes du pouvoir, des business as usual, et ont contribué extraordinairement au progrès humain collectif en exigeant le respect des droits humains universels. Pourquoi faudrait-il considérer ces trois penseurs engagés comme des exceptions, qu’on ne reverra pas de sitôt ? Pourquoi, ne serait-ce pas cette fois non pas le colonialisme ou le racisme endogènes, mais la catastrophe mondiale de cette pandémie qui enclencherait une nouvelle divergence : la nécessité de changer de récit et de créer le mythe hyperhumaniste d’une éthique planétaire ?
Bien entendu, nul ne viendra à bout de l’hybris humaine qui sévit depuis toujours, de cet instinct de puissance aujourd’hui suractivé par le numérique, que j’ai appelé CyberProméthée, s’ajoutant aux deux instincts freudiens Éros et Thanatos[6]. Ce qu’on a appelé « la part maudite » de l’humanité ne s’évaporera pas dans l’air du ciel et continuera à ressurgir à chaque occasion ténébreuse. Il s’agit là sans doute de la tension même de la vie. Mais je parle de ce respect des droits de l’homme, maintes fois déclaré universel, que personne ne peut rationnellement contester, qui a pour but précisément d’encadrer et de réduire les excès de l’hybris humaine qui ne cesseront jamais. Ce n’est pas le pessimisme qui fera progresser l’humanité, ni le fatalisme qu’il soit raciste, économique, islamique ou postmoderne.
Ce n’est pas la spéculation financière, ni le consumérisme qui créeront plus d’équité humaine ou qui sauveront la planète de sa destruction systémique. La nature, qu’elle soit des choses, des plaques telluriques, ou de l’économie, n’a aucun sens de la justice, aucune conscience éthique. Elle gouverne selon la loi du plus fort, comme l’a affirmé Darwin. Mais après avoir rendu à Darwin l’hommage qu’il méritait face aux créationnistes de son temps, il faut admettre que ce sont les divergences beaucoup plus que la sélection et l’adaptation qui font évoluer la nature, la vie et l’aventure humaine. Or l’éthique est une divergence par rapport à l’ordre naturel des choses. Elle est une invention spécifiquement humaine. Et nous parlons aujourd’hui de cette éthique laïque, planétaire, qui est formulée dans les Déclarations successives du respect des droits de l’homme, auxquelles nous ajoutons le respect de la Nature, car il est le degré premier du respect de l’Homme.
Pour en finir avec les maléfices des désenchanteurs
Comment s’étonner que les désastres humains du XIXe siècle aient rendu nos intellectuels pessimistes et désabusés ? Même si cette tendance lourde de l’esprit humain avait été déjà revendiquée par Schopenhauer, Kierkegaard et même chez nos philosophes sceptiques et stoïciens de l’Antiquité grecque.
Mais depuis Freud, analyste du « malaise dans la civilisation », inventeur d’un inconscient qui croit avoir découvert au plus profond de chacun de nous un marécage pestilentiel, nous avons dû nous habituer à l’idée d’être tous des malades mentaux, névrosés, hystériques, en proie aux affres du complexe d’Œdipe et obsédés sexuels. Pour en finir avec cette pathologie théorique qu’on a appelé la psychanalyse, il faut se demander quelle crédibilité on peut accorder à un « médecin des âmes » qui se déclarait « naturaliste » et qui s’est révélé être un mystificateur, un monstre de misanthropie et de misogynie, manipulateur soucieux de contrôler l’Association internationale de psychanalyse qu’il avait fondée comme une secte lucrative dont il s’assurait de protéger les « brevets » théoriques et thérapeutiques[7]. Que penser d’un médecin qui écrivait à son ami Wilhelm Fliess en 2001 : actuellement, pour assurer mes revenus, « je ne puis vraiment compter que sur un seul malade, un jeune obsédé, et la bonne vieille dame qui représentait pour moi une petite rente est morte pendant les vacances… »[8]. Que penser d’un esprit brillant de lucidité, qui écrit : « Les femmes ne tarderont pas à contrarier le courant civilisateur ; elles exercent plutôt une influence tendant à le ralentir et à l’endiguer. (…) L’œuvre civilisatrice, devenue de plus en plus l’affaire des hommes, imposera à ceux-ci des tâches toujours plus difficiles et les contraindra à sublimer leurs instincts, sublimation à laquelle les femmes sont peu aptes »[9].
Faudrait-il alors le suivre, lorsqu’il ne voit dans l’art qu’une sublimation de nos névroses[10], « un doux enivrement », « une légère narcose où l’art nous plonge (qui) est fugitive, simple retraite devant les dures nécessités de la vie, elle n’est point assez profonde pour nous faire oublier notre misère réelle »[11] ; et qui ajoute : l’art est « inoffensif et bienveillant, il ne prétend à être qu’une illusion et ne tente jamais l’assaut de la réalité »[12].
On ne saurait s’étonner qu’après deux guerres mondiales, la shoah, confrontés aux guerres du Vietnam, de Corée, d’Algérie, aux dictatures communistes et fascistes, etc. les intellectuels soient devenus des professionnels du pessimisme et nous aient fait macérer dans leur jus de nicotine postmoderne, avec des propos démystificateurs les plus variés selon le tempérament de chacun, allant de l’analyse de nos flux errants de Jean-François Lyotard, de nos violences ordinaires et tribales de Michel Maffesoli, à l’ère du vide de Gilles Lipovetsky, en passant par les malaises de la bioéthique de Michel Foucault, jusqu’au catastrophisme apocalyptique de Jean Baudrillard[13]. Mais c’est en caricaturant les concepts d’Histoire, de Progrès, de Raison, d’Éthique, que ces rhétoriqueurs postmodernes du malheur banalisé les dénigrent systématiquement, se donnant la tâche facile dans leurs déclarations péremptoires. Ce sont pourtant des mythes complexes, qui méritent une analyse plus fine, qui ont porté nos espoirs et que la folie des hommes n’a pas condamnés philosophiquement, mais en leur opposant seulement la violence et l’absurdité des guerres, cette dérive humaine que précisément ces mythes nous invitent à surmonter. La faute d’esprit est évidente. D’autant plus que les conclusions désespérantes, résignées ou cyniques qu’ils en tirent n’offrent aucune alternative crédible.
L’art sociologique et la métaphore quantique
Nous évoluons d’une physique et d’une technologique fondée sur un code binaire et linéaire vers une interprétation quantique du monde, et une épistémologie quantique des sciences humaines et sociales, qui embrasse en science les problèmes majeurs, toujours rejetés, de la discontinuité et de l’indétermination, et qui vaut pour la sociologie, pour la mythanalyse et aussi pour l’art.
Cette nouvelle métaphore quantique de l’univers, de la société et de la conscience confronte l’art sociologique à de nouveaux défis. Il ne s’agit plus tant, dans une machinerie téléologique, d’opposer des concepts, la femme et l’homme, l’autre et soi-même, l’art et la société, que de rechercher dans leurs complexités les zones de déplacement, de recouvrement, de vibration, de flou et la dynamique qui s’y joue. Lorsque j’intitule cette publication ART versus SOCIÉTÉ, le mot versus, du latin vertere, « tourner, changer, convertir », indique « en direction de ». En anglais, il signifie : « contre », l’inverse, l’adversaire, la controverse. Mais sa consonance française fluide du mot verser invite à une dynamique pour aller au-delà, se répandre, mélanger. La société fait l’art. L’art fait la société. On ne sait pas lequel tourne autour de l’autre. Ils sont inextricables.
La mécanique quantique nous conduit à penser que l’observateur n’est pas dans un face à face frontal avec son objet d’observation, mais qu’il en fait partie, que la mesure modifie ce que l’on mesure, que l’artiste est à la fois la société et l’œuvre qu’il produit, dans des rapports en constante interaction. C’est le clou qui détermine l’action du marteau et non le marteau qui détermine le clou. Ainsi Marcel Duchamp affirmait que c’est le lieu qui consacre l’œuvre d’art, ou que l’œuvre d’art est dans le regard du regardeur. La mécanique quantique nous aide à penser que la société change l’art et que l’art change la société dans un engagement intime et réciproque, dans une intra-action plutôt qu’une relation de cause à effet par trop simplificatrice pour décrire la réalité, une inter-relationnalité selon l’expression de la physicienne, philosophe et féministe Karen Barad, théoricienne du « réalisme agentiel »[14].
Les démarches participatives de l’art sociologique avec le public, par exemple en multipliant les panneaux de signalisation ART, Avez-vous quelque chose à déclarer ? en 1971[15], est un exemple. Je me suis aventuré à multiples reprises dans une telle démarche, par exemple en créant un dispositif en 1978 avec le grand quotidien néerlandais Het Parool pour inviter les habitants du quartier De Jordaan à écrire quotidiennement et collectivement dans ce journal une page sur leur vie quotidienne[16], à Montréal en 1981 en proposant aux lecteurs du grand quotidien La Presse d’écrire sur une pleine page du journal qui ils pensaient être et qui ils voudraient être[17], à Mexico en 1983 en incitant les visiteurs du Museo d’arte moderno de Mexico à changer le musée et à y créer leurs propres expositions[18], en invitant les visiteurs de mon exposition au Centre Pompidou en 2017 à répondre sur les réseaux sociaux face à des peintures sociologiques de codes QR à ma question Quelle société voulons-nous ?[19] parmi tant d’autres aventures du même genre qui m’ont accaparé. Mais il est aussi possible de suggérer cette nouvelle épistémologie dans des œuvres graphiques, des peintures qui suggèrent la mobilité des formes par un jeu de déplacements, et superpositions de couleurs, comme je m’y suis plus récemment exercé avec des contre-empreintes de main. Ce qui est alors en jeu, c’est une pédagogie qui invite le regardeur à choisir son regard et prendre ainsi conscience de la nécessité de changer de paradigme perceptif, mental et donc psychologique et sociologique, en admettant par exemple plus intimement dans sa conscience les variations de couleur de peau, d’orientation sexuelle et de genre entre personnes LGBT+, et en prenant en compte l’incertitude de nos connaissances et de nos opinions, plutôt leur première évidence conformiste. La vérité relève toujours du relativisme que nous devons apprendre à respecter pour nous-mêmes et dans notre rapport aux autres et au monde.
C’est le fixisme institutionnel de nos sociétés, la simplification binaire de nos valeurs qui sont en jeu, et, tout à l’opposé, la capacité emphatique de se mettre à la place de l’autre pour le comprendre et la co-responsabilité éthique collective que cela implique, qu’il faut conquérir, comme le revendique Karen Barad, comme l’affirme et le pratique Orazio Maria Valastro dans ses ateliers d’auto-écriture mythobiographique[20], et comme je le propose moi-même avec les concepts de « conscience augmentée » et d’éthique planétaire[21].
C’est la planète qui engendre la notion d’éthique. C’est l’éthique globale qui exige que nous changions la planète, puisque nous ne pouvons pas changer de planète pour aller ailleurs dans l’univers établir un autre monde.
Le médium, c’est le public
McLuhan affirma que le message, c’est le médium, et, suite à une coquille d’imprimeur qu’il adopta, que le message est un massage. Ce fut un postulat fécond, qui a eu son heure de vérité critique, mais qui est devenu depuis, avec les réseaux sociaux émotionnels et les fake news, une triste vérité dévastatrice. Dans le domaine de l’art, la liste est infinie de ce qu’on a qualifié de médium et qui n’étaient que des outils : la peinture, la gravure, la sculpture, le matériau, terre, pierre, métal, plastique, le verre, le mur, la toile, le dessin, la couleur, le geste, la performance, le théâtre, la musique, la danse, l’architecture, la vidéo, l’ombre et la lumière, l’électricité et aujourd’hui les technologies numériques - et j’en passe. Marcel Duchamp fit rupture en affirmant que le médium, c’est l’artiste lui-même. Et Joseph Beuys, reprenant cette idée dans une forme archaïque, se déclara chaman.

Tampon caoutchouc, 1971.
Mais ce qui fut le point de bascule de l’art sociologique, sa divergence historique, incontestablement inspirée par le situationnisme de Mai 68, fut de décider que le médium de l’art, c’est son public. En 1971, c’est en optant pour des « travaux socio-pédagogiques » de l’art, que j’ai fondé l’art sociologique. En installant dans les rues des quartiers de galeries d’art ou à l’entrée des musées mes panneaux « ART - Avez-vous quelque chose à déclarer ? » (1971), j’ai adopté d’emblée cette démarche. Dans celle de Perpignan en 1976, qui était à cet égard tout aussi explicite, le critique d’art catalan Éric Forcada, a déclaré que nous avions approché la population des divers quartiers de la ville comme « un matériau d’art » [22]. Et je suis resté toute ma vie fidèle à ce choix, que ce soit en utilisant des panneaux de signalisation imaginaires (qu’on a pu qualifier d’interventions urbaines, in situ), des tampons caoutchouc (art postal), des essuie-mains (hygiène de l’art), en pratiquant la pharmacie ou en officiant dans un bureau d’identité imaginaire (plus récemment en me faisant banquier ou concepteur de timbres), en travaillant à la surface des médias, notamment les grands journaux quotidiens, dans des dispositifs participatifs avec des publics divers artistiques, urbains, ruraux, par le détournement interrogatif situationniste, plus tard en recourant à la peinture acrylique sur toile, au tweet art et à la tweet philosophie, en envoyant des circulaires par la poste, puis plus récemment en pratiquant des envois en nombre de courriels, en créant des collectifs pour réaliser des projets, à commencer par le collectif d’art sociologique en 1974, puis le collectif de Perpignan en 1976, puis tant d’autres, en écrivant des textes, des manifestes pour co-fonder le collectif d’art sociologique, (pour le meilleur et pour le pire), ou aujourd’hui un art philosophique et éthique, en enseignant dans des écoles d’art et des universités (aussi pour survivre).
Mais mon médium, a toujours été l’autre, le public que j’ai choisi dans la théorie et la pratique de l’art sociologique, a toujours été, et c’est sur cette base que j’ai réuni tous les collectifs avec lesquels j’ai pu aller de l’avant, à commencer par celui de 1974, les groupes sociaux auxquels nous nous adressions dans un respect humain le plus empathique et éthique possible.
Le principe en était clair et distinct : pour changer le monde, il ne suffit pas d’opter pour une démarche et une méthodologie situationniste, socio-pédagogique, sociologique, ou aujourd’hui de plus en plus philosophique, mythanalytique, éthique, et qu’importe la multiplicité des outils médiatiques auxquels on a recourt ; quand l’art choisit de changer non plus l’image du monde, mais le monde lui-même, il faut commencer par changer les gens, changer le public auquel l’art s’adresse, aussi modeste que soit cette volonté au regard de l’ambition planétaire qui est revendiquée. Le médium de l’art sociologique, c’est son public. C’est en quoi l’art sociologique a fait rupture, c’est ce qui l’a défini et c’est ce dont l’art plus généralement prendra de plus conscience dans notre époque nouvelle de massification planétaire et de développement des réseaux numériques, tandis que les musées deviennent des reliquaires et lieux d’éducation et de divertissement des larges publics dont ils ont besoin financièrement pour survivre.
Repenser radicalement le statut de l’œuvre d’art et de l’artiste
L’œuvre d’art n’est pas un objet fétiche, pas plus que ne le furent les dessins des grottes préhistoriques, les masques africains des rituels collectifs, les crucifix chrétiens ou les statuettes du Bouddha. Les œuvres d’art ne sont pas le but de l’art, mais seulement un moyen, un outil ayant pour but de nous interroger. Il ne faut pas regarder, encadrer ou vendre le doigt qui nous montre la Lune, mais méditer sur l’univers qu’évoque la Lune. Et quand on y pense sérieusement, n’en a-t-il pas toujours été ainsi dans le cas des chefs d’œuvre ? La dérive fétichiste et commerciale moderne de l’œuvre d’art est devenue tellement dominante qu’on en est venu à se demander si l’art préhistorique ou les « arts premiers » était vraiment déjà de l’art.
C’est le contraire qui est vrai : cet art actuel trivial qui fait œuvre de produit financier spéculatif dans les rituels de grandes ventes aux enchères en déclinant médiocrement des poncifs symboliques de l’art institutionnellement légitimé par les grands musées, qui fait fureur chez les naïfs nouveaux riches collectionneurs, n’est que du mauvais artisanat. Les chefs d’œuvre de l’art n’ont jamais été que des outils, qu’il faut regarder, scruter pour y voir autre chose que ce qu’ils sont : une cosmogonie, un dieu, l’humanité, la nature, l’énergie matérielle, une fabulation ou une autre selon les époques et les sociétés. Ni le marteau, ni le clou ne sont des œuvres d’art ; ils sont seulement les outils de la création. L’art n’est pas là où on le croit, pas dans l’objet d’art, mais là où l’objet d’art dirige notre regard.
C’est en ce sens qu’il faut comprendre cette affirmation que je tiens pour fondamentale : ce n’est pas le tableau, la sculpture, l’image digitale qui est le médium de l’art. C’est le public de l’art qui et le médium de l’artiste qui veut changer le monde. C’est à ce public que l’artiste s’adresse et c’est par ce public que passe nécessairement le message planétaire de l’artiste.
Et il faut en tirer des conséquences aussi fondamentales que méconnues. Les activités d’artiste, de poète et de philosophe ne sont pas des métiers, ni des commerces. Pour être artiste, poète ou philosophe, il faut mendier, comme Démocrite ou comme les moines tibétains, ou exercer simultanément un métier ordinaire pour assurer sa vie matérielle. Être artiste, poète ou philosophe pour gagner sa vie, c’est une erreur répandue, misérable, et incompatible avec la liberté qu’exige ces activités hors normes. Juger légitime d’en faire commerce, c’est les dévoyer irrémédiablement.
Si nous ne croyons pas en l’Homme, il n’y a pas de solution
Parmi les philosophies modernes, les intellectuels se réfèrent volontiers à Albert Camus et à Jean-Paul Sartre. Camus fonda sa philosophie sur un constat d’absurdité de notre condition humaine, qui demeure arbitraire, car rien ne nous oblige à postuler l’absurdité de l’univers. Tout au contraire, c’est précisément ce non-sens qui fonde notre liberté et notre responsabilité au lieu de nous soumettre à une nécessité qui nous surplomberait. Que pouvons-nous souhaiter de plus ? Et Camus savait faire la part des choses. Son humanisme de facto nous touche. Sartre, à l’opposé, affirmant qu’il faut changer le monde pour lui donner un sens plus humain, avait terriblement raison, mais lorsqu’il déclarait que cela n’est possible que par la violence, que la fin justifie les moyens et qu’il défendait Staline, Mao Zedong et Pol Pot, il devenait lui-même indéfendable. Il reniait les fondements de l’humanisme avec des arguments idéologiques ou théoriques d’une monstrueuse abstraction. Nous avons appris que changer le monde est possible pacifiquement, comme le démontrèrent Gandhi, King et Mandela.
La mythanalyse va plus loin dans le non-dit de la nature humaine. Elle pose le problème en d’autres termes, non plus ceux d’un raisonnement rationaliste, mais ceux de nos imaginaires sociaux. Elle affirme qu’on ne peut changer le monde qu’en changeant les mythes qui nous gouvernent. L’évidence de notre échec actuel, local autant que mondial, nous contraint à inventer un récit, qui nous donne un sens nouveau, une motivation que nous puissions partager, et dont la sagesse écologique nous sauve de l’apocalypse. La mythanalyse retient de Camus son exigence éthique et la résilience du mythe de Sisyphe, qui chaque matin remet sur ses épaules les maux de l’humanité et tente de remonter au sommet de la montagne. Et la pandémie actuelle constitue une formidable opportunité pour faire progresser l’éthique planétaire, écologique et sociale, et rejeter les hallucinations, telle la loi darwinienne de l’économisme mondialisé, le consumérisme effréné, la domination aveugle sur la nature qu’ils induisent et qui nous mènent au désastre collectif. Puisque c’est désormais à l’humanité et non plus à Dieu qu’il appartient d’inventer et de mettre en œuvre le sens de notre destinée, c’est au mythe de l’Homme que la mythanalyse nous invite à croire.

Si nous ne croyons pas en l’Homme, il n’y a pas de solution, peinture acrylique sur toile, 92x92cm, 2015.
Par-delà les diversités irrépressibles, l’émergence d’une nouvelle sensibilité planétaire
Nous-même, dans le manifeste pour un art actuel que nous avons diffusé, et dans ce texte plus développé dont nous l’accompagnons, opposant la servilité de l’art au scandale constant de la planète, c’est constamment à l’urgence de rétablir l’esprit critique de l’art que nous avons fait appel. Tout questionnement philosophique ne postule pas nécessairement un pessimisme incontournable qui serait celui de notre désespoir ontologique. La philosophie n’est pas nécessairement pessimiste. Leibniz nous l’a rappelé et même celle de Camus invite à surmonter l’absurdité supposée de notre condition humaine.
Mais le deuxième enjeu que nous évoquons pour l’art actuel, celui de l’éthique, est par sa nature même un concept qui implique l’optimisme. À quoi pourrait bien servir l’exigence éthique, si ce n’est au progrès individuel de l’homme, et désormais, dans la conception planétaire que nous en revendiquons, au progrès collectif de l’humanité. Il est difficile d’être plus optimiste ! Au point même de nous exposer aux railleries de ceux, notamment les déshumanistes postmodernes, qui nous taxent immédiatement de naïveté niaiseuse.
Lorsqu’une divergence émerge, qui s’impose, et qu’il faut penser à contrario de notre précipitation d’hier, c’est bien le moment où notre philosophie optimiste nous offre une alternative à un siècle de poisse tragique. À notre échelle générationnelle du moins, c’est un moment majeur de notre aventure humaine. Prendre conscience, dans la sidération, que nous sommes à un carrefour. Cela veut dire que nous allons penser et dire des choses impensables avant la pandémie, difficiles à exprimer dans la foulée de notre pensée convenue et soumise d’hier, d’apparence peu crédibles mais que nous jugeons désormais nécessaires. Les plus lucides s’y essayent, alors que l’immense majorité, tout en multipliant verbalement les vœux pieux, demeure peureuse et incertaine, plus secrètement prête à ce qu’on rétablisse à coups de centaines de milliards les déséquilibres d’hier, qu’à accepter de grands changements qui changeront son confort mou. Ou elle prétend que le monde n’a pas vraiment changé, ne changera pas davantage cette fois à cause d’un méchant petit virus, et que nous avons connu des pestes et des génocides bien pires que cette crise actuelle, qui ne mérite donc pas tant de grands discours. Celui qui parle librement, comme je m’y essaye, passe pour un hurluberlu qui se prend pour un prophète, un rêveur déconnecté ou un dictateur en herbe qui voudrait imposer des idées universalistes irréalistes. Il nous faudrait pour changer le monde construire une gouvernance planétaire qui n’est pas à notre portée. Irréaliste parce qu’elle désavantagerait les pays de bonne volonté dans la compétition économique internationale cynique. Nous ne tolérerions ces institutions planétaires que parce qu’elles sont dépourvues du pouvoir réel d’empiéter sur nos indépendances politiques. Ce qui n’est pas vrai.
Mais quant à nous, en tant qu’artiste, nous ne parlons pas de pouvoir politique, ni de contrainte d’une complexité pour nous secondaire par rapport à ce qui permettra de la dénouer un jour. Nous parlons seulement de l’essentiel, cette nouvelle sensibilité éthique et planétaire, dont nous ressentons la nécessité impérieuse, suite à la pandémie de la Covid 19 révélatrice de toutes nos hallucinations toxiques, comme le négatif de la « normalité » avec laquelle nous sommes allés chaotiquement jusqu’à la catastrophe planétaire. Notre inquiétude accumulée se métamorphose en une exigence de mutation de notre conscience humaine. Il ne s’agit plus ici d’opinions, d’inquiétudes sociales, d’urgences habituellement suivies de dénis répétés, de palliatifs, de mesures mesurées d’adaptation, mais d’une divergence qu’il faut construire et partager, pour prévenir la logique létale des comportements antérieurs, non seulement dans la gouvernance publique, mais aussi et d’abord, fondamentalement dans nos comportements individuels.
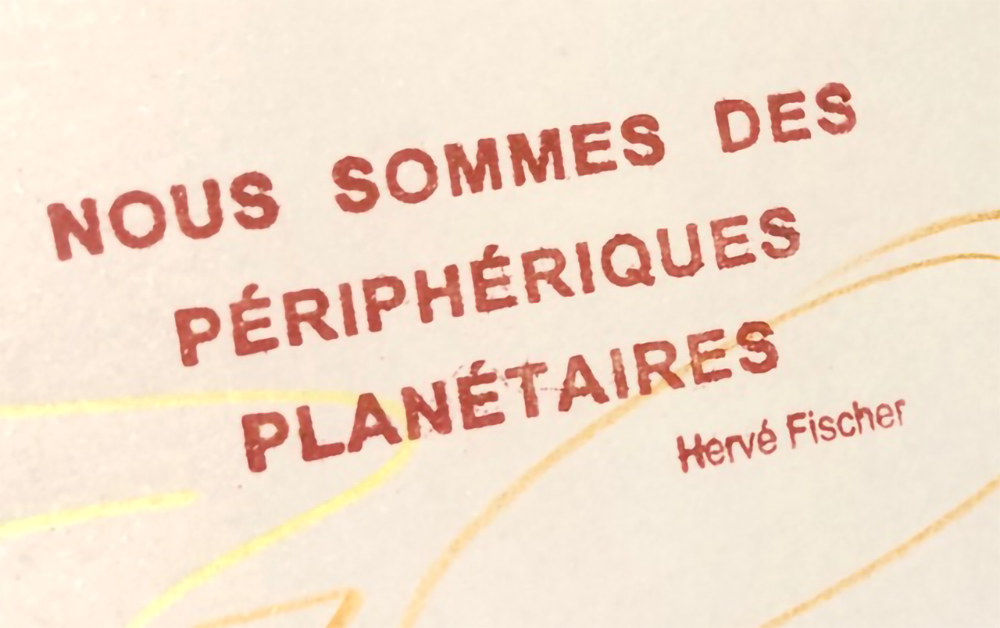
Tampon caoutchouc, 1972.
Chacun cultive ses différences d’enracinement culturel. C’est une nécessité biologique autant qu’une richesse pour l’humanité. Mais désormais, nous vivons, tous et chacun de nous, avec ces deux pôles de notre conscience : le local et le mondial, aussi importants l’un que l’autre. Conscience et sensibilité vont de pair. Cela signifie que nous assumons simultanément, dans une conscience élargie les inquiétudes et les projets, les souffrances et les bonheurs, tantôt complémentaires, tantôt contradictoires, de ces deux pôles. Cette conscience « glocale », comme on la nomme, crée de nouvelles émotions, peurs et désirs, des sentiments d’indignation et de solidarité, qui nous font réagir en temps réel aux informations que nous recevons, comparons, évaluons et retransmettons sur les réseaux sociaux : une nouvelle image du monde, une toute nouvelle sensibilité planétaire. Nous avons pris conscience tant de la fragilité de la planète et de l’humanité à laquelle nous appartenons, que de notre responsabilité individuelle et surtout collective, pour prévenir les catastrophes de plus en plus graves qui nous menacent dans une interconnexion planétaire à laquelle nous ne pouvons plus échapper. Les slogans des grandes causes et des indignations, #EthicsMatter, #Ecologie, #GreenEconomy, #Justice, #BlackLivesMatter, #SilenceisViolence, #meToo, se multiplient sur les réseaux sociaux qui identifient les principales tendances d’actualité de cette nouvelle conscience planétaire.
Nous parlons d’une découverte aussi importante historiquement que le fut celle de la nouvelle sensibilité à la nature des peintres impressionnistes face au néo-classicisme bitumé des ateliers, mais cette fois sociale et globale, qu’il faut instituer et concilier avec les urgences climatique, sanitaire, économique, en apparence contradictoires, mais qui en constitue aussi la clé. C’est cette nouvelle sensibilité planétaire, essentiellement éthique, que nous tendons à partager et qui appelle notre engagement d’artiste. Ce sont ces nouveaux enjeux que souligne mon Manifeste pour un art actuel. Tous relèvent du respect des droits universels de l’homme, constamment bafoués. C’est ce que j’appelle l’éthique planétaire. Elle est connue, elle a été écrite et déclarée maintes fois. Elle n’est ni religieuse, ni individuelle, ni sentimentale, mais collective, universelle et objective à minima, ce qui n’empêche pas qu’elle soit constamment transgressée.
Tous les enjeux majeurs et urgents de notre « conscience augmentée » relèvent de ces droits universels de l’homme, que ce soit l’égalité des hommes et des femmes, la lutte contre les racismes de tout genre (misogynie, couleur de peau, sexe, diversité des orientations sexuelles, flux migratoires), contre le terrorisme, contre les injustices, exploitations et violences sociales, sexuelles ; que ce soit l’urgence climatique, le développement universel de l’éducation, la lutte contre les paradis fiscaux et les évasions fiscales, contre le narcotrafic et le blanchiment d’argent, pour la taxation des spéculations monétaires et financières : la liste serait interminable. Ce sont les valeurs humanistes que nous devons partager à l’échelle planétaire, pour lesquelles nous devons lutter dans le respect de nos diversités culturelles, mais sans jamais déroger aux droits universels et fondamentaux de l’homme, qui ont toujours préséance sur les particularismes religieux et culturels. C’est donc le sens planétaire – récit et direction – qui devrait nous réunir dans la suite de notre aventure humaine, désormais collective, selon ce que j’ai appelé un hyperhumanisme éthique et solidaire. Bien sûr cette direction apparaît aujourd’hui utopique, le chemin sera chaotique, mais du moins la direction à prendre est claire. Bien sûr, l’hyperhumanisme se présente comme un mythe. Mais au moins il ne saurait être toxique comme notre « normalité » actuelle. Il n’est ni une hallucination, ni une mystification, encore moins un mirage : seulement une orientation.
Bien sûr, nous verrons continuer les scandales, mais nous en serons planétairement de plus en plus informés, de plus en plus conscients, et de plus en plus nombreux à nous en indigner. Nous verrons occasionnellement émerger de nouveaux tyrans, se multiplier des violences « ordinaires », mais aussi se lever des figures héroïques de cette sensibilité nouvelle. Bien sûr, l’art, les artistes qui évoqueront cette nouvelle sensibilité, qui l’exploreront, qui la célébreront, la questionneront, la débattront, n’auront pas plus d’influence immédiate que n’en eurent dans un premier temps les impressionnistes, lorsqu’ils proposèrent une nouvelle vision de la nature, les surréalistes lorsqu’ils explorèrent le monde onirique, les cubistes ou Duchamp. Ils ne changeront pas le monde mardi ou mercredi. Mais à long terme, en profondeur, ils contribueront très réellement au renforcement et au partage de cette sensibilité éthique planétaire qui, seule, pourra changer le monde scandaleux dont nous devons aujourd’hui encore nous accommoder à contrecœur. Les réformes et les progrès majeurs, ceux qui exigent tous nos efforts, ne se feront pas du jour au lendemain, ni spectaculairement, comme la prise de la Bastille, la chute du Mur de Berlin ou du Wall Trade Center de New York, qui marquent des dates de l’histoire. Mais ils relèvent de courants profonds et puissants de la conscience des hommes, désormais planétaire. Et c’est dans ce temps lent mais irréversible, partagé malgré les chaos, malgré les défaites de l’esprit et du cœur, que s’inscrivent à nos yeux les nouvelles tendances de la création culturelle et de l’art actuel.
Les artistes qui se tournent aujourd’hui vers ces enjeux philosophiques et éthiques ne seront pas célébrés sur le marché spéculatif mondial de l’art. Ils ne seront pas les plus immédiatement populaires dans les musées et sur les réseaux sociaux. Ils resteront peut-être même des inconnus. Ils ne changeront pas aujourd’hui l’Histoire de l’art, mais contribueront à changer demain l’histoire de l’humanité. C’est dans le respect de nos diversités - une conquête en cours - que nous voyons émerger cette nouvelle conscience éthique et sensibilité planétaire - en soi une révolution anthropologique -, qui va nous permettre de diverger. La nature a beaucoup changé au cours des millénaires : animiste, polythéiste, exploitable, romantique, esthétique, puissante ou soumise, et aujourd’hui fragile, numérique, politique et planétaire. L’image du monde aussi : magique, religieuse, physique et aujourd’hui numérique. L’art aussi. Et la priorité philosophique et éthique, donc écologique aussi, que nous devons lui reconnaître, prend désormais une résonance planétaire. Et plus que jamais, alors qu’il tournait en rond dans le « n’importe quoi est art » ou sous la chape du « Market Art », il prend soudainement vocation à changer le monde, dans le détail, l’ironie, la poésie, la critique pointue, dans l’alternative, le décalage ou la dérive, ou dans le rêve, l’utopie et l’engagement explicite et global.
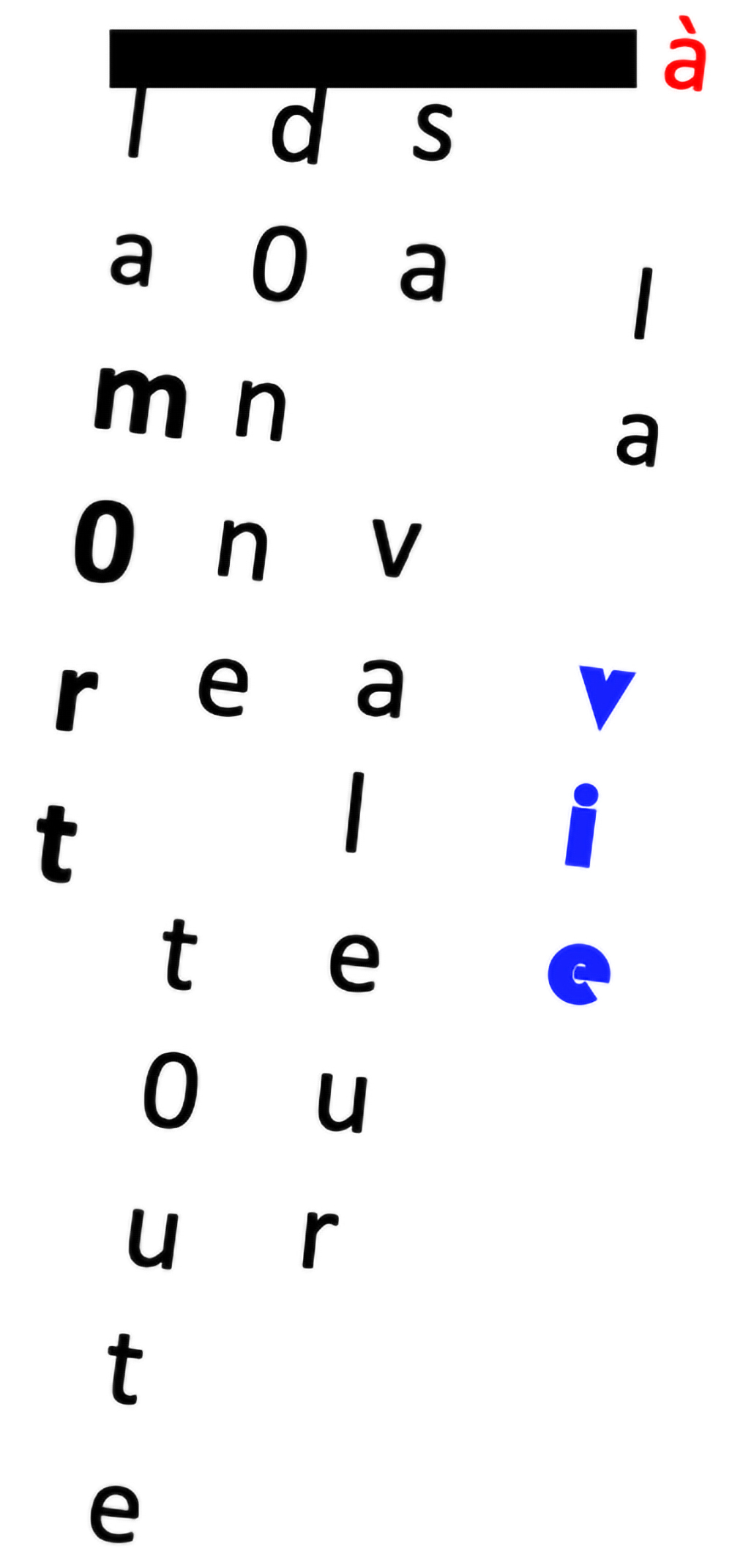
La pluie, tweet art, 2021.
La singularité d’une campagne planétaire pour un art philosophique et éthique
L’idée de mondialisation associée à l’idéologie néolibérale est en pleine crise et face à tous les effets locaux de cette crise elle-même, nous croyons nous réveiller et devoir prôner un retour à des gouvernances locales indépendantes. Mais nous savons bien que ces recentrements sont largement illusoires, notamment par rapport aux urgences climatiques, aux exigences de santé publique, au soutien que nous devons donner aux pays pauvres, aux flux migratoires. Ce n’est pas parce que la crise est mondiale que l’idée de notre solidarité planétaire biologique et humaine doit être combattue. C’est au contraire parce que nous traversons cette crise qu’il nous faut repenser notre gouvernance planétaire et développer nos solidarités dans un meilleur équilibre, plus efficace, plus réel.
En lançant, de mon petit chalet périphérique dans la forêt boréale du Québec, un manifeste pour un art actuel face à la crise mondiale, j’en appelle à la nécessité nouvelle et désormais planétaire d’un art qui exerce sa fonction sociale de questionnement philosophiques de nos valeurs dans la diversité de nos cultures. Cette publication porte surtout sur les arts visuels, car ils sont essentiellement iconiques, emblématiques de nos images du monde comme nous en constatons la tradition puissante dans l’art religieux, dont ils ont hérité. Nous leur prêtons pour cette raison une attention spirituelle, nous gardons l’habitude d’y déchiffrer notre rapport au monde ; mais elle pourrait être élargie à la musique et à la danse, à la littérature et au théâtre, à l’architecture et à l’urbanisme, bien sûr selon des problématiques de création différentes.
Cette pandémie nous a révélé une crise mondiale beaucoup plus grave que la Covid 19 elle-même, qui a sonné comme un coup de gong, nous donnant à tous l’alarme que même les plus sourds sont contraints d’entendre, reprise en écho par les oies du Capitole face à l’assaut des barbares. Et dans ce chaos planétaire, nous n’avons pas de meilleure boussole que l’éthique planétaire.
Jadis, il y avait autant de consciences du monde que de sociétés et de cultures. Mais aujourd’hui on peut affirmer qu’il existe, englobant et respectant la diversité de toutes ces cultures et de toutes ces consciences planétaires, une « conscience augmentée », planétaire en temps réel. Elle est certes encore émergeante et minoritaire, mais déjà partagée universellement dans ses valeurs fondamentales hyperhumanistes. J’insiste sur la priorité désormais éthique de l’art pour explorer, exposer, changer notre rapport au monde, dans la riche diversité de nos images du monde.
Un collectif planétaire
Dès 1971, dans mes échanges de mail art et de tampons caoutchouc avec des artistes d’Amérique latine et du Nord, d’Europe de l’Est et occidentale, du Japon, j’ai pris conscience de l’importance artistique et politique des réseaux d’artistes et d’intellectuels[23]. Et cette conscience planétaire n’a cessé de se développer depuis, sur les cinq continents, comme en témoignent les textes ici rassemblés de Clemente Padin, Chuck Welch, Hans Braumüller, Ruggero Maggi (United In Mail Art), grâce aux échanges de mail art, de poésie visuelle, puis de leur migration sur l’internet. C’est certainement là qu’il faut chercher l’émergence de cette conscience artistique partagée à l’échelle de la planète que je célèbre. Puis, j’ai très souvent dans ma pratique artistique constitué des collectifs pour donner force à des idées et réunir les énergies et les créativités nécessaires à des projets ambitieux, et cela dans divers lieux et temps de ma vie, à Paris, avec les étudiants de l’École des beaux-arts pour mon intervention signalétique ART - Avez-vous quelque chose à déclarer ?, puis pour fonder des collectif d’art sociologique, à Perpignan, Angoulême, Montauban, Guebwiller, Lyon, Kassel, Mexico, Krautscheid-Seifen et Stadt Blankenberg, Winnekendonk, Hanovre, Chicoutimi, Montréal, Ottawa, Sao Paolo, etc. Aujourd’hui, s’impose donc une conscience planétaire partagée. Et l’art sociologique, lorsqu’il questionne la société, interroge nécessairement aussi la philosophie, les mythes et l’éthique.
Les convergences manifestes d’analyses critiques, démystificatrices de l’évolution actuelle de la mondialisation et du techno-capitalisme, des pratiques artistiques, des soumissions institutionnelles qu’il induit, ainsi que de la dérive cynique et toxique du marché mondial de l’art, tout autant que les timides espoirs alternatifs qui émergent des textes des personnalités réunies dans ce livre, issues des cinq continents, nous permettent de croire en un consensus planétaire pour repenser et proposer de nouvelles valeurs à l’évolution de l’art. Je dis bien l’évolution et non l’Histoire. Et j’insiste sur la pluralité de ces évolutions et des histoires à venir. Mais elles ont manifestement en commun et nous espérons qu’elles partageront de plus en plus activement, dans leur diversité de contextes et d’expressions, les nouveaux enjeux philosophiques et éthiques que nous imposent tout à la fois la « normalité » saturée, lassante et désespérante de l’actualité mondiale, tout autant que l’émergence d’une « conscience augmentée », planétaire et en temps réel permettant d’espérer une divergence hyperhumaniste. Une philosophie et une éthique en action avec la puissance de l’art pour changer le monde.
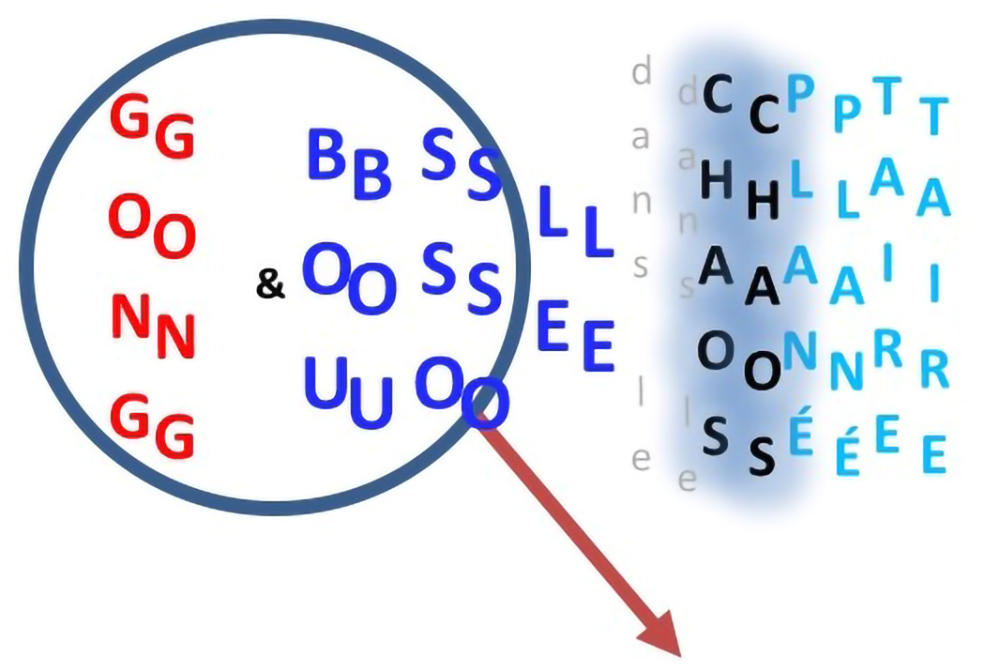

Tweet art, 2020.
Notes
[1] Hervé Fischer, L’Avenir de l’art, chapitre 10, L’art changera le monde, p.194-216, Vlb Éditeur, Montréal, 2010.
[2] Voir le texte que je lui ai consacré dans Les couleurs de l’Occident. De la Préhistoire au XXIe siècle, Bibliothèque des histoires illustrées, Gallimard, 2019, p. 431-433.
[3] Aux Éditions François Bourrin, Paris, 2016.
[4] Laurent Cauwet, La domestication de l’art. Politique et mécénat, La fabrique Éditions, Paris, 2017.
[5] Hervé Fischer, Art et communication marginale, Édition André Balland, Paris, 1974.
[6] Hervé Fischer, CyberPromothée, ou l’instinct de puissance à l’âge du numérique, VLB Éditeur, Montréal, 2003.
[7] Voir : James Hillman, Le mythe de la psychanalyse, Imago, Paris, 1977 ; Thomas Szasz, Le mythe de la psychothérapie, Petite bibliothèque Payot, Paris, 1981 ; Michel Onfray, Le crépuscule d’une idole, L’affabulation freudienne, Grasset, Le livre de Poche, Paris, 2010.
[8] La naissance de la psychanalyse, lettre à Wilhelm Fliess du 7-8-01, p. 296, Édition Presses universitaires de France, Paris, 1973.
[9] Freud, Malaise dans la civilisation, p. 55, (1929), Éditions Presses universitaires de France, Paris, 1973.
[10] Freud, Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci, p. 31, Idées Gallimard, Paris, 1977.
[11] Freud, Malaise dans la civilisation, p.26-27, Édition Presses universitaires de France, 1973.
[12] Freud, in Nouvelles conférences sur la psychanalyse, 1923.
[13] J’en ai rendu compte dans le chapitre consacré aux « déshumanistes » de L’Âge hyperhumaniste, Éditions de L’aube, La Tour d’Aigues, 2019.
[14] Voir à cet égard le texte d’Anna Rewakowicz, qui en donne un excellent exemple artistique.
[15] Notamment avec cinquante panneaux dans le quartier des galeries d’art des rues de Seine et des Beaux-arts à Paris en 1974.
[16] Avec l’appui logistique de la Fondation De Apple d’Amsterdam.
[17] Hervé Fischer, L’oiseau-chat, Éditions de La Presse, 1982.
[18] Hervé Fischer, La Calle ¿Adonde llega?, Mexico, Arte y Ediciones, 1984.
[19] Hervé Fischer et l’art sociologique, Centre Pompidou, 2017.
[20] Orazio Maria Valastro, voir son article en tête de cette publication et ses livres, sa thèse Biographie et mythobiographie de soi : l'imaginaire de la souffrance dans l'écriture autobiographique, 2011 ; Écritures sociologiques d'ailleurs, Les Éditions du Net, Paris, France, 2013 ; et de nombreuses publications dans la revue M@GM@.
[21] Hervé Fischer, L’Âge hyperhumaniste. Pour une éthique planétaire, Éditions de L’aube, La Tour d’Aigues, France, 2019.
[22] L’historienne d’art américaine Lily Woodruff le relève dans son livre Dis-ordering the Establishment. Parcipatory Art and Institutional Critique in France, 1958-1981., Duke University Press, USA, p. 28 et 195-255.
[23] Hervé Fischer, Art et communication marginale, tampons d’artistes, Balland, Paris, 1974.