Sémioticien, fondateur de la revue Protée, Jean-Pierre Vidal est professeur émérite de l’Université du Québec à Chicoutimi où il a enseigné depuis sa fondation en 1969. Il a aussi été chercheur et professeur accrédité au doctorat en sémiologie de l’Université du Québec à Montréal Outre de nombreux articles dans des revues universitaires et culturelles québécoises et françaises, il a publié deux livres sur Robbe-Grillet, quatre recueils de nouvelles, deux recueils d’aphorisme ainsi qu’un essai intitulé : Le labyrinthe aboli ; de quelques Minotaures contemporains dans lequel, entre autres propos, sont esquissés quelques-uns des thèmes qui sont ici traités. Jean-Pierre Vidal collabore à diverses revues culturelles et artistiques du Québec (Spirale, Tangence, XYZ, Esse, Etc, Ciel Variable). Il est actuellement conseiller stratégique au Bureau du scientifique en chef du Québec.
Abstract
L’art serait-il le seul espace de liberté qui reste encore à nos sociétés engluées dans la masse postmoderne ? Encore faudrait-il pouvoir y respirer quelque chose qui ressemblerait à de la transcendance, cette chimère que tout dans nos modes de vie récuse. Ce texte tente d’explorer, en convoquant rhétorique, philosophie et pataphysique, cet étrange espace, à la fois dans la vie et hors d’elle, cette marge interne que l’artiste ratisse et rature, ce lieu qui, oui Mallarmé, n’a d’autre lieu que le lieu, le lieu de l’avoir lieu, le lieu du « au lieu de », du remplacement mais qui paradoxalement souligne ce qu’il efface. Pour qu’y réadvienne, peut-être, la constellation de l’être. Dans une position quantique sans tiers exclu que cette postdialectique balise comme un espace-temps travaillé par la négativité vitale de l’antimasse.

Denys Tremblay, Monarchies. Combattre le feu par le feu permet aux pompiers-incendiaires de choisir l’endroit et le moment du brûlage du combustible plutôt que de demeurer à la merci des feux et des conditions météorologiques. Combattre la monarchie par la monarchie permet de créer un coupe-feu révolutionnaire à grande échelle. Il s’agit parfois de la seule façon de protéger le commun des mortels de son aliénation historique.
« C’est que les choses, les animaux, et les gens du dehors
m’ont toujours paru plus intéressants que mon propre miroir ».
Michel Tournier, Journal extime.
« L’être est né en se retirant de lui-même : c’est juste pour ça qu’il apparaît ».
Valère Novarina, Le théâtre des paroles.
Les historiens nous l’on montré, tout au long de l’histoire humaine la délicate implication réciproque de la singularité et du commun aura connu une évolution telle que, dans la géométrie variable de ce rapport, l’émergence, plutôt tardive, de l’individu s’est progressivement changée, une fois son importance reconnue et revendiquée de façon de plus en plus impérieuse, en cette sorte de solipsisme que nous connaissons à l’heure actuelle où ne règne plus qu’un ego monstrueux. Moi seul reste et je suffis, je me suffis, pourrait-on formuler dans une paraphrase de l’antique formule théologique particulièrement adaptée à ces temps où la technologie semble faire aujourd’hui de l’individu naguère simplement roi, un véritable dieu, doué, comme Dieu, d’ubiquité numérique et d’une toute puissance dont ses avatars électroniques et les fantasmes qu’ils produisent l’assurent en le réconfortant. Mais en servant d’écrans de fumée derrière lequel cacher ses audaces, le plus souvent stupides, l’interface universelle et désormais obligatoire de la technologie réduit la cache numérique à un leurre qui trompe d’abord celui qui précisément croyait s’y rendre invisible. À moins que comme un tour de prestidigitation ontologique, elle ne le fasse tout simplement disparaître.
Tel est, me semble-t-il, l’état des lieux dans lequel une extrême minorité d’illuminés s’obstine à ménager, baliser, occuper, étendre même, s’il se peut, l’espace d’une étrange activité que d’aucuns, fort nombreux, semblent juger obsolète : l’art. « There really is no such a thing as art, there are only artists », disait déjà Gombrich, dans les années cinquante, annonçant ainsi le tristement célèbre aphorisme thatchérien : « there is no such a thing as society » (1987). Le propos est le même, qui remplace la transcendance par une simple juxtaposition », l’état ou la communauté par une multiplicité toute bête et la théorie de l’art par une interminable théorie (au sens de procession ou de file) d’artistes incapables même de se dépasser en cette transcendance qu’est la pensée critique et programmatrice, pour ne pas dire simplement imaginative. Car ici, l’un et le multiple ne sont plus dans un rapport dialectique, l’un n’est plus que le multiplicande de l’autre, le nombreux et même l’innombrable, le seul qui compte. Et, artiste, on fait, comme monsieur Jourdain de la prose, de l’art sans savoir qu’on en fait, ni même qu’il existe, avant notre apparition individuelle et notre intervention dans le monde, une chose qu’on appelle l’art.
L’art et la vie, l’art noyé dans la masse et l’indifférent
Et cela revient à dire qu’il n’y a que le « réel », indépassable et même impensable, parce qu’indisputable, évident, infrangible, tout englobant. Un fait est un fait est un fait est un fait : le réel est un fait, la vie est un fait, je suis un fait, et ils sont tels qu’ils sont, je suis tel que je suis, point barre. Ainsi parle la vulgate du XXIe siècle et la vérité dit son fait à chacun, départageant mon fait du tien: le « vrai » monde, la « vraie » vie sont les arbitres de nos songes et même de nos actions, ils déterminent le terrain au-delà duquel nous n’avons plus lieu d’être.
Ouvrons pourtant une brèche négative dans cet étouffoir positiviste : ce qui a obstinément lieu d’être, c’est, justement, ô Mallarmé, le lieu, c’est-à-dire, « peut-être » l’exception de la constellation. Non pas celle de la multiplication aveugle qui noie toute singularité dans la masse indistincte, mais celle qui propose, à l’intérieur même de l’espace de la vie, une marge, une respiration, un au-delà ; « Life is not enough », disait le dramaturge britannique Howard Barker. Il est tout de même étrange de voir qu’à une époque où, plus que jamais, la science nous apprend que la vie est infiniment plus variée que nous ne le croyons et qu’elle ne répond pas à ce que nos sens perçoivent, la plupart pensent encore que la vie est une et qu’on sait suffisamment ce qu’elle est pour pouvoir écarter ce qui n’est pas elle ou ce qui, en elle, n’est pas vrai.
On remarquera que la plupart des formules qui historiquement parlent de l’art dans ses rapports à la vie tiennent implicitement le même discours sur la vie ou le réel, son autre nom. Même la célèbre formule de Filliou : « l’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art », avec le rôle de révélateur qu’y tient l’art tout en s’en trouvant lui-même dévalué, place l’art dans une position de supplément, comme un réactif venu d’ailleurs dont on peut se débarrasser une fois son travail fait, à moins qu’il ne faille constamment y faire appel pour prouver sans cesse qu’il n’est qu’un outil magnifiant, un adjuvant dévalorisé. Ou une thérapie individuelle, comme Le Clézio déplorait qu’un jour on en vint peut-être à le penser, compte tenu de la place actuelle de l’art dans le discours social et individuel.
Il est temps de proclamer que oui, l’art existe et il n’est pas dans un rapport plus ou moins lâche, plus ou moins véridictoire, avec la vie, il est dans la vie, irrémédiablement ; il est l’une des modalités de la vie des humains, une de celles qui conjoignent de façon critique, de façon négative, l’être humain et son lieu d’être, sa conscience et son corps, son intelligence et ses sens, son esprit et sa viande. Le moi et l’Autre.
Naïvement, mais aussi démagogiquement, une nuée de médiateurs culturels pense, en Occident, réduire ce hiatus, combler le fossé creusé de toute éternité entre l’art et la vie et rendu de plus en plus profond par les efforts des populistes de tous poils, en utilisant l’argument par excellence de la publicité, cette grande médiatrice qui est en grande partie responsable de l’émergence de la société du spectacle dénoncée par Debord : le slogan, parfois implicite, mais le plus souvent explicite, « vous êtes formidable, vous en êtes capable, vous en êtes digne, vous le méritez ». Ainsi ces bons apôtres vont-ils répétant au citoyen lambda de bonne volonté qu’il est plein de créativité, qu’il est un artiste et qu’il n’a qu’à oser s’exprimer. Passons sur le caractère fallacieux de cette affirmation, intéressée, comme toutes les pubs : il est indéniable que la créativité n’est certainement pas la chose du monde la mieux partagée, pas plus que le bon sens d’ailleurs, n’en déplaise à Descartes. Mais notons qu’elle représente une des innombrables contrevérités dont se forme, s’étend, se gonfle l’ennemi le plus mortel que l’humanité ait eu à affronter : la masse.
La masse, c’est l’indifférencié, l’indistinct l’« ordinaire », le nombre qui se sent fort et s’impose dans l’anonymat et le bon droit sans questionnement. C’est à sa présence, à son empire de plus en plus étendu que l’on doit cet extravagant oxymore : « culture de masse » que l’on ennoblit parfois d’une connotation surannée en le travestissant en « culture populaire », comme si le peuple présent ici était le même que la classe sociale que le terme exprime, alors qu’il ne désigne bien évidemment que la « popularité », c’est-à-dire le nombre. La culture populaire, ce n’est que la culture de la masse, celle que les « industries » culturelles fournissent à leurs clients ; ce n’est pas une culture, c’est une aliénation, comme le prouvent l’indiscrimination sur laquelle elle repose, la répétition du même dont elle abreuve ses « fans » et l’adulation qu’en guise d’admiration et d’émulation, leur inspirent les « idoles » qu’elle leur érige. Car si l’admiration élève, l’adulation, elle, courbe et agenouille.
Aussi bien les idoles avec leurs fans innombrables et indistincts que la participation de tout un chacun à l’un de ces dérivatifs qu’est la culture encadrée de talents prétendument cachés, courtisent la masse et produisent de la masse. Notre civilisation karaoké repose sur l’exaltation de l’amateur, du touriste, du chaland culturel qui tue le temps en faisant de l’art sans aucune connaissance ni pratique - c’est-à-dire combat avec une matière au point de faire corps et esprit avec elle - et auquel des préposés font croire qu’il est quelqu’un alors qu’il est n’importe qui et que la créativité qu’on prétend susciter en lui ne concerne que lui et n’a aucun effet sur le monde. Parallèlement, l’idole n’a de cesse de montrer et de dire qu’elle n’est, jusque dans son empyrée médiatique, qu’une personne « ordinaire ».
La société du spectacle est aussi, est d’abord une société de masse. Une société où l’aliénation est devenue pour tous une seconde nature.
De la distinction, prise deux
Si le substantif « théorie » a, comme je l’ai dit, gardé en français le double sens qu’il avait en grec où, verbe et non substantif, il voulait dire tout uniment : « observer, examiner, contempler », puis « assister comme spectateur aux Jeux olympiques » avant d’opérer une sorte de torsion à 180 degrés en signifiant « représenter sa cité aux Jeux olympiques », c’est que les racines de la pensée occidentale fondent une solidarité entre voir et se faire voir, distinguer et être distingué, être distingué au point de faire partie, élu, d’une délégation, d’une députation. L’autre mot à double sens appartenant au même paradigme, « représentation » nous rappelle, lui aussi, que théâtre (et, pourrait-on dire, art) et démocratie vont de pair, comme leur invention, absolument contemporaine en terre grecque, nous le disait déjà. Car il s’agit dans les deux cas de représenter l’autre sans se fondre en lui, de représenter n’importe qui ou quoi sans faire masse et, du même coup, détruire toute représentation, puisque pour représenter il faut faire un pas de côté, se distancier, se déprendre.
Le XXIe siècle ne sera pas religieux comme le prédisait Malraux, parce qu’il n’a plus aucun sens du sacré, de l’autorité - ni celle des œuvres ni celle des faits -, de ce qu’on ne reconnaît que dans la distance, la distance de soi à l’Autre, mais aussi de soi à soi qui en découle, la différence produisant la conscience. Le XXIe siècle ne sera pas religieux parce qu’il n’en finit déjà pas d’être terre à terre, premier degré, sens littéral, fusion dans la masse, participation à l’informe, démission de soi à force de ne penser qu’à soi. Et c’est ce dernier paradoxe qui, collectivement, nous tue.
Pourtant, la formule « je me représente » devrait être entendue dans son sens classique d’allusion à la fois à quelque objet du monde et à celui, moi, qui le distingue entre tous les autres objets du monde. Je me représente la voute étoilée au-dessus de ma tête aurait pu dire Kant, en quête d’une loi morale qui soit un accord au monde, belle façon de conjuguer le soi et l’Autre.
C’est cette solidarité fondamentale entre l’œil et ce qu’il voit, entre ce qu’il voit et la façon dont il se voit lui-même, mais surtout entre le regard et ce que littéralement lui renvoie le monde, une forme de regard, que souligne, par un jeu de mots le titre d’un essai de Didi-Huberman : « Ce que nous voyons, ce qui nous regarde » ; c’est cette solution de continuité que l’art met encore en branle, mais jusqu’à quand ? Car collectivement désormais, nous ne voyons que ce qui nous concerne et ne nous concerne que ce que nous daignons voir. Nous avons comblé la distance que maintenait encore la formule de Didi-Huberman, par cette virgule fort duchampienne. Surtout, nous avons figé le mouvement dialectique qui l’animait. Nous sommes prisonniers d’un cercle vicieux ou d’une spirale fatale où la liberté se défait, où l’individu s’abolit, où la conscience s’éteint.
La réciprocité du regard, jeté sur le monde, sur l’autre, et renvoyé par cet Autre qui n’est pas moi, était au cœur de la pensée grecque ; elle déterminait même le fameux gnothi seauton, connais-toi toi-même auquel il faudrait ajouter : si tu veux connaître le monde co-naître avec lui, puisque l’Homme est cet infléchissement de l’univers, ce pli du réel où il nous faut, tous et chacun, advenir, selon le mot de Freud à propos du sujet. La formule de Didi-Huberman dit bien cette implication réciproque de l’Homme et du monde, du réel et du sujet, de la vie et de l’individu (et du groupe), de l’Être et de l’étant, pour parler heideggerien. Là où c’était, où le ça était, il me faudra advenir disait Freud (traduction libre de « Wo Es war, soll Ich werden ») ; tout se passe comme si de nos jours, nous comprenions la formule à l’envers : là d’où je suis, il me faut m’abolir dans ça! Faire nombre, faire masse.
L’abandon à la masse et l’exacerbation identitaire sont les deux moments de ce binôme de l’extinction, non pas que l’un s’oppose à l’autre, mais parce que l’un mène à l’autre, sans dialectique ni distance. Herbert Marcuse et son Homme unidimensionnel (1964) auront finalement été encore plus prophétiques qu’on ne l’a cru à l’époque, car s’il est un temps où l’homme s’achemine presque irrésistiblement vers l’unidimensionnalité, c’est bien le nôtre qui voit toutes ces poussières de masse que sont les individus non seulement se penser commedes blocs inamovibles, des entités unifiées au point d’être monolithique, mais projeter cette image fantasmatique sur le corps social et le monde en se donnant raison envers et contre tous, en se préférant à tout, mais en le proclamant à toutes occasions et à tout propos comme le premier Trump venu.
La spirale mortifère et l’échappée créatrice
Nous sommes pris aujourd’hui dans une spirale qui fait que toutes les forces centrifuges de l’ouverture à l’Autre se changent insensiblement, mais irrésistiblement en force centripètes de repli sur soi jusqu’à ce stade où chacun se perçoit comme une île ou, au mieux, comme partie constituante d’un archipel. Et ce mouvement va dans les deux sens. Voyez, par exemple, le repli forcené devenir abandon total à l’indistinct : qu’il suffise d’évoquer le navigateur solitaire écumant les réseaux sociaux en quête d’un point d’exclamation d’existence - like ou commentaire ou « pensée » - à insérer dans le grand déferlement d’ego, d’une seconde d’attention à obtenir du nombre indistinct et incernable, d’une petite bulle à faire surgir comme un grumeau dans la grande soupe populiste qui va l’y faire disparaître aussitôt, le temps d’un brassage produit au rythme de la machine, cette machine conçue pour qu’un clou chasse l’autre, qu’on disparaisse à peine apparu, vite, toujours plus vite. À moins qu’on ne se fonde dans un mème et qu’on devienne « viral ». Ou qu’on soit élu « influenceur », c’est-à-dire directeur de conscience au service du dieu de la consommation. Ainsi la masse se brasse-t-elle elle-même, ainsi elle s’accroit sans cesse de tous les individus qui s’y noient en pensant s’en sauver.
Autre exemple, cette curieuse forme de néguentropie qu’on peut voir à l’œuvre dans certaines revendications. Dans la dynamique sociale, en effet, toute majorité tend invariablement à excréter des normes qui finissent par lui faire vivre un fantasme d’unanimité. À l’inverse, les minorités contemporaines, qui naissent de ces normes trop contraignantes, n’ont de cesse d’amalgamer leurs diversités pour faire nombre et, pourquoi pas, masse : quel plus bel exemple de cet effet pervers que la déclinaison apparemment inépuisable de l’alphabet des préférences sexuelles, LGBT etc. ad lib, qui a fini par inclure la non-préférence et même la non-sexualité! Et sur ce plan, nous sommes sans doute à l’aube de voir la boucle de cette déclinaison se refermer sur l’inclusion prévisible d’un H2 qui pourrait dire l’hétérosexualité venue enfin s’ajouter à l’homosexualité et s’amalgamer à elle. Ainsi, la masse se sera-t-elle refermée sur elle-même. Et les censurés d’hier seront devenus les censeurs d’aujourd’hui, avec comme premier décret l’interdiction de cité du mot « censure ».
L’art d’aujourd’hui n’échappe pas à cette spirale ou à ce cercle vicieux, il en est tout entier contrefait. Éprouvant parfois, en effet, le besoin de limiter sa temporalité à une génération - et l’on sait à quel point les générations sont courtes de nos jours - il arrive depuis peu que l’art tienne à se dire « actuel » plus que simplement « contemporain ». C’est un signe des temps, un signe, surtout, d’un espace soucieux de se restreindre et de se distinguer de façon particulièrement pointilleuse de tout ce qu’il ne veut pas voir assimiler à lui.
Comme tel il joue la dispersion, l’explosion, le centrifuge jusqu’à l’hapax, jusqu’à la revendication d’un art qui ne repose que sur l’ego, impérieux, souverain, de son faiseur : il n’y a pas d’art aussi actuel, aussi pertinent, que celui que je fais ; et je suis le seul à le faire. On dirait, en termes heideggériens, que le Dasein dont la modalité spécifique est l’art se coupe de tout ce qui d’autre et de l’autre pourrait y concourir, c’est-à-dire nommément son historialité et ses prolongements. Loin de toute représentation, l’art ne se partage plus : il n’est qu’un tracé du sujet. Et ne se reconnaît comme paradigme que des copinages générationnels. Il est ainsi fait d’allusions en forme de connivence, de stricte contemporanéité biographique, au plus petit dénominateur commun, celui de la culture « populaire », chansonnettes et imagerie kitsch, attachée au parfum de « teen spirit » comme disait l’autre ou répercutant encore et encore la « pop culture » et le « pop art » qui n’en finissent plus, pub entre toutes les pubs qu’il prétendait moquer et déconstruire, ne serait-ce qu’en répétant ses images, de nous pourrir l’imaginaire. Et d’éradiquer toute créativité.
Or, Bakhtine avait raison, l’œuvre est foncièrement dialogique, mais tout dépend des modalités du dialogue : dans l’art non strictement « actuel », mais qui peut être contemporain, l’artiste entretient un dialogue avec lui-même, avec l’art, son histoire et son aura, et avec un public qui est cet anonymat d’altérité qui se lève à l’horizon du soi et peut n’être, aussi bien, qu’un autre lui-même, fantasmé ou surmoïque. Sur ces diverses formes d’altérité plane un fantôme désormais suranné : l’autorité. Il faudrait entendre la quasi-homonymie qui unit altérité et autorité et souligner que, contrairement à ce que nous dit la vulgate de l’air du temps, l’autorité ne s’attache pas nécessairement à une institution, à un pouvoir, à une structure sociale ; elle naît aussi, plutôt qu’elle ne s’impose, d’une œuvre ou d’une action, jamais d’un simple fait, tant qu’il n’est pas avéré, c’est-à-dire distancié; et elle, agît, cette autorité sans institution, par séduction, persuasion, voire envoutement, c’est-à-dire appel à l’appropriation, mais dans la distance que suppose toute rencontre, toute altérité, toute différence et même toute différance à la Derrida, puisque la distinction est aussi un délai, le retrait un futur, le proche un prochain.
On évoquera ici le magistral incipit de Jacques le fataliste de Diderot : « Comment s’étaient-ils rencontrés ? Par hasard, comme tout le monde. Comment s’appelaient-ils ? Que vous importe ? D’où venaient-ils? Du lieu le plus prochain, où allaient-ils ? Est-ce que l’on sait où l’on va ? Que disaient-ils ? Le maître ne disait rien et Jacques disait que son capitaine disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas était écrit là-haut ». Ici, le philosophe de la liberté feint d’offrir à son protagoniste une anagké à la grecque. Mais tout commence par des questions et par une rencontre, qui ouvre, littéralement « le lieu le plus prochain », celui de l’imminence de l’Autre, comme un ailleurs immédiat où apparaîtra celui qui est, dans tous les sens du terme, y compris le sens catholique, mon prochain. Sortis de limbes problématiques les personnages émergeant « par hasard » dialoguent et se renvoient la balle du langage, ce lien qui ne ligote personne, mais renvoie toujours à quelque autorité, un capitaine ou un ailleurs là-haut. Mais ce qui compte, c’est que tout est parole, parole répercutée à peine prononcée et parole qui vient toujours d’ailleurs : tout est cité, mais tout est encore à venir et tout se joue sur la scène de maintenant. Beckett se souviendra de cette ouverture fracassante, dans un autre incipit génial, celui de l’Innommable : « Où maintenant. Quand maintenant. Qui maintenant. Sans me le demander. Dire je. Sans le penser. Appeler ça des questions, des hypothèses. Aller de l’avant, appeler ça aller, appeler ça de l’avant ».
Nos deux auteurs disent on ne peut mieux le Big bang de toute création qui à la fois fonde et dissémine l’altérité, celle des personnes et celles des temps, apparié au gré d’une mélodie toujours à remodeler.
C’est à ce prix que, pour reprendre les mots du Novarina de mon exergue, l’être peut apparaître de s’être, justement, retiré! Ce qui nous renvoie encore à Diderot, dont le Paradoxe sur le comédien, insistait déjà, en rapport avec la représentation, justement, sur la nécessaire distanciation de l’acteur se retirant de lui-même pour mieux faire exister son rôle.
Se perdre pour s’ancrer dans l’être : la représentation comme mesure de l’altérité
Tout sujet créateur risque tout de lui-même chaque fois qu’il se dissémine en œuvre. Et ce lieu de frayage qu’il aménage patiemment, c’est le lieu de l’Autre, un lieu qu’il faut savoir habiter pour finir par enfin devenir soi. Jusqu’au prochain éclat.
Mais en ces temps déraisonnables, l’espace social n’est plus ce lieu où les diversités apprenaient à s’accommoder mutuellement, à se tempérer réciproquement, c’est devenu un territoire de concurrence que se disputent toutes les représentations. La foire d’empoigne a remplacé celle des vanités. Et comme la représentation n’est plus que projection médusante, le théâtre s’efface au profit d’une téléréalité permanente qui fausse le sens du préfixe grec télé : au lieu d’exprimer la distance, il traduit désormais son écrasement dans le leurre, le faux semblant, l’écran de fumée, comme celui qui, au sens propre boucanant, remplace, maintenant depuis des lustres, le rideau de scène et le brigadier. Signe que pour nous le virtuel n’attend plus d’être actualisé, comme autrefois : il est dans le réel, il est le réel, bien plus nocif, même qu’on ne sait quel plein pied naïf entre la scène et la salle ; et si les acteurs aussi parfois montent sur scène en traversant la salle, ce n’est pas comme ils le croient ingénument pour dire qu’ils surgissent littéralement de l’anonymat des spectateurs, comme s’ils étaient l’un ou plusieurs d’entre eux, comme si celui que la scène distancie et représente sortait enfin du miroir pour passer de l’autre côté de la fiction en fissurant le quatrième mur qui, le tenant à distance lui donnait justement tous les pouvoirs, y compris celui de s’investir dans la représentation, mais en y jouant son quant à soi. C’était d’ailleurs, ce retrait agissant, cette distanciation avant celle de Brecht, la principale leçon du théâtre grec et de la catharsis d’Aristote : que ces personnages disproportionnés, jamais égaux au spectateur, toujours soit trop grand soit trop petit, lui offrent un déséquilibre, un vertige d’où se déprendre en déterminant, en regard d’eux, son bien à lui dont on sait, connaissant la civilisation grecque, qu’il était toujours ce juste milieu qu’on assimile à tort à une moyenne alors qu’il n’est que la mesure individuelle et sociale du juste chemin à négocier à chaque fois, par chacun entre les extrêmes de la scène, et par tous parmi les différences adverses de l’agora. « Metron to beltiston », « la mesure est le bien suprême », fait dire Sophocle à l’un de ses personnages. La mesure est toujours, en fin de compte, la bonne triangulation qui vous dit où vous êtes par rapport à l’Autre et où il est par rapport à vous.
Nous sommes au siècle de la démesure.
À l’heure où les signes s’envolent loin de leur système de référence, comme ces tatouages maoris sur des corps de banlieusards rangés, ces piercings et ces scarifications sans Afrique, chacun pense que changer de peau ou d’avatar cybernétique suffit à se construire une identité impérieuse, mais insaisissable. Et évidemment, il se retrouve vite avec des millions de semblables accrochés à des signes semblables comme à des planches de salut. Et toutes ces virtualités grouillent dans le numérique comme autant de simulations du réel, pourtant toujours réputé infalsifiable et infaillible. Tous les cyberhumains s’avancent maintenant à côté de leurs pompes avec toute la pompe de leur automagnification. On se représente à tout venant sous les traits en pixels pulvérulents d’images de synthèse. Virales, comme ils disent. Comme autrefois les barbares aux portes de l’Empire romain, une infinité de nocivités nous assiège. Mais les virus sont aussi dans nos murs, car nous sommes, nous-mêmes, ces virus de l’altérité confondante pour lesquels il n’est pas de vaccin.
S’agissant de représentation, au sens politique, cette fois, quel plus beau cercle vicieux que celui qui voit la frange la plus pauvre et la moins instruite d’un pays se sentir représentée par un milliardaire ? Et ces deux pôles, ces deux bornes, comme électrisantes, produire par leur mise en rapport la masse d’une majorité fût-elle silencieuse. Masse qui ne rompt le silence que par la voix unique, tonitruante, omnipotente, omniprésente d’une baudruche qui, comme un dieu de pacotille, finit par être partout et nulle part, insaisissable jusque dans ses raisons, inévitable par l’incohérence de ses interventions qui en arrivent à coïncider avec la plus infime seconde de notre durée. Ainsi l’idole intouchable, parce qu’elle incarne le nombre dans l’incernabilité, l’imprécision menaçante et péremptoire que donne à ce dénombrement son déploiement ad infinitum, pour ne pas dire ad libitum, ainsi l’idole représente-t-elle, mais sous la forme d’un choix, ce qui chez ses adorateurs n’était que destin : l’ignorance, le désintérêt de tout ce qui n’est pas soi, individuellement et collectivement, la monstruosité d’un fantasme dont la réalité serait symptôme infaillible de folie. Moi qui ne veux rien savoir, rien connaître, rien admettre, je vous rendrai votre grandeur d’ignorants besogneux, de minus habens sans ambition autre qu’économique, de fiers contempteurs de toute transcendance. Vous n’êtes rien, soyons tout… par moi, pourrait être l’hymne de l’internationale du populisme.
Car le populisme et ses paradoxes représentent bien, décidément, la maladie infantile du XXIe siècle. À moins qu’elle ne soit l’affection, au contraire sénile, des siècles démocratiques qu’elle ronge comme un cancer monstrueux.
Par définition, la démocratie est vocale, le populisme lui, démagogie majuscule, se prétend la voix d’une majorité obstinément silencieuse qui se prétend majoritaire justement parce qu’elle est silencieuse, donc « massive », si la masse ici est bien l’indistinction du silence ; et comme cette indistinction autorise toutes les bouffissures, toutes les extravagances fantasmatiques, sitôt postulée, la majorité se projette unanimité : celle, magique autant qu’imaginaire, sur laquelle repose tout pouvoir un peu fort. Celui qui, au nom de la masse, parle toujours d’une seule voix, autocrate, fasciste, quand le pouvoir de Big brother dit, après d’autres : « l’état, c’est moi ». L’état des choses. L’état de la masse. Toujours en expansion. Monstrueusement.
D’un monstre l’autre : Frankenstein et Dracula, Laurel et Hardy du XXIe siècle
Venus du XIXe siècle, deux monstres pourraient servir d’emblème à la folie où nous sommes tombés. Ils servent aujourd’hui de mythe universel et donnent par ailleurs un semblant de profondeur symbolique à la culture « populaire ». Ils naissent de romans, comme on sait, ce qui est extrêmement rare et donc significatif. Le Frankenstein de Mary Shelley (1818), texte furieusement féministe parce qu’il règle notamment ses comptes avec les Lumières de son philosophe de père ouvre le siècle que viendra clore - et là aussi, c’est significatif d’un point de vue historique - le Dracula de Bram Stoker (1897). Ils représentent les deux pôles selon lesquels se distribue mon propos ici : la réduction à l’extrême individualité et la dispersion totale qui noie l’individu (Maltus dirait l’humanité) dans la masse. Et, comme tels, ils forment le ressort de toute distanciation, de toute différence, de toute altérité. En faisant jouer à plein la métonymie, le déplacement, l’analyse d’une part, la métaphore, la condensation, la synthèse d’autre part. Et en se distribuant d’une certaine façon sur deux autres pôles, à la fois logiques, symboliques et langagiers : le syntagme (versant métonymique) et le paradigme (versant métaphorique) dont la conjonction dynamique, la conjugaison, même forme le « principe poétique » de Jakobson, la chose selon moi la plus intelligente que l’on ait jamais écrite sur l’art, le symbolique, l’imaginaire et la logique qui les sous-tend. Mais ceci est une autre histoire, revenons plutôt ici sur nos deux monstres.
Frankenstein, M. Gombrich, c’est au départ le découpage de cadavres (la chose n’est pas innocente), la réduction au membre, à l’organe, à l’élément. Et de cette collection, de cette procession d’unités on espère produire un seul corps, cousu main, pour ainsi dire ; encore y faut-il quelque chose comme une métaphore : l’électricité, en quelque sorte une transcendance interne (un courant qui repose et crée à la fois une force ou un mouvement entre deux pôles), mais externalisée du point de vue de Victor Frankenstein, le « Prométhée moderne » de Mary Shelley. Il manque à la vie de la chair inerte, faite d’un bric-à-brac collectionneur, un principe, un souffle, une entité susceptible de l’animer en dépassant le simple horizon factuel. Et si c’était ça, M. Gombrich, votre art qui n’existe pas ?
Quant à Dracula, son but, que dis-je son but, sa vie même de mort, l’objectif de l’oxymore ambulant qu’il est, c’est de croître et de multiplier : il a l’âme biblique, le bougre. Bien sûr, on vous dira que cette multiplication folle n’est qu’un dommage collatéral de sa soif de sang[1], que sa malédiction tient au fait qu’il ne peut s’abreuver et ainsi continuer de vivre qu’en multipliant, presque malgré lui, les petits Dracula des deux sexes, mais c’est méconnaître le fait que Dracula, c’est la multiplication même, en son principe. Parce qu’il est le miroir, la mise en abyme absolue, le principe qui s’efface en se posant : voilà pourquoi il n’apparaît dans aucun miroir. Son miroir, c’est la vie des autres, la vie de tous. Il est insaisissable comme l’électricité de Frankenstein, mais il est efficace, comme elle ; il est l’efficacité même. En tant que principe de disparition. Et voilà pourquoi, M. Gombrich, votre procession d’artistes, devient, comme la fille du Médecin malgré lui, muette à la fin de son parcours : la masse n’émet aucun son, elle est comme un trou noir duquel rien ne sort, ni matière ni énergie.
On notera que, dans mon analyse, Dracula, c’est en fin de compte, la négativité « pure », lorsque poussée à l’extrême, elle s’efface d’elle-même rien qu’à s’exercer, Big crunch philosophique s’il en fut.
Reprenons le fil de l’art. Il faudrait pouvoir analyser pas à pas, mouvement à mouvement, désir à désir, fantasme à fantasme, la façon dont l’individualisme extrême a produit l’indistinction fanatique, la folie du tout égal, tout équivalent qui caractérise ce début de siècle. Comment, refusant les maîtres quels qu’ils soient, quel que soit leur domaine et dans quelque champ qu’ils se manifestent, et l’autorité, toute autorité sauf celle que la médiatisation donne au consensus devenu vite unanimiste, nous nous jetons dans les bras des gurus, des influenceurs et de la masse dont ils sont les furoncles. Quand ce n’est pas de nos monstres politiques actuels qui prolifèrent comme des vampires, les vampires qu’ils sont, indéniablement.
Mais il est, en art toujours, d’autres usages, réhumanisés ceux-là, de la négativité. J’en évoquerai deux : Alfred Jarry et Denys Tremblay (dont on a pu lire ici même un texte).
Ubu et Trump, son incarnation contemporaine : exorciser le monstre ou se perdre dans ses reflets
Sentant jusqu’au tréfonds de lui-même grouiller l’altérité monstrueuse d’Ubu, la sentant prête à croître et à tout emporter dans sa masse informe, massive et massifiante, Jarry invente le contrepoison distanciant de la ‘Pataphysique qu’il fait administrer par le Dr Faustroll parti en croisière sur l’altérité[2] et en croisade contre tous les infatués d’eux-mêmes, tous les boursoufflés d’égotisme, les ventripotents du moi. Tous les guerriers du réel sans mystère ni question. Les fanatiques du faire corps. Les exaltés de la coïncidence parfaite avec soi-même.
Rappelons la définition que donne Jarry de la négativité lorsqu’elle se fait pataphysique : La ‘Pataphysique « est la science de ce qui se rajoute à la métaphysique, soit en elle-même, soit hors d’elle-même, s’étendant aussi loin au-delà ce celle-ci que celle-ci au-delà de la physique ». Ou l’on reconnaîtra, jusque dans sa dimension, secondaire, ou parasite, ou mimétique, la négativité de l’art dont je définis le lieu comme une marge paradoxalement interne, l’au-delà de la vie « insuffisante » qu’évoquait Barker, mais un au-delà fiché à l’intérieur même de la vie et ne s’en distinguant précisément que par sa négativité, considérée comme une valeur ajoutée, et non s’effaçant d’elle-même comme chez Filiou. Introduite ici dans une référence implicite à Aristote dont la « métaphysique » - qui a eu la fortune que l’on sait - ne faisait que se dire « après » la physique, comme si elle ne pouvait s’écrire qu’au-delà du monde, après l’analyse à laquelle la physique soumettait le réel considéré comme indépassable, recensable, épuisable, la négativité de Jarry se précise aussitôt en des termes dont on comprendra, si l’on m’a suivi jusqu’ici, qu’ils illustrent eux aussi mon propos : « la pataphysique sera surtout la science du particulier, quoiqu’on dise qu’il n’y a de science que du général ». Où l’on voit à l’œuvre, suturant particulier et général, la définition paradoxale de la « théorie » au sens grec que j’ai évoqué ci-dessus. D’où il découle, continue Jarry, qu’« elle étudiera les lois qui régissent les exceptions et expliquera l’univers supplémentaire à celui-ci ». Enfin, la « définition », dès lors canonique, de la ‘Pataphysique : « La pataphysique est la science des solutions imaginaires, qui accorde symboliquement aux linéaments les propriétés des objets décrits par leur virtualité »[3].
Puisque presque chaque mot ici pèse son poids de réflexion, en particulier « univers supplémentaire à celui-ci », « solutions imaginaires », « symboliquement », « virtualité » ; puisque cette réflexion, on en conviendra, pourrait justifier un livre entier, je me permettrai simplement - et pataphysiquement - de renvoyer à tout ce que j’ai avancé jusqu’ici, confiant que l’intelligence, la sagacité et surtout l’imagination du lecteur lui suffiront à discerner en quoi mes propos « illustrent » tout cela.
Et je me contenterai du raccourci de ces « linéaments » auxquels Jarry recommande d’accorder, « symboliquement » les propriétés des « objets décrits par leur virtualité ». À qui « appartient » cette « virtualité » qui décrit ? Aux objets, comme on pourrait le penser ou aux solutions imaginaires comme la syntaxe de cet émule de Mallarmé qu’était Jarry, rappelons-le, permet aussi de l’envisager ?
Sans entrer dans les détails, faute de temps et d’espace, je me bornerai à signaler que ce qui se désigne ici jusque dans la syntaxe, c’est la négativité mise en branle par la métonymie ici furieusement agissante, puisqu’on invite résolument à prendre la partie pour le tout et le tout pour la partie, sans oublier cette forme particulière de métonymie « chronique » qui transforme la ligne de temps ou la mélodie qu’est le syntagme en espace, celui du paradigme, cette « harmonie », forme particulière qu’on appelle « métalepse ». La métalepse est cette figure de style qui consiste à prendre, pour dire par exemple que quelqu’un est mort, l’antécédent (« il a vécu ») ou le conséquent (« nous le pleurons ». Elle implique que le sujet de l’énonciation occupe une place que je qualifierai de « quantique » ou schrödingerienne, puisque Erwin Schrödinger (1887-1961) est ce savant autrichien, Prix Nobel de Physique en 1933, à qui l’on doit une célèbre équation permettant de décrire deux états de la matière synchrones et antithétiques ou même exclusifs l’un de l’autre, ce qui est l’un des « linéaments », justement, de la physique quantique. Plaisamment, on illustre ce paradoxe mathématique par la fable dite du « chat de Schrödinger » qui voit ledit chat être à la fois mort et vivant.
Dans ce contexte, on peut dire que la métalepse, figure pourtant antique, comme toutes les figures de style, suppose un énonciateur quantique.
À ce stade de ma réflexion, j’avancerai que la négativité peut être à la fois mortelle et créatrice, vivifiante et mortifère, virale et vaccinale si je puis dire. Elle est en effet ce qui mène, j’espère l’avoir montré, de la différence initiale à l’indifférencié final, de l’individu à la masse, pour peu du moins qu’on n’y prenne garde et qu’on la laisse proliférer. Mais si on lui donne un coup d’arrêt, si on la bride, si on l’harnache en l’infléchissant vers la métaphore où « naturellement », stylistiquement, rhétoriquement elle se résorbe et se relance pour encore se fondre aussitôt, elle devient l’un des pôles de toute créativité, puisque celle-ci commence toujours par une analyse, c’est-à-dire un regard renvoyé, une conscience en un mot, toujours née d’un découpage réciproque, solidaire, concomitant du monde et du moi, comme Freud puis Lacan l’ont clairement illustré, après bien des philosophes dont magistralement Heidegger.
L’hypermédiatisation qui insuffle cette baudruche infantile - et infantilisante - qu’est Trump et qui lui donne sa prévalence devrait plutôt se dire panmédiatisation, car c’est tout notre espace-temps qui, de « tweets » incessants en bulletins de nouvelles spéciaux s’en trouve saturé, comme d’une pandémie de signes devenus fous, la métonymie virale et sans contrôle ni relance aboutissant à son contraire : une métaphore totale, immobile, Dieu ou Trump, noms propres de la masse qui va nous éradiquer.
À moins que le quantique ne nous permette de penser d’autres temps, d’autres consécutions, d’autres logiques, d’autres espaces. D’un mot, que l’art nous soit rendu dans sa paradoxale nécessité. Comme le lieu de l’être par excellence : Heidegger n’était pas loin de le dire expressément.
De l’illustre inconnu au roi-sujet élu
On n’a pas fini, et c’est tant mieux, de faire le tour du coup d’éclat post-duchampien de Denys Tremblay. Rappelons ici brièvement l’essentiel, tel qu’il a déjà été décrit et analysé par Hervé Fisher[4].
Le 21 janvier 1997, une petite municipalité du Québec est officiellement entraînée dans une sorte de saut quantique par un artiste, Denys Tremblay, qu’elle avait engagé à des fins très réalistement touristiques pour pallier encore plus réalistement au désastre économique entraîné par une catastrophe naturelle qui avait frappé toute cette région. Tremblay qui jusqu’alors avait promené d’interventions en happenings artistiques et politiques un avatar poétique baptisé ironiquement Illustre Inconnu était ce jour-là couronné roi municipal. Cette érection en « majesté », comme on disait autrefois d’un phallus en bonnes dispositions, d’un artiste - dont l’humour avait naguère justement joué de la chose de façon automobile, comme il joue encore de tout, et en particulier des mots - repose sur une succession de renversements symboliques, foncièrement métonymiques, qui représentent les ondes déclenchées par ce pavé dans la mare politico-socioculturelle.
Le roi est élu, première incongruité à la face de l’histoire, et c’est un roi « municipal », c’est-à-dire une contradiction dans les termes puisque loin de se borner, dans ce cas-ci volontairement, à l’espace de sa cité ou de son fief d’origine - et dans ce cas-ci, la municipalité en question n’est, en plus, pas le lieu « d’origine » de l’artiste - un roi, quel qu’il soit, n’est jamais qu’un nobliau qui a germé, qui s’est poussé du col en écartant souvent violemment ses homologues de la voie royale de la suprématie, au moins locale, mais cette localisation ayant vocation expansionniste : on n’est roi que d’un pays et si possible de plusieurs, comme Sa Majesté Élizabeth II d’Angleterre et son Commonwealth qu’une exposition relativement récente de Denys Tremblay prendra d’ailleurs pour cible, ou plutôt vis-à-vis, un vis-à-vis pataphysiquement spéculaire. Cette double torsion symbolique, c’est-à-dire contemporaine comme tout symbole qui n’existe que par ce qu’il réunit hic et nunc, se double d’une autre, « diabolique » cette fois (puisque le diabolique, en grec, c’est le contraire et le réciproque du symbolique : ce qui sépare, désunit ; c’est en ce sens que Trump, n’en déplaise à ses partisans évangéliques, est foncièrement diabolique), diabolique parce qu’anachronique et dépaysante.
Quand il n’était encore que cette poussière de masse qu’on appelle un « illustre inconnu », mais magnifiée ironiquement par des majuscules qui se lisent comme une revendication amusée, le désormais roi se paraît des oripeaux du Second Empire français, avec son uniforme de « très sous-officier » aisément assimilable à celui d’un gendarme ou d’un pioupiou de l’époque. Il s’autorisait aussi de l’emblématique RF frappant sur diverses surfaces le sigle de la République Française, pour y inscrire sa devise : « je me Régionalise, je me Féminise » et en médailler son ordre de la « Victoire périphérique » (dont j’ai l’honneur d’être moi-même porteur). Dans la foulée il instaure aussi, Napoléon au volontairement petit pied, une « Région d’honneur ». On le voit, le dépaysement est aussi bien chronologique que géographique et si l’on sait qu’il y a à peine un demi-siècle les Québécois appelaient encore la France « la mère patrie », après plus de deux siècles d’abandon, on comprendra toute la charge ironique de cet autre pavé dans la marre socio-politico-culturelle qu’aura représenté l’enterrement solennel, à Beaubourg, par l’Illustre Inconnu de « l’Histoire de l’art métropolitaine » dont il avait fait constater le décès par huissier!
Couronné, le roi devient le parasite ou le virus ironique d’une autre réalité historique socio-politico-culturelle : c’est une sorte de Boris Godounov qui visiblement monte sur le trône le 21 janvier 1997. Mais il se fait couronner par le prêtre de l’église du village et manifestement cette fidélité-là n’est pas ironique ou plutôt ce dernier qualificatif reste indécidable, car le roi ici évoque une sorte de survivance dans un Québec qui, à l’époque, a très largement envoyé promener la religion catholique… qui n’avait jamais en ce lieu couronné qui que ce soit, pas même ses gouverneurs coloniaux, et pour cause.
On pourrait consacrer encore à ce really-made, coup d’état et coup d’art, bien des lignes d’un texte qui n’en a déjà que trop et que, pour cette raison, je limiterai à un strict minimum.
Ce que j’ai qualifié jusqu’ici de torsion, de parasitage, de virulence, je pourrais le résumer maintenant en disant qu’il s’agit toujours, par le biais de métonymies dévoyant ironiquement les métaphores dans lesquelles, comme il se doit, elles viennent se loger, avant de se trouver d’autres métaphores à gruger, ad lib et ad aeternam. C’est l’équilibre « quantique » d’un croisement incessant de la métaphore et de la métonymie, où le principe poétique de Jakobson ouvre cette marge interne, ce paradoxe pataphysique ou quantique, qu’est l’art dans la vie et au-delà.
Voilà, le chat de Schrödinger est sorti de son sac mathématique, c’est-à-dire aussi physique, théorique et pratique, imaginaire et réel, l’un n’allant pas sans l’autre et en même temps l’excluant.
L’entreprise de Denys Tremblay et quelques autres qui restent encore à identifier et dont on peut espérer, parce qu’il y va non seulement de notre survie, mais aussi de notre sauvegarde et, pourquoi pas, de notre salut, est un acte qui met en jeu une logique quantique qu’il nous appartiendra maintenant de savoir habiter. Pour que l’art survive, et aussi bien nous-mêmes, pauvres sujets humains que guettent tous les Ubu passés, tous les Trump à venir, n’en doutez pas, car le vent est à la masse et au populisme qui est son nom humain.
Et maintenant ?
Bien que nous soyons, nous qui croyons à l’art - et quant à moi, M. Gombrich, beaucoup moins aux artistes, formassent-ils une procession magnifique - une minorité qui diminue sans cesse, contrairement à celle des premiers chrétiens dans leurs catacombes et que loin de conquérir l’Empire il soit sans doute en train de s’effondrer sur nos têtes, il faut proclamer haut et fort, urbi (ubu ?) et orbi, qu’il s’agît là de l’espace qu’on pourrait dire, à la grecque, « théorique » par excellence de l’humanité, puisque contrairement à la science sa cousine, il n’est pas limité par son objet, n’en ayant pas en propre et même ne pouvant en avoir aucun, un peu comme la Mathématique, la science dont il se rapproche le plus ; ce rapprochement est d’autant plus pertinent que les deux sont à la fois pratiques et abstraites, l’une et l’autre ayant été instrumentalisées, la mathématique comme outil universel à l’usage de toutes les sciences, l’art comme paradigme de toute illustration, de toute décoration, de tout apprêt, de tout agrément. Hélas.
Hervé Fischer appelle avec l’ardeur qu’on lui connaît à l’érection d’un nouvel humanisme[5]. J’invoquerai, pour ma part, une nouvelle façon de vivre la négativité : une négativité post-dialectique, quantique en quelque sorte, parce que s’exerçant plutôt sur les mises en rapport sans opposition, la co-incidence indépassable des contraires à préserver et non à défaire. Mais pour aller plus loin. À l’intérieur de nous-mêmes et au plus près du monde.
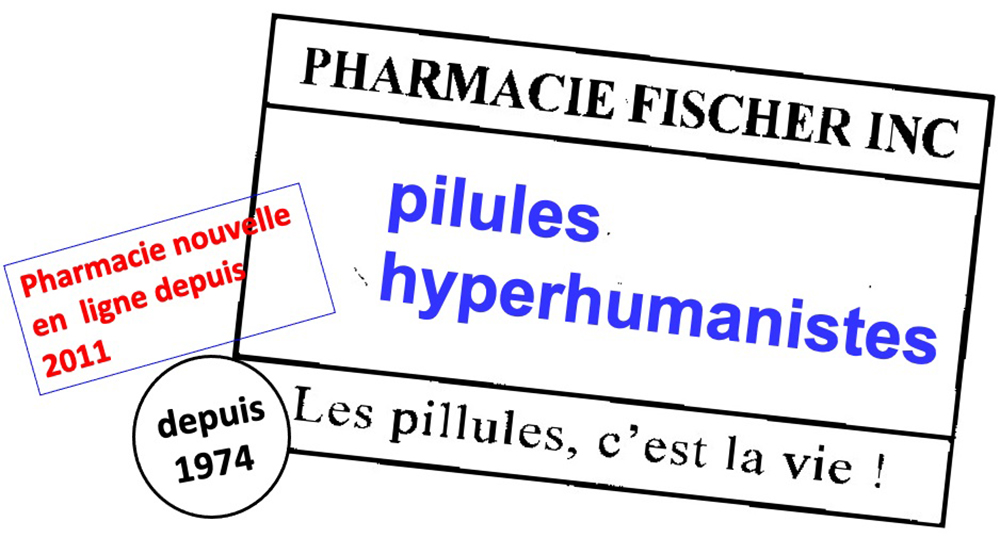
Notes
[1] À ce sujet, voir mon article : Sucer le sens : l’éternité au compte-gouttes, Cahiers de l’Herne, numéro spécial dirigé par Charles Grivel, De la mort à la vie : Dracula, Paris 1997, pp. 117-122.
[2] Alfred Jarry : Gestes et opinions du Dr Faustroll, pataphysicien, 1898, édité en 1911.
[3] Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien, Livre II, Chapitre VIII « Éléments de Pataphysique », Alfred Jarry, Œuvres complètes, tome I, Bibliothèque de la Pléiade, pp. 668-669.
[4] Un roi américain, VLB éditeur, Montréal 2009, 216 pages.
[5] L’Âge hyper humaniste, pour une éthique planétaire, Édition de l’Aube, La Tour d’Aigues, 253 pages.