Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université d’Aix-Marseille, ses recherches s’inscrivent dans une perspective interdisciplinaire. Après une thèse sur La vie politique saisie par le droit privé, Presses universitaire d’Aix-Marseille (2006), elle s’est intéressée aux liens existants entre le droit et les neurosciences mais également et, en contrepoint, aux liens entre le droit et l’imaginaire (mythes, littérature). Parmi ses principales publications : Neurosciences et droit pénal (L’Harmattan, 2015) et Mythes grecs et droit (Presses Universitaires de Laval, 2017).
Abstract
Peut-on assigner une fonction éthique à la littérature sans pour autant la dénaturer, la finaliser, la réduire à l’instrumental ? On sait depuis les travaux de Ricoeur que la fiction littéraire peut être considérée comme un « laboratoire du jugement moral » et qu’il existe des liens entre le narratif et le prescriptif. Non seulement le prescriptif est nécessairement formulé sur le mode du narratif, mais le narratif est en tant que tel porteur d’exigences éthiques. Cette approche de la littérature, impliquant le lecteur dans des conflits de valeurs et de normes et lui offrant un enseignement par expérience imaginative, est défendue par certains philosophes comme Martha Nussbaum, dont les travaux trouvent actuellement un écho important dans les études juridiques. Cela étant, peut-on considérer la littérature en elle-même comme une entreprise fondamentalement éthique ? La question doit demeurer ouverte si l’on veut éviter de faire de la littérature un catalogue de prescriptions. Son rôle n’est pas de prescrire une certaine morale. Car elle est justement un moyen pour exprimer la complexité qui caractérise la vie éthique.
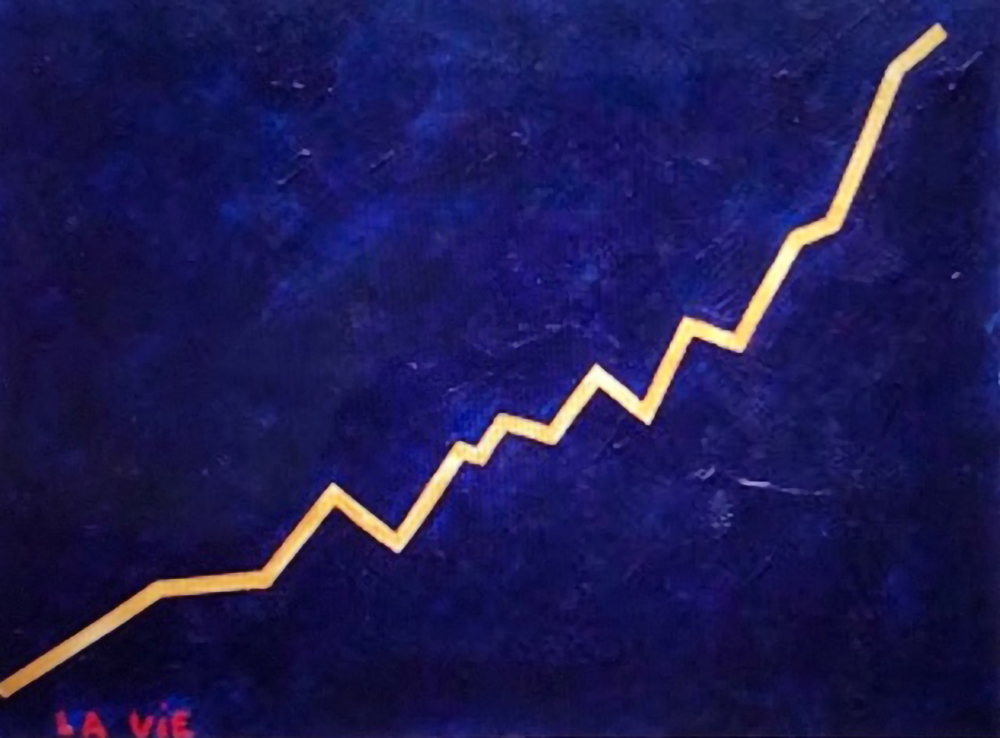
La vie, Hervé Fischer, acrylique sur toile, 2000.
En 1940, Gide écrivait : « ce n’est pas avec de bons sentiments qu’on fait de la bonne littérature ». Moins d’un siècle plus tard, des éditeurs annoncent qu'ils ne commercialiseront plus les livres de Gabriel Matzneff, dans lesquels il relate ses relations pédophiles. Concomitamment,de plus en plus de recherches sont aujourd’hui consacrées à ce qu’on appelle le « tournant éthique de la littérature » [1]. Comment doit-on alors repenser la relation entre l’éthique et la littérature ? Plus largement, peut-on assigner une fonction éthique à l’art, sans pour autant le réduire à l’instrumental ? Et peut-on le dissocier de l’esthétique ?
Si l’on s’en tient à la littérature, au sens strict, le terme renvoie à « l’ensemble des œuvres écrites auxquelles on reconnaît une valeur esthétique ». La notion d’esthétique comme critère distinctif est toutefois d’un usage délicat. On retiendra plutôt celle de « fiction ». Le latin fingere, d’où est issu le participe passé fictum, désigne à l’origine le fait de « modeler dans l’argile », c’est-à-dire l’action concrète du potier dans le registre de l’artisanat. C’est par extension qu’il en est venu à signifier « façonner, reproduire les traits, représenter », puis dans un sens abstrait, « imaginer, inventer ». Ainsi la fiction artistique est-elle une œuvre de l’esprit qui s’exprime le plus souvent sur un support matériel et dont l’objet est de représenter une réalité absente [2].
De cette double dimension, à la fois concrète et abstraite, naît un rapport ambivalent à la réalité. Assurément, la fiction n’est pas la réalité. Néanmoins, elle ne lui est pas totalement étrangère. Toute fiction se présente en effet comme un scénario sur le monde. Elle déforme le réel, élabore des « contre-mondes ». Mais en insérant un filtre entre l’individu et le monde qu’il occupe, la fiction contribue à le transformer. Loin d’être purement fabulatoire, elle comporte une dimension performative.
Or, il n’en va pas autrement de l’éthique ou même du droit, qui font partie de ce que l’on peut appeler l’ordre prescriptif (ou normatif). Relevant du devoir-être, ces superstructures constituent autant de mythologies sociales. En tant que telles, elles sont pétries de fictions. Certes, lorsqu’on met en perspective l’ordre prescriptif et la création littéraire, on se heurte à un sérieux problème d’altérité. D’un côté, les conflits de valeurs, les affaires sérieuses, le bien, le mal ; de l’autre, la fantaisie, l’imaginaire, l’invention, la futilité, le caprice.
Cependant, cette apparente altérité mérite d’être repensée. C’est qu’entre le narratif et le prescriptif les liens sont étroits. On doit à Paul Ricoeur d’avoir présenté la narration comme une transition entre la description et la prescription, et ce faisant, d’avoir rompu avec toute une tradition de pensée issue de David Hume, pour laquelle le devoir-être s’oppose à l’être sans transition possible. Pour Ricoeur, il existe une continuité entre la description des faits et la prescription, qui passe par la narration. C’est dire que le prescriptif a besoin du narratif pour faire sens. Et c’est dire aussi que si le narratif fait sens, c’est parce qu’il est déjà, en lui-même, porteur d’une exigence normative. Car, le récit est riche en anticipations de caractère éthique.
Cette approche de la narration, impliquant le lecteur dans des conflits de valeurs et de normes et lui offrant un enseignement par expérience imaginative, est aussi défendue par certains philosophes comme Martha Nussbaum [3], dont les travaux trouvent actuellement un écho important dans les études juridiques. Les relations entre le droit et la littérature sont au centre de réflexions, qui ont été initiées dans les pays anglo-saxons où la méthode d’enseignement par cas les favorise, puis développées en droit continental où elles permettent de renouveler en profondeur la théorie juridique. On sait grâce à François Ost à quel point les écrivains peuvent contribuer à conserver, ou à transformer, l’imaginaire juridique [4]. Entre le « tout est possible » de la fiction littéraire et le « tu ne dois pas » de l’impératif juridique, il y a interaction au moins autant que confrontation. Cette interaction est réciproque en ce sens que d’une part, le droit se présente lui-même comme un ensemble de fictions, d’autre part, la littérature peut avoir une valeur éthique que le juge, dans son office, a tout intérêt à prendre en considération.
Néanmoins, aujourd’hui, lorsqu’on parle de littérature éthique, cela va plus loin. Ce n’est plus seulement la critique qui se définit comme pouvant être de type éthique (c’est-à-dire qui propose, à la suite de Martha Nussbaum ou de Paul Ricœur, une approche des textes s’intéressant à des questions d’ordre éthique), mais la littérature en elle-même qui se voit comprise comme une entreprise fondamentalement éthique [5]. Le glissement d’une critique éthique à une « littérature éthique » fait toutefois courir le risque de l’instrumentalisation. L’éthique serait-elle devenue une mode ? Et nous sentons-nous tellement coupables pour avoir besoin de nous réfugier derrière l’éthique ? La question est à vrai dire très délicate. La littérature, l’éthique et le droit entretiennent des relations extrêmement complexes. On peut y voir des divergences mais aussi des convergences.
I. Divergences
Dans une conférence datant de 1987, Deleuze définit la création comme acte de résistance. Résistance à la mort, résistance à la tyrannie de l’information qui est le propre des sociétés de contrôle, et finalement résistance à l’entropie de toutes choses, puisqu’elle permet de libérer une puissance de vie qui avait été emprisonnée ou offensée. Ce faisant, il rejoint la conception de l’esthétique négative d’Adorno pour qui l’œuvre d’art est avant tout résistance.
Quels sont en effet les traits essentiels de l’œuvre littéraire ? Quel qu’en soit le genre, elle met le donné à distance, déjoue nos certitudes, rompt avec les tournures convenues et suspend nos évidences quotidiennes. Elle est toujours, de quelque façon, une « contre-création », un défi à l’ordre établi. Se livrant à toutes sortes de variations imaginatives, elle est l’expression la plus sûre d’une liberté en acte. Par son indiscipline, la littérature permet de penser la société contre elle-même.
La question des relations entre les œuvres littéraires, la politique et la société n’est pas récente. Pour certains écrivains, la question ne mérite même pas d’être posée. Au XVIe siècle, Malherbe considère qu’« un bon poète n’est pas plus utile à l’Etat qu’un bon joueur de quilles ». Pour d’autres, toute littérature est politique même si elle n’est pas politisée. Les Fables de La Fontaine, par exemple, ne sont pas seulement une satire de ces curieux animaux que sont les hommes, mais aussi une critique, à peine voilée, de la politique menée sous le Gouvernement de Colbert. La neutralité revendiquée de la fiction se révèle dès lors illusoire.
L’idée de littérature engagée constituera le point d’orgue de ce lien jugé nécessaire entre écriture et politique. L’écrivain engagé s’affirme avant tout dans un rôle de témoin universel : il est investi d’une mission d’observation et de dénonciation de la société. Dans les Rayons et les Ombres, Hugo fustige les auteurs non engagés qu’il décrit comme inutiles. Il définit ainsi le rôle de l’écrivain, porte-parole et dénonciateur du peuple, incapable de formuler ses propres craintes et critiques. En 1862, Les Misérables entendaient déjà « faire sauter toutes les institutions sociales » et Sartre rappellera plus tard avec force que « les mots, comme dit Brice Parain, sont des pistolets chargés ».
C’est que la littérature a pour effet de bousculer les conventions. Elle exerce un rôle critique, de remise en question, voire de transgression. Cette capacité subversive, que l’on trouve chez Sophocle, Dante, Kafka, Camus et tant d’autres, atteint son paroxysme avec les anti-Lumières, qui ne croient pas au progrès, méprisent la démocratie et pourfendent les droits de l’homme. Sur ce point, on peut mentionner Sade qui, dans Les Infortunes de la vertu, dresse le tableau de l’injustice sociale. Chaque vertu que cherche à pratiquer Justine finit par se retourner contre elle. Car la littérature s’autorise à dépeindre le mal. Précisément, si l’on en croit Georges Bataille, la littérature est l’expression d’une forme aigue du mal [6]. Pour lui, comme pour Blake, Baudelaire ou encore Genet, la liberté est du côté du mal tandis que le côté du bien est celui de la soumission, de l’obéissance au conformisme. Mais qu’est-ce au fond, se demande Sartre, que cette liberté par le mal, sinon le symbole des enfants désobéissants?
Enfin, un dernier point de divergence se dessine : la littérature donne voix à la part maudite, à l’autre refoulé : elle se fait alors expression de la « pensée du dehors » (Foucault), celle de « l’homme du souterrain » qu’évoquait Dostoïevski. Bref, elle donne voix aux sans-voix, à tous les recalés de la société, à tous ceux qui sont réduits au silence, ceux auxquels la société refuse ou coupe la parole. La littérature est le porte-voix des marges, de l’hétérogène, de l’altérité. On songe ici à la littérature post-colonialiste, multiculturelle, migrante. On songe aussi au Colonel Chabert de Balzac, l’« absent » le plus célèbre de la littérature. On songe enfin à toutes celles dont la parole est disqualifiée parce qu’elles sont des femmes : Antigone, Cassandre, Iphigénie, Electre et tant d’autres, dont la plainte, interdite sur l’agora, se réfugie sur la scène de la tragédie [7]. Dans ces conditions, rien d’étonnant à ce que les écrivains puissent s’exposer à la réprobation et au rejet de la société.
En 1749, Diderot est arrêté pour outrage aux bonnes mœurs pour avoir anonymement publié les Bijoux indiscrets, roman dans lequel un anneau est capable de faire parler le sexe. En 1777, Sade est incarcéré pour ses actes (orgies, abus sexuels, violences), mais quelques années plus tard, en 1801, c’est l’écrivain qui est envoyé en prison. Il inaugure ainsi le siècle de la censure. En juillet 1857, quelques mois après le procès de Madame Bovary, s’ouvre celui des Fleurs du mal. Sur réquisitoire du procureur Ernest Pinard, Baudelaire est condamné pour délit d’outrage à la morale publique à une amende importante et à la suppression de six pièces de son recueil. Si le XIXe siècle est celui de la censure, celle-ci s’étendra jusqu’à l’entre-deux guerres. Des associations de défense de la morale vont se spécialiser dans la chasse aux publications pornographiques. Boris Vian et Henri Miller en feront les frais.
Assurément, la liberté de l’écrivain ne saurait être absolue. Si l’on a pu appliquer à celui-ci une justice d’exception pour motifs politiques et moraux, sa liberté d’expression a pour limites plus sûres la diffamation et la protection de la vie privée, comme l’indique un contentieux très abondant. En outre, d’éventuelles sanctions pénales peuvent frapper des propos antisémites, xénophobes, racistes, révisionnistes et ceux qui, pornographiques ou violents, sont susceptibles de porter atteinte à des mineurs. Néanmoins, leur application à des œuvres littéraires n’est pas des plus simples [8]. On peut se demander, en particulier, si certaines jurisprudences ne témoignent pas d’un défaut de distance critique, voire d’un manque de culture du juge – et au-delà de la société –, à l’égard de la littérature.
En effet, alors que la censure administrative a plus ou moins disparu, alors que la liberté d’expression a conquis son autonomie face au politique, il semble qu’elle soit aujourd’hui limitée par des intérêts privés (respect de la vie privée, de la dignité, de l’honneur, mais aussi respect de l’image de marque d’une entreprise). On peut y voir une forme de « privatisation de la censure ». Ceci donne naissance à des phénomènes d’auto-censure car les auteurs redoutent les actions en justice plus qu’ils ne redoutaient jadis la censure, laquelle censure pouvait au fond leur faire de la publicité.
Par exemple, dans la décision prise par les Editions Gallimard de mettre un terme à la publication de l’écrivain Gabriel Matzneff, visé par une enquête pour viols sur mineurs et mis en cause dans le livre de Vanessa Springora, certains ont pu discerner une forme d’auto-censure. Il est vrai que la question est particulièrement délicate. Toutefois, il importe de dissocier l’œuvre de son auteur. Celui-ci doit bien évidemment répondre de ses actes répréhensibles mais l’œuvre doit-elle nécessairement subir le même sort ? C’est là une question d’éthique personnelle…
II. Convergences
Nombre d’œuvres contemporaines ne dissimulent pas leur portée ou leur démarche éthique. Comment se manifeste alors ce tournant éthique ? Par la promotion d’une fonction « po-éthique » de la littérature, d’une part, et l’apparition sur le devant de la scène littéraire d’une expression nouvelle du sujet, réflexif et ouvert à l’altérité, d’autre part.
En premier lieu, la littérature peut s’emparer de questions d’ordre éthique, notamment bioéthique, comme l’euthanasie, le clonage, le transhumanisme … Philippe Muray s’en offusque : « Le destin de la littérature contemporaine ne serait-il pas de s’intéresser à la façon dont n’importe quelle nouveauté, surtout scientifique, devient instantanément objet de discussions éthiques et de commissions de réflexion destinées à produire de nouvelles lois ? C’est La Fontaine trois siècles après : les grenouilles qui demandent une loi ! » [9]. Ces propos semblent quelque peu excessifs. Au nom de quoi l’écrivain devrait-il s’interdire de traiter de débats de société ?
Que l’on songe par exemple aux romans de Michel Houellebecq, notamment La possibilité d’une île, qui aborde le clonage humain. Comme le souligne Nicolas Dissaux, Houellebecq est particulièrement ambivalent par rapport à la science. D’un côté, on peut y voir une satire de la civilisation technicienne et de ses excès. D’un autre côté, il déclare : « Bien entendu, je me ferai cloner dès que possible ». Ce qui ne l’empêche pas de se réclamer de l’éthique : « Alors je me résume. Les droits de l’homme, la dignité humaine, les fondements de la politique, tout ça je laisse tomber, je n’ai aucune munition théorique, rien qui puisse me permettre de valider de telles exigences. Demeure l’éthique, et là oui, il y a quelque chose. Une seule chose en vérité, lumineusement identifiée par Schopenhauer, qui est la compassion. A bon droit exaltée par Schopenhauer, à bon droit vilipendée par Nietzsche comme source de toute morale. J’ai pris – cela n’est pas nouveau – le parti de Schopenhauer. Cela ne permet nullement de fonder une morale sexuelle – mais ça, ce serait plutôt un soulagement. Cela permet par contre de fonder la justice et le droit » [10]. Au fond, Houellebecq n’apporte aucune réponse à la question bioéthique du clonage, il nous propose une satire du monde contemporain.
En second lieu, ce que l’institution littéraire désigne, depuis quelques années, sous le nom de « littérature éthique » correspond à un certain rapport de l’écrivain à ses personnages, selon lequel celui-ci donne vie et parole à des figures humbles ou oubliées. Or, selon Isabelle Daunais, ces personnages ne sont pas vraiment au monde. Elle prend pour exemple la Dora Bruder de Patrick Modiano, ou les vies minuscules de Pierre Michon, et considère que tous ces êtres, réels ou non, sont créés pour dire, ou mieux, pour prouver qu’ils existent ou ont existé. Cependant, « ils n’existent que dans la conscience de l’écrivain. Ce sont de pures abstractions » [11]. Et là serait le principal danger de la littérature éthique : tomber dans l’abstraction et le réductionnisme en adoptant une posture unilatérale non dialogique.
Dans le tome 6 de La méthode, Edgar Morin applique le paradigme de la complexité au domaine de l’éthique [12]. L’éthique n’échappe en aucun cas au problème de la contradiction. Elle est complexe au même titre que le sont le bien et le mal. Une action nocive ou meurtrière peut aboutir, par les réactions antagonistes qu’elle provoque, à des résultats heureux. Et inversement, la sagesse populaire sait bien que « l’enfer est pavé de bonnes intentions », ce qui signifie qu’une action moralement bonne peut produire des effets pervers. En introduisant ainsi l’incertitude et la contradiction dans le domaine de l’éthique, Edgar Morin prolonge la critique de ce que Nietzsche désignait par la moraline. Nietzsche distinguait la morale de la moraline et dénonçait cette dernière comme un appauvrissement de l’éthique, conduisant au réductionnisme, à la simplification. Précisément, selon Jean-Michel Besnier, « si l’on veut résister à la simplification, le contre-feu c’est la fréquentation de situations humanogènes, et en particulier de situations littéraires, où l’Humain échappe toujours au formatage et à la réduction unilatérale » [13].
Aussi bien, le rôle de la littérature n’est pas de prescrire une certaine morale. Car elle est justement un moyen pour exprimer la complexité qui caractérise l’existence. Et c’est en cela qu’elle a une valeur éthique.
Bibliographie
G. Bataille, La littérature et le mal, Paris, Gallimard, 1957.
J.M. Besnier, L’homme simplifié, Paris, Fayard, 2012.
I. Daunais, Ethique et littérature : à la recherche d’un monde protégé, Etudes françaises, 2010, 46 (1), p. 63.
N. Dissaux, Houellebecq, un monde de solitudes, Paris, L’Herne, 2019.
S. Laugier (dir.), Ethique, littérature, vie humaine, Paris, PUF, 2006.
E. Morin, La méthode, tome 6, L’éthique, Paris, Seuil, 2004.
P. Muray, Essais, Les Belles Lettres, 2015.
M.C. Nussbaum, L’art d’être juste, Villeneuve d’Ascq, Climats, 2015.
M.C. Nussbaum, Les émotions démocratiques, Paris, Flammarion, 2020.
F. Ost, Raconter la loi, Aux sources de l’imaginaire juridique, Paris, Odile Jacob, 2004.
P. Ricoeur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990.
J.-P. Sartre, Qu’est-ce que la littérature ? (1947), Paris, Gallimard, 1985.
P. Ségur, Droit et littérature, Eléments pour la recherche, Revue Droit & Littérature, 2017, n° 1, p. 107.
Notes
[1] S. Laugier (dir.), Ethique, littérature, vie humaine, Paris, PUF, 2006.
[2] P. Ségur, Droit et littérature, Eléments pour la recherche, Revue Droit & Littérature, 2017, n° 1, p. 107.
[3] M.C. Nussbaum, L’art d’être juste, Villeneuve d’Ascq, Climats, 2015 ; Les émotions démocratiques, Paris, Flammarion, 2020.
[4] F. Ost, Raconter la loi, Aux sources de l’imaginaire juridique, Paris, Odile Jacob, 2004, p. 37-38.
[5] I. Daunais, Ethique et littérature : à la recherche d’un monde protégé, Etudes françaises, 2010, 46 (1), p. 63.
[6] G Bataille, La littérature et le mal, Paris, Gallimard, 1957, p. 9.
[7] F. Ost, Si le droit m’était conté, Paris, Dalloz, 2019, p. 169.
[8] En 2002, Michel Houellebecq, poursuivi pour message pornographique susceptible d’être lu par des mineurs après la parution de Plateforme (Flammarion, 2001), est relaxé au motif que l’ouvrage n’est pas « dénué de toute valeur artistique et littéraire ». Mais les juges ont opté pour la solution inverse un an plus tard à propos de Il entrerait dans la légende de Louis Skorecki (éd. Léo Scheer, 2002) en considérant que peu importaient « les intentions de l’auteur quant au genre littéraire recherché ».
[9] P. Muray, Essais, Les Belles Lettres, 2015, p. 634.
[10] M. Houellebecq, Cité par N. Dissaux, Houellebecq, un monde de solitudes, Paris, L’Herne, 2019.
[11] I. Daunais, Ethique et littérature : à la recherche d’un monde protégé, Etudes françaises, 2010, 46 (1), p. 63.
[12] E. Morin, La méthode, tome 6, L’éthique, Paris, Seuil, 2004, p. 62 et 120.
[13] J.M. Besnier, L’homme simplifié, Paris, Fayard, 2012.