Rafael Acosta de Arriba (La Havane, 1953). Essayiste, chercheur, conservateur, historien, critique d'art et enseignant. Il est titulaire d'un doctorat en sciences historiques et d'un post-doctorat en art. Il a publié vingt livres, dont Los silencios quebrados de San Lorenzo et De vísperas y silencios. Il a contribué à une trentaine de livres d'auteurs divers. Il a reçu plusieurs prix et distinctions, dont le Prix national de la recherche culturelle (pour l'ensemble de son œuvre). Il est professeur à l'Université de La Havane et à l'Université des Arts. Il a été directeur de plusieurs magazines culturels et fondateur et premier directeur du magazine cubain de photographie. Il a enseigné en troisième cycle et donné des conférences dans des universités aux États-Unis, en Israël, au Brésil, en Espagne, au Mexique et en Italie, entre autres. Il travaille actuellement à la Bibliothèque nationale de Cuba José Martí en tant que directeur du magazine de l'institution. Il est aussi l’auteur de Conversations sur l'art et Études critiques sur la photographie cubaine.
Abstract
Ce texte analyse les différentes articulations, négations, inter-influences, significations et variations possibles de la relation entre l'art et la société. L'art dit contemporain s'est appauvri en délaissant les débats idéologico-esthétiques d'antan. Le marché l'a transformé en un simple produit financier et a conduit à une « esthétisation de la réalité » qui ruine ses fondements culturels et spirituels. Examinant l’influence du contexte sociétal et ses évolutions, l’auteur montre que la perte de sens généralisée de l'art actuel a entraîné aussi sa perte de force expressive. Or s’il perd son sens, le monde iconographique devient inutile et ne sert plus que des intérêts mesquins ou simplement utilitaires comme la publicité commerciale. Malgré le tableau profondément critique que l'auteur expose ici, il voit encore une lueur d'espoir qui pourra nous venir des artistes authentiques et de quelques penseurs qui gardent une conception optimiste du monde des images et croient encore dans la puissance idéologique de l'art.
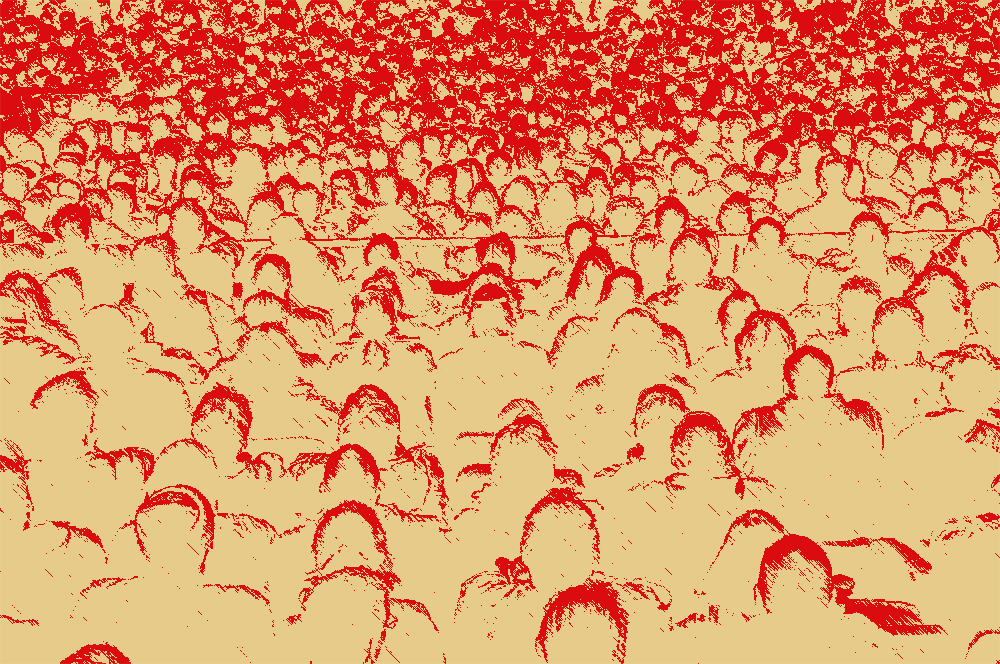
« Il faut donner un sens à l'art. De la crise émerge l’obligation et la responsabilité d’un art philosophique interrogatif et éthique » Hervé Fischer.
-I-
Nous sommes face à plusieurs dimensions idéo-esthétiques en mouvement constant : le monde que nous percevons, celui que nous pensons, et entre les deux, en toile de fond, l’incomparable réalité. L'art permet des mutations et des combinaisons entre eux. C’est tantôt en agissant comme un lien, tantôt en mettant en valeur certaines de ces dimensions, que l'esprit humain et sa fabuleuse imagination symbolique donnent un sens à l'univers des images. Sans ce sens, le monde iconographique devient inutile et ne sert plus que des intérêts mesquins ou simplement utilitaires comme la publicité commerciale ou la pornographie.
Ces dernières années, le binôme art-société et toutes ses interactions ont fait l'objet d'une analyse approfondie, je dirais même exhaustive. Des tonnes de papier ont été imprimées sur ses articulations, ses négations, ses inter-influences, ses significations et nous pouvons imaginer tout autant de variations sur sa relation dynamique. Le magazine italien M@GM@ nous invite à réfléchir sur le sujet, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais préciser quelques idées préliminaires.
Je n'ai pas besoin de souligner que ce que nous appelons l'art n'est rien d'autre qu'une construction culturelle de la modernité. Les hommes qui ont conçu les lions ailés du palais de Darius à Persépolis, ou le masque funéraire de Toutankhamon en Égypte, ou l'autel grec de Pergame, ou les icônes des églises byzantines, toutes ces œuvres d'une beauté extraordinaire, n'ont jamais eu conscience qu'ils faisaient avec leurs mains de l'art. Ce qu'ils faisaient, c'était adorer leurs dieux ou les puissants, avec leurs talents incontestables et leurs idées sur des formes précises de représentation.
C'est la modernité qui a fait de ces œuvres et d'autres semblables des éléments emblématiques des cultures où elles ont été produites. La discipline théorique connue sous le nom d'histoire de l'art a émergé depuis et constituant un vaste récit qui a survécu jusqu'à nos jours. Ernst Gombrich lui-même, sur la première page de son Histoire de l'art, la plus publiée et la plus reproduite de toutes celles qui ont été écrites, l'a écrit : « L'art n'existe pas. Il n'y a que des artistes ». Et en avançant son idée, il a ajouté : « L'art avec un A majuscule est essentiellement un fantôme ». Je n'ai pas ici l'intention de déconstruire ce concept intellectuel sur lequel des milliers de questions, d'essais, de livres et de traités universitaires, dont certains très bons et même brillants, ont été écrits, mais je dois commencer par en commenter l'imprécision.
À mon avis, cet art, contemporain, postmoderne, actuel, ou de toute autre dénomination qui me vient à l'esprit, s’est rapidement dégradé, d'une part par sous l’effet de la phagocytation imparable du marché qui l'a transformé en une marchandise comme une autre (Boris Groys dixit), et, d'autre part, de son évolution postmoderne, qui l’a vidé de toute force de signification, réduit souvent à des blagues de peu, à des images sans fond ni message, à une conceptualisation au ras du sol et à une pauvreté métaphorique évidente. L'expression des artistes britanniques Gilbert & George, selon laquelle l'histoire de l'art a été écrite sur un chéquier, est tout à fait pertinente, du moins pour l'auteur de ce texte. Il n'est pas nécessaire de commenter davantage.
Sa mort a été décrétée d'abord par Hegel, puis par Hans Belting et enfin par Arthur Danto, mais ce n'est là que théorie et rhétorique, purement académiques. L'art continue à légitimer un ensemble de biennales, foires, grandes expositions médiatiques, salons et ventes aux enchères qui le maintiennent en respiration, même si beaucoup d'entre nous savons qu'il est gravement malade depuis longtemps. Mort ou non, il est actuellement en sommeil ; sous le charme de la mondialisation il se dilue progressivement entre marketing et banalisation. Comme l'a noté Perry Anderson, après la Seconde Guerre mondiale et la stabilisation de l'ordre atlantique d'après-guerre, « tout art qui se voulait encore radical était couramment destiné à l'intégration commerciale ou à la cooptation institutionnelle ». Et c'est ce qui s'est passé. L'héritage des avant-gardes du XXe siècle s'est peu à peu étiolé, et il ne reste plus grand-chose aujourd'hui de leur contenu protéiforme et révolutionnaire initial.
Lorsque l'art a puisé son énergie dans la révolte contre la morale officielle bourgeoise, il a conservé son sens aigu d’hérésie du politique et je m’en tiens quant à moi à l’analyse d'Anderson ; mais ces tensions ont commencé à se relâcher et à disparaître lentement. La politique a été remplacée par la puissance de la technique et le choc de ses innovations accélérées, puis lorsque ces innovations sont devenues monotones et inoffensives, elles ont cessé d'influencer l'art de la fin du XXe siècle. Il est vrai, comme l'indique le texte d’appel de ce numéro de la revue, que les relations entre l'art et la société ont traversé des formes animistes, politiques, religieuses, parfois intégratives ou militantes, parfois critiques, mais comme il est bien précisé, elles sont aujourd'hui essentiellement capitalistes et cette dernière forme est celle qui a marqué les siècles les plus récents.
Depuis la rupture de Duchamp, orchestrée et reprise par Beuys, Warhol et de nombreux autres artistes influents, l’idée puissante que nous avions de comprendre et de faire de l'art (le chef-d’œuvre du point de vue de la beauté kantienne) a été brisée, puis a dégénéré. L'art est devenu le plus souvent un geste de déni des stéréotypes de la peinture et de la sculpture de rejet des formes conventionnelles du symbolique. Les artistes se moquaient du musée, du faste et de de l'aura du chef-d'œuvre. Au début, c'était révolutionnaire, puis cette posture a sombré dans la répétition jusqu’à l’ennui et a fini par s’enfermer dans le musée que les principaux artistes innovateurs avaient tant vilipendé. Duchamp est probablement à l'origine de cette nouvelle façon de concevoir ce qu’on appelle encore l’art.
Ce ne sont plus les images artistiques qui dominent aujourd'hui dans le nouvel ordre mondial, ce sont les images numériques, les images commerciales et publicitaires. L’art a rompu avec sa puissance traditionnelle et bien qu'il demeure fondamentalement lié au politique, les tensions critiques entre l’un et l’autre sont considérablement affadies : le politique ne voit plus l'art comme un danger mortel et l'art ignore de plus en plus le politique, même si les dirigeants politiques gardent toujours une certaine crainte vis-à-vis des artistes qui demeurent toujours une menace potentielle en raison de l’hérésie qu’ils tendent à représenter.
L'esthétisation de la réalité, voilà ce qui fonde aujourd’hui l’écosystème des relations entre l’art, le politique et le marché. Nous observons dans l’art postmoderne l’émergence de productions reconnues comme de l’art bien qu’elles n’en aient aucune des caractéristiques connues. C’est dire quel degré de démesure a atteint l'anti-art ou « l’art » qui n’a rien à dire. En outre, les réseaux sociaux n’ont pas aidé à encadrer cette dérive, ils l’ont plutôt aggravée. Entre internet et réalité virtuelle, tous deux marchandisés, les gens se coupent de la réalité. L’avenir n’est donc pas rose. La postmodernité marque, selon Fernando Castro, le moment d’une régression. L’art actuel le confirme à chaque instant.
Les questions qui se posent aujourd’hui par rapport à cet état de l’art tournent, à mon avis, autour des causes qui nous y ont conduit et des solutions qui pourraient être envisagées, le cas échéant, pour y remédier. Les causes sont assez évidentes et je crois les avoir mentionnées. Quant aux remèdes, je crois qu’ils dépendent des artistes eux-mêmes. Il n’existe pas de solution générale, mais seulement l’espoir qu’on peut mettre dans des démarches isolées de créateurs.
Dans ce contexte de mondialisation marchande, l’art perd de plus en plus sa puissance culturelle traditionnelle. Sa dérive en marchandise a pesé lourdement sur son sort, éliminant son rôle subversif de la conscience et transformateur. En outre, le fait que l’art récent soit devenu un art d’installations et de performances, et qu’il ait ainsi abandonné ses formes d’expression traditionnelles, n’a pas aidé. Mais nous observons qu’il y a tencore des artistes qui se rebellent contre cette situation et qui essaient de revaloriser la tradition moderne en adoptant une démarche critique dans la nouvelle culture visuelle où nous vivons. Alors que la télévision et le cinéma, la publicité commerciale et politique, et tous les autres instruments de domestication des consciences, multiplient leurs mécanismes de contrôle, les artistes sont, de plus en plus, en position ou en devoir d’exercer un questionnement et une action critique. Ce sont peut-être eux et eux seuls qui pourront nous apporter un rayon de lumière dans la situation actuelle, du moins à l’auteur de ce texte.
-II-
Je pense qu’il convient d’examiner d’abord, avant même l’art lui-même, ses contextes majeurs : la société et la culture que nous habitons. Le monde visuel, celui des images et du spectacle dans lequel nous vivons, ou, en d’autres termes, l’esthétisation de la réalité, sont devenues des références fondamentales pour mieux juger de l’art.
Les images ne sont qu’un sous-produit culturel et, comme l’a souligné Christian Metz au début des années 1970, elles ne constituent pas un empire autonome et clos, mais se génèrent en interaction complète avec le contexte social. Savoir quelle idée de la culture prédomine dans le présent est donc essentiel pour comprendre tout le reste - et tout ce qui précède.
Plusieurs auteurs de premier plan ont participé à cette réflexion sur la culture au cours des dernières décennies. Dans son livre La civilización del espectáculo (2012), Mario Vargas Llosa a passé en revue ce panorama théorique en exposant ses critères personnels sur les changements évidents qui ont eu lieu dans le monde de la culture. Je cite : « La culture, dans le sens qui a été traditionnellement donné à ce terme, est aujourd’hui sur le point de disparaître. Et peut-être a-t-elle déjà disparu, discrètement, vidée de son contenu, peut-être remplacée par une autre culture qui dénature son sens précédent ». Pour cet auteur, l’une des caractéristiques de cette mutation se situe dans ce que l’on pourrait appeler la post-culture, une vision qui ne croit plus au progrès, le grand mythe de l’Occident pendant la modernité, c’est-à-dire le chemin linéaire ascendant qui conduirait l’humanité, sans faillir, à une progression par étapes de la vie matérielle et spirituelle. La soi-disant postmodernité a fait voler en éclats plusieurs mythes modernes, dont celui-ci.
Le pouvoir de la parole, l’une des conquêtes les plus solides et appréciés de l’humanité jusqu’à présent, a été soumis à des critiques dévastatrices. Selon George Steiner, « la parole, le souvenir et l’écrit étaient l’épine dorsale de la conscience ». À notre époque, l’image a atteint une telle prédominance qu’elle modifie radicalement la vie spirituelle et culturelle de l’humanité ; le monde lettré est en recul, la culture du livre est en perte de vitalité, et les sciences humaines classiques se réduisent rapidement à une mémoire ou, dans le meilleur des cas, à des textes académiques recyclés. Pour en revenir à Steiner, nous sommes désormais dans le monde de la postface ou de l’épilogue.
Avant même Vargas Llosa et Steiner, d’autres penseurs avaient déjà appelé notre attention sur cette évolution : Guy Debord et Gilles Lipovetsky sont intervenus dans ces débats, chacun avec ses propres arguments. Debord a inventé un label pour l’époque actuelle, celui de « société du spectacle », un concept de spectacle, il est bon de le préciser, qui est plus associé à une aliénation ou à l’aliénation par le marché qu’à proprement parler à un divertissement agréable. Lipovetsky, dans son désormais classique L’Ère du vide (1983), parlant de postmodernité, faisait référence à l’implosion de la haute culture et à la prédominance grandissante de l’image sur la parole face à l’écran de cinéma. Cet auteur nous a légué un concept qui a gagné depuis du terrain, celui de culture mondiale. Nos plus grands penseurs ont commencé à s’inquiéter des mutations radicales qui s’opéraient dans nos sociétés.
Giovanni Sartori aussi, dans un livre qui est cardinal pour ces réflexions, Homo videns. La Sociedad Teledirigida (1997), a commenté de façon très pertinente la façon dont l’ascendant du visuel sur le conceptuel transforme progressivement l’Homo sapiens en Homo videns. Sartori part, entre autres arguments clés, du fait qu’avant même qu’il apprenne à lire, l’enfant commence aujourd’hui son apprentissage devant la télévision. Pour lui, à partir de ce moment, le visible commence à prédominer sur l’intelligible, un processus qui ne s’arrêtera plus désormais. La langue, comme nous le savons, est un instrument de réflexion. Celui qui pense, c’est-à-dire celui qui sait penser, le fait parce qu’il sait exprimer ses pensées avec cohérence, en structurant ses idées. Selon Sartori, les pensées de l’homme se sont développées avec l’écriture, et c’est le passage de l’oral à l’écrit qui a accru de plus en plus l’importance de la pensée conceptuelle. Et c’est la presse à imprimer qui a permis l’accès grandissant des personnes instruites à la culture écrite. Puis, selon cet auteur, l’avènement de la télévision a créé une rupture dans cette progression de la grande culture initiée par l’Antiquité. Il ajoute : « Et à la télévision, le voir prévaut sur le parler, en ce sens que la voix devient secondaire, elle est fonction de l’image, le journaliste commente l’image (...) le spectateur devient ainsi un animal voyant plus qu’un animal symbolique ». Selon lui, les images ont plus de réalité pour le téléspectateur moyen que les paroles. Il a à coup sûr raison.
Conséquemment, selon lui, la perte de la capacité d’analyser le symbolique et plus encore, de développer une pensée abstraite, crée accuse le fossé entre l’Homo sapiens et l’Homo videns, entraînant une dégradation de sa conscience, de sa capacité de penser de manière abstraite. Il s’agit bien d’une régression, d’un recul, d’au moins un retournement ou un tournant dans l’évolution.
L’enfant préfère certainement l’école divertissante de la télévision à l’école ennuyeuse de la lecture et des devoirs, et il aime mieux s’occuper de ses petites affaires plutôt que de s’embarquer dans la tâche fastidieuse de penser. C’est ainsi que se forment des générations d’hommes et de femmes qui ne veulent plus lire, peu disposés à la culture écrite, à une réflexion profonde et soutenue, et qui deviennent totalement dépendants de la culture sans effort et fluide de l’image.
Le livre du sociologue Frédéric Martel, Mainstream : Enquête sur la guerre globale de la culture et des médias (2011), soutient la thèse selon laquelle le temps accéléré de notre époque contribue à écarter toute conception antérieure de la culture et il affirme que la « culture du divertissement » a remplacé à l’échelle universelle la culture, telle qu’on l’entendait encore au XXe siècle. Jusque-là on le suit très bien et son discours rejoint celui des auteurs que nous avons précédemment mentionnés, mais il est curieux que cette analyse de la culture de notre temps ne cite qu’un seul titre de livre et ne parle pas des arts visuels, de la philosophie et des sciences humaines en général, considérant plutôt les films, la télévision, les jeux électroniques, les mangas, les vidéos, les tablettes, et parfois quelques concerts de rap et de rock, en effet très symptomatiques de notre époque. Pour Martel, ce qu’on appelle les « industries créatives » produisent des formes modernes de divertissement, - en écartant les composantes traditionnelles de la culture du passé - plus en accord avec la culture du présent, telle qu’il la décrit. Ce bestseller, qui a suscité des débats lors de sa parution, affirme également que la nouvelle culture du divertissement a consacré l’Occident comme le porte-étendard de toutes les grandes luttes pour l’émancipation culturelle (de genre, de race, de minorités ethniques) dans le monde, une affirmation très contestable. On peut lui reprocher certainement aussi sa sympathie à peine dissimulée pour cette culture grand public de plus en plus mondiale, qui crée de véritables mécanismes d’hypnotisation collective du grand public. L’auteur juge normale cette nouvelle conception de la culture qu’il estime en parfaite harmonie avec les grandes inventions scientifiques et technologiques de ces dernières années.
Comme l’a souligné Vargas Llosa dans son livre important cité plus haut, les analyses de Martel sont représentatives d’une réalité que jusqu’à présent ni la sociologie ni la philosophie n’avaient voulu admettre. Selon le prix Nobel péruvien : « l’immense majorité de l’humanité ne pratique, ne consomme ni ne produit plus aujourd’hui aucune autre forme de culture que cette culture grand public, qui, dans le passé, était considérée de manière désobligeante, comme un simple passe-temps populaire, sans aucun rapport avec les activités culturelles, artistiques et littéraires qui constituaient la culture. La culture est morte, même si elle survit dans de petites niches sociales, sans aucune influence sur le courant dominant ». Comme on peut le voir, les critères considérés par Vargas Llosa et par Martel sont aux antipodes. Mais on compte déjà deux condamnés à mort : la culture et l’art.
La publicité comble progressivement le vide laissé par l’esprit critique et exerce une influence décisive sur les goûts, la sensibilité, l’imagination et les habitudes. Elle a pris la place des systèmes philosophiques, des croyances religieuses, des idéologies et des mentors intellectuels de chaque époque.
Le marché est l’autre élément envahissant et primordial qui définit et change tout. Dans la culture actuelle, le prix a remplacé la valeur de l’œuvre d’art, la massification est devenue synonyme de frivolité La figure du grand intellectuel, faiseur d’opinion écouté et suivi, disparaît également à une vitesse vertigineuse, confirmant la faible validité de la pensée critique et érudite dans cette civilisation du spectacle ou du divertissement.
Les technologies audiovisuelles de pointe ont aboli les distances et le sens du temps, et ont contribué de manière décisive à l’augmentation de la vitesse de la vie contemporaine. Le passé et le présent semblent s’être combinés et subsumés dans le futur, qui nous est offert presque comme le seul temps qui compte. La vitesse de transmission des courriels électroniques ou des messages textuels a laissé loin derrière la vitesse de la voiture, du métro ou de l’avion ; elle est emblématique de la vitesse sociale de notre époque. Un simple clic nous rapproche des latitudes les plus éloignées en quelques millisecondes. Le télégramme s’est substitué aux courriers traditionnels. Puis l’image vidéo a supplanté le journal, et les progrès technologiques ne font qu’accroître la supériorité de la télévision : la puissance et la qualité des appareils de réception, la haute définition, la 3D et le cyberespace assurent désormais une supériorité de l’information audiovisuelle à laquelle on n’avait jamais pensé.
Tout ce que je viens de dire est connu et je n’apporte sans doute rien de nouveau ; mais je considère important de le mentionner car cela met en scène le contexte nouveau de l’art. Ce qui s’est passé avec la culture est lié, comme nous l’avons vu, aux actions conjointes du marché et du développement des nouvelles technologies, qui ont créé les mêmes paramètres de consommation culturelle assumés collectivement et individuellement sur les cinq continents, entraînant malgré les distances géographiques, les traditions, les croyances et les langues qui leur sont propres, une uniformisation de la culture mondiale. Cette culture a cessé d’être élitiste et est devenue une véritable culture de masse. Ce que les industries culturelles inventent n’est rien d’autre qu’une culture transformée en biens de consommation de masse suivant des codes visuels très homogènes. C’est la prédominance de l’image et du son sur la parole qui met en évidence le phénomène en cours. Et il ne fait aucun doute que ce processus conduit à l’abandon de la lecture, à une perte accélérée de lucidité critique et donc de libre arbitre des personnes. L’esprit critique diminue, voire disparaît. La culture mondiale a ouvert une nouvelle perspective, celle du divertissement. Jeux vidéo, mangas, séries télévisées, films et clips vidéo, plus ou moins frivoles, ont donné naissance à une offre visuelle très en demande. Un aspect particulier, parce qu’un peu marginal, mais non négligeable de cet univers culturel, c’est aussi la libre circulation de la pornographie, parfois extrême. Il est donc clair que la culture est aujourd’hui synonyme de plaisir et que ce qui n’amuse pas ne se consomme pas, ou en d’autres termes, n’est pas considéré comme de la culture. La valeur qui compte est devenue commerciale. En art, le vieux dilemme entre le prix et le sens, qu’Octavio Paz a si clairement soutenu dans les années 1980, revient sur le devant de la scène.
Bien sûr, il ne s’agit pas de diaboliser le pouvoir du divertissement, ce n’est pas notre propos. Les loisirs et le divertissement sont des parties consubstantielles de la vie de l’homme et des conquêtes très précieuses. Il s’agit plutôt pour nous d’affirmer que, dans cette perspective, si nous ne rappelons pas fermement leur importance, les valeurs fondamentales de l’humanisme sont appelées à disparaître. La force des idées cède peu à peu au pouvoir des images, dont le contenu intellectuel s’affaiblit, laissant libre cours aux zombies enchaînés aux écrans (qu’il s’agisse du cinéma, de la télévision ou des ordinateurs). Les sociétés deviennent donc de simples consommatrices d’images.
Aujourd’hui, l’image est une urgence ; son irrésistible ascension et prolifération l’emportent sur ses propres qualités. Nous sommes face à une véritable pollution iconique. Tous aujourd’hui produisent, nous produisons, des images, c’est devenu une façon naturelle de se mettre en relation avec les autres. José Luis Brea nous a averti - et c’est une autre voix qui s’élève dans la même direction - qu’avec l’émergence de l’électronique l’image s’est « naturalisée », qu’elle habite notre monde, qu’elle est devenue un élément habituel de notre paysage quotidien. Le numérique en a entraîné un développement exponentiel, invasif de la totalité des espaces de notre vie quotidienne ; du fait de son ubiquité elle est devenue une constante anthropologique habituelle et normale de nos sociétés actuelles.
Cela fait maintenant un peu plus de cinquante ans que les études sur la postmodernité ont mis à jour et questionnent cette montée en puissance du visuel, qui continue aujourd’hui encore à soulever d’importants débats théoriques, allant jusqu’à considérer la mort de la représentation. Régis Debray nous a averti, il y a quelque temps déjà, qu’une image n’est ni vraie ni fausse, ni contradictoire ni impossible. Dans la mesure où elle n’est pas elle-même un argument, elle n’est pas réfutable, alors que, selon d’autres spécialistes, c’est à mi-chemin entre le signe et le symbole, que les formes symboliques de la connaissance et de l’identité atteignent leur plus haut degré de concentration et de densité de sens.
L’esthétique joue également un rôle important selon moi ; elle ne relève pas de la théorie de l’art, comme on la présente parfois, mais constitue un mode expressif d’identification et de pensée de l’art, un mode d’articulation entre les façons de faire, les formes de visibilité, les façons de faire et de penser ces relations. Tout cela est lié à l’appréciation objective que les sociétés se font du « monde de l’art ». Il faut considérer ce monde, en quelque sorte souterrain, comme un réseau dispersé de sous-cultures qui se chevauchent et se lient entre elles par les œuvres d’art et les rapports que les artistes établissent avec le public et le marché.
Le raisonnement de Barthes selon lequel les sociétés considérées comme avancées (cela a été dit en 1980) étaient désormais consommatrices d’images et non plus de croyances, comme celles d’antan, est fondamental. Il résume tout. C’est dire que Barthes nous avait déjà mis en garde sur le rôle décisif de la pensée visuelle dans les sciences humaines d’aujourd’hui. La question est, à mon avis, de trouver comment recadrer la pensée visuelle dans notre culture actuelle plutôt que d’accepter qu’elle s’y substitue.
Il faut alors prendre en considération le rôle des acteurs sociaux tels que nous les présentent les images. Car ils se prêtent à une analyse multidisciplinaire de leur discours visuel, en considérant leurs dimensions linguistiques, sociales et culturelles comme des outils, pour comprendre comment le sens se construit. Le canon, c’est la société qui l’établit, et l’art nous permet d’y échapper, de le questionner et même d’y répliquer ; c’est une capacité qui appartient aux artistes et au pouvoir de déchiffrage de l’art. L’image doit être interprétée comme une culture en mouvement, dont le flux nous entraîne avec tout son poids de conditionnement social et de discours du pouvoir. Chaque culture a sa propre visualisation, qu’il faut affronter spécifiquement pour lutter contre l’homogénéisation qui nous engloutit. Il s’agit de penser visuellement la société, c’est-à-dire penser ses images comme de nouvelles stratégies de connaissance du social en étroite articulation avec les autres sciences sociales.
Nous vivons dans l’image et l’image nous vit, comme l’a dit Joan Fontcuberta. Nous sommes à l’apogée d’un processus de sécularisation de l’image visuelle tandis qu’aujourd’hui nous produisons tous des images. Grâce à l’exaltation et à la diffusion que le web a permis, la photographie est finalement devenue le support visuel définitif de la culture contemporaine. Comprendre les pratiques de l’image comme un phénomène globalisant dont nous ne pouvons pas être absents, les mettre en relation et les inscrire dans le champ des autres sciences humaines, voilà un objectif pour lequel les chercheurs, les universitaires et les bons intellectuels devraient se battre.
-III-
Quoi qu’on en dise, ce que nous appelons l’Art est là, sa présence retentit dans notre époque et l’énorme infrastructure mercantile qui s’est érigée à partir et autour de lui, ne dépend pas de nos discussions théoriques ; elle est là aussi, elle pulse, elle vit et il faut la transformer.
Les puissants stimuli des courants de pensée conceptuelle et artistique ne lui ont jamais fait défaut ; on peut même dire qu’ils l’ont a animé à toutes les époques. Chaque mouvement, isme ou tendance, comme vous préférez les appeler, a changé la scène artistique et a réussi à rassembler des maîtres et des célébrités emblématiques, donnant ainsi chaque fois à l’art sa densité anthropologique. C’est ainsi que les dadaïstes ont fait exploser son unité fondamentale de sens, que les surréalistes ont exploré l’inconscient en profondeur, que les situationnistes ont pensé que l’art devait trouver sa réalisation dans la pratique révolutionnaire, tandis que la pratique révolutionnaire devait trouver sa place dans l’art, en luttant, à l’unisson, contre l’incapacité de vivre de la classe ouvrière, aliénée par les médias. Ces tentatives contre-culturelles qui, sur la base de l’union du dadaïsme et du surréalisme, ont conduit l’art à renouer avec la vie, ont nié et déconstruit toutes les formes réifiées de la culture bourgeoise. C’était comme le dernier grand effort conscient pour contrecarrer ce qui s’abattait déjà sur la société humaine : le triomphe du nouvel esprit du capitalisme qui a hissé, sans grand bruit, le slogan de la subordination de toute recherche esthétique à des fins économiques.
Lors des révoltes et turbulences de 1968, le capitalisme a bénéficié de l’utilisation de la logique du lion transformé en léopard : tout change pour rester pareil. Apostille : si quelque chose a changé au cours de cette décennie violente et pleine d’espoir, avec un sens et une efficacité invisible, c’est bien le capitalisme (nous nous en sommes rendus compte avec le temps), qui a inversé la formule susmentionnée (de Kenneth Galbraith) et a subordonné l’esthétique à l’économie, ce qui s’est vérifié plus tard comme une esthétisation de la réalité. Et l’art a été aveugle : il a inconsciemment rejoint la société du spectacle.
Croire en l’art, comme l’a montré la sociologue Sarah Thorton, est une sorte de religion moderne, car bien que chaque membre de ce monde incertain (artistes, galeristes, conservateurs, critiques, collectionneurs, commissaires-priseurs, etc.) ait une notion différente de l’art, ils croient tous en sa présence immanente dans la société. L’art fonctionne dans cette religion comme la divinité, une entité dont l’existence ne se questionne pas, omniprésente et suffisante. La sociologue l’explique ainsi : « Le monde de l’art contemporain est un réseau dispersé de sous-cultures qui se chevauchent, liées par le fait qu’elles croient toutes en l’art ». La profusion de stimuli visuels est donc son atmosphère habituelle et nombreux sont les habitants de ce monde caché qui sont pleinement conscients que beaucoup d’œuvres sur le marché ne sont pas vraiment de l’art et qu’elles ont été spécialement conçues pour la voracité des collectionneurs.
L’écheveau de conventions créées par tous les habitants de ce monde souterrain donne souvent raison à ceux qui, comme l’auteur de ce texte, critiquent cette pollution et même rejettent cette situation où nous admettons comme œuvres d’art des pièces qui ne seraient pas acceptées comme telles en d’autres moments de notre histoire. C’est une réalité. L’artiste est malheureusement aujourd’hui tellement obsédé par sa propre publicité et par le marché, qu’il est difficile d’imaginer un retour à une posture plus modeste, et plus authentique, vis-à-vis de la création.
Depuis le début de la pandémie de coronavirus, qui a paralysé la planète pendant plusieurs mois, nous avons tous eu le temps de réfléchir au présent et à l’avenir immédiat. Les réflexions publiées par les gens du monde de l’art ne m’ont pas du tout impressionné, en général elles étaient marquées par une légèreté qui fait peur. C’est comme si, d’une part, le monde changeait automatiquement pour le mieux, sans l’intervention active et consciente de l’humanité, et d’autre part, on admettait que seul le réseau artistique pouvait sauver l’art (bien sûr, son marché en premier lieu). Je ne crois ni à l’un, ni l’autre ; le monde restera le même qu’avant la crise pandémique, ou peut-être pire, comme l’écrivain solitaire Michel Houllebecq s’est aventuré à l’imaginer avec son cynisme et son pessimisme habituels. Sans doute, certains gouvernements responsables accorderont plus d’attention à la santé publique (y compris à son budget), et le monde de l’art renforcera quelque peu sa présence sur le web ; mais pour le reste, le monde reviendra probablement aux mêmes pratiques et au marché avec toute la volonté et la frénésie possibles. Nous ne savons tout simplement pas comment construire notre vie.
Indubitablement l’humanité n’apprend pas. Nous en avons eu la preuve évidente au siècle dernier. Ni les guerres meurtrières, ni le manque de solidarité, ni les épidémies, ni les famines dans les pays sous-développés n’ont permis de changer l’attitude des dirigeants mondiaux. Encore plus pathétique et dangereux : l’irresponsabilité de nos actions face au changement climatique mondial, cette sorte d’épée de Damoclès suspendue au-dessus de la planète qui a été pourtant abondamment dénoncée, je dirais ad nauseam, par les scientifiques et les humanistes de toutes les latitudes. L’humanité est devenue un producteur prolixe de déchets et de matériaux très toxiques pour l’environnement. Et l’art n’est que le reflet de cette situation et continuera de l’être, malgré la lucidité d’un petit groupe de créateurs et de penseurs, malgré les restes de pensée critique qui existent encore dans certains domaines de la création symbolique.
Je conclus. Il y a des artistes qui maintiennent un haut niveau de créativité et d’imagination dans leurs œuvres et qui tiennent ainsi sur leurs épaules le mare magnum de l’art contemporain, aussi déformé soit-il, débordant de banalités et d’œuvres vraiment médiocres. Et il faut désormais, pour analyser en partie cette production symbolique, faire appel aux sciences sociales, du fait que les analyses visuelles ne peuvent plus, à elles seules, remplir leur fonction d’exégèse. À mon modeste avis, c’est seulement des artistes véritables que nous pouvons espérer une solution, un remède à cette situation tellement dysfonctionnelle ; c’est seulement de leurs œuvres et de quelques penseurs qui gardent encore espoir dans le monde des images et croient en l’art. Donner un sens à l’art, revenir à sa fonction anthropologique, c’est la seule stratégie possible.
* Traduction de l'espagnol par Hervé Fischer.