Philosophe et artiste multimédia, de nationalité française et canadienne, son travail a été présenté dans de nombreux musées internationaux et biennales ; fondateur et président de la Société Internationale de Mythanalyse (Montréal, Québec-Canada) ; directeur de l’Observatoire international du numérique, Université du Québec ; ancien élève de l'École Normale Supérieure, pendant de nombreuses années il a enseigné la Sociologie de la culture et de la communication à la Sorbonne, et il a aussi été professeur à l'École Nationale Supérieure des Arts décoratifs.
Abstract
La crise planétaire en appelle à une campagne planétaire pour un art philosophique et éthique qui questionne la « normalité » politique, économique, sociale, mais aussi artistique qui nous a conduits à cette catastrophe. C'est le propos de mon manifeste pour un art actuel face à la crise. Les deux numéros spéciaux de M@GM@ sous le titre ART versus SOCIÉTÉ vont réunir une quarantaine d'artistes, historiens et sociologues de l'art, philosophes et écrivains d'une vingtaine de pays, qui s'interrogent sur l'évolution de nos rapports entre art et société dans leurs différentes cultures, mais qui convergent souvent dans leurs analyses souvent très critiques sur les mêmes causes mondiales. Les espoirs qu'ils évaluent et expriment diversement esquissent un panorama planétaire lucide. Soumission ou divergence ? L'art doit changer le monde. Ce sont les deux coups de gong qui résonnent dans cette publication en réponse à l'invitation d'Orazio Maria Valastro que je remercie vivement.

Signalisation sur le parvis du Centre Pompidou de l’exposition « Hervé Fischer et l’art sociologique », 2017 (photo Laurence Honnorat).
Manifeste pour un art actuel face à la crise planétaire
Les analyses abondent de tous horizons pour changer nos paradigmes, nos valeurs, nos gouvernances politiques, économiques, sociales, écologiques, culturelles, locales aussi bien que planétaires et nos comportements individuels, pour repenser nos pratiques de santé publique, d’éducation, de commerce, revaloriser la société civile face aux logiques surplombantes de nos gouvernants. Tout y passe, contradictoirement souvent. Mais force est d’entendre le silence assourdissant d’un grand absent de ce concert d’appels urgents à mutations : l’art. Pourtant dans le domaine de l’art aussi, la « normalité » qui nous a menés à une catastrophe planétaire doit être profondément repensée.
La créativité individuelle du « n’importe quoi est art » initiée par Dada, Fluxus, le happening, les installations les plus diverses, a eu ses vertus créatives, on ne saurait le nier. Mais cette liberté extrême, qui nous libérait des poncifs de l’art et de la société, et célébrait l’alliance de l’art avec la vie, a inévitablement, comme l’avant-gardisme exacerbé des années 1960-70, atteint un degré de caprice individuel, de saturation, de non-sens et d’épuisement de ses modalités expressives, qui en détournent aujourd’hui le public élitiste, et auxquelles le grand public n’a jamais adhéré. Et c’est sans compter que le monde a considérablement changé entre temps, appelant à de nouveaux engagements artistiques.
Quant au « market art » globalisé, trop souvent vide de sens et médiocre, sa fibre marchande l’a réduit à un simple produit financier de spéculation entre les quelques mains de collectionneurs richissimes, faiseurs et défaiseurs de côtes outrancières qui éclateront comme des bulles irisées de savon. Il n’est même plus le « supplément d’âme » du capitalisme déréglé qui l’a instrumenté, mais un vulgaire placement : faits du prince, ports francs et enchères. Cette dérive ahurissante a tué le marché traditionnel des collectionneurs et des galeries qui aimaient fidèlement les artistes qu’ils soutenaient durablement. Ceux-ci en sont réduits à devenir des artisans commerçants de redites esthétiques pour nouveaux riches ou, s’ils préfèrent demeurer des explorateurs authentiques du monde actuel, de petits autoentrepreneurs marginaux et miséreux dans un marché mondial qui les ignore et les réduit à quêter aux portes des programmes de bienfaisance des institutions culturelles gouvernementales, s’il en existe dans leur pays.
Nous sommes aujourd’hui confrontés à un bouleversement planétaire qui ne permet plus ce laisser aller « normalisé ». La crise, avec ses paradoxes inconciliables entre l’économie, l’écologie, la santé publique et le respect de l’homme, nous a enfermés dans un labyrinthe dont nous ne trouvons plus l’issue. Il nous faut pourtant agir rapidement pour survivre dans ce vortex obscur en accélération. Face aux dangers planétaires, la spirale verticale des philosophes postmodernes a perdu toute crédibilité. Comment peuvent-ils nier, comme s’y obstinent aussi les mathématiciens en astrophysique, et alors qu’elle est démontrée en géologie et dans les sciences de la vie, la singularité puissante de la flèche du temps dans notre histoire humaine, sous tension créatrice entre entropie et néguentropie, en rupture avec la répétition, la sélection et l’adaptation darwinienne, créant des divergences irréversibles. Il faut repenser l’art et la société, l’un autant que l’autre, qui sont inséparables, pour saisir de nouvelles chances dans cette disruption mondiale.
Tout ce qui est réel est fabulatoire, tout ce qui est fabulatoire est réel, mais il faut savoir choisir des fabulations porteuses d’espoir collectif et éviter les hallucinations toxiques qui nous ont conduit à cette crise mondiale qui n’en finit plus avec son cortège de souffrances humaines. Il faut donc en finir avec le cynisme de la résignation postmoderne aussi bien qu’avec l’irresponsabilité de l’aventurisme anthropocène, avec l’errance insignifiante du « n’importe quoi est art » aussi bien qu’avec la dérive triviale du « market art ». Il faut donner un sens à l’art. Il faut donner un art au sens. Certes, il n’y a pas de progrès en art, mais l’art change le monde.
Du scandale de cette crise émerge une conscience augmentée, hyperhumaniste grâce à la multiplication des hyperliens numériques qui nous informent en temps réel à l’échelle de la planète, nous imposant l’obligation et la responsabilité d’un art philosophique en quête d’une éthique planétaire, un technohumanisme en accord avec notre temps, respectant la puissance aussi bien que la fragilité de la nature, attentive à l’équilibre homme/nature autant qu’aux droits fondamentaux universels de l’homme, inclusive de notre diversité et des populations les plus vulnérables. Si nous ne croyons pas en l’Homme, il n’y a pas de solution.
Hervé Fischer, mai 2020, Montréal.
Ce manifeste, maintenant traduit en 17 langues a été repris sur beaucoup de réseaux sociaux par des artistes, sociologues, intellectuels qui s’intéressent aux problématiques actuelles de l’art. Et suite à l’appel international à signature que j’ai lancé en août 2020, j’ai reçu plusieurs centaines de signatures d’appui, venant de 50 pays. La journaliste et critique d’art Marie-Laure Desjardins m’a envoyé des Questions pour un manifeste et a publié mes réponses dans ArtsHebdoMédias [1].
Questions pour un Manifeste
C’est d’un chalet situé en pleine nature québécoise qu’Hervé Fischer a décidé de lancer un appel international à signatures pour un Manifeste rédigé en douze langues. Alors que la crise liée à la pandémie de la Covid-19 n’en est qu’à ses prémices, l’artiste agacé que les artistes ne soient pas plus sollicités par les médias et que leur voix soit par conséquent inaudible a décidé de prendre le taureau par les cornes en proposant un texte. « C’est une protestation vitale, d’appel à la divergence pour sortir de l’impasse avec de nouvelles valeurs, de nouveaux objectifs correspondant aux exigences d’une nouvelle image du monde », explique l’artiste-philosophe. Avec cette initiative, Hervé Fischer réactive ses anciennes pratiques d’art sociologique où diffusion d’idées par média de masse et participation du public étaient requises.

Quelle humanité ? acrylique sur toile, 91X159cm, 2000.
ArtsHebdoMédias : Comment avez-vous vécu le confinement lié à la pandémie de la Covid-19 ?
Hervé Fischer : J’ai pensé à la planète Terre, plus que jamais, quotidiennement. Comme tout un chacun - du moins veux-je le croire -, j’ai vécu cette pandémie comme une remise en question planétaire de notre « normalité », dont nous pouvions enfin, cruellement certes, mais lucidement, constater la perversité des logiques globales. Il n’était plus permis de douter de la réalité de la mondialisation, de notre interdépendance biologique, écologique, économique planétaire, pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Nous sommes sortis de nos hallucinations toxiques. Nous nous sommes réveillés. Et nous sommes en quête de nouvelles fabulations porteuses d’espoir. À titre personnel, j’ai vécu cette crise dans le chalet forestier des Laurentides au Québec où je vis, en osmose avec la nature hivernale, printanière et maintenant estivale, loin des dangers de contamination, sans mondanités comme toujours, et cela ne fut pas pour moi une restriction radicale dans mes habitudes de vie, comme ont pu le ressentir les citadins. Ce fût même un moment de pause intellectuelle et artistique très propice à la création. Il faut aussi souligner que l’internet m’a permis de communiquer autant que je le voulais avec tous mes amis aux quatre coins de la planète. Je dirais même, plus que jamais, pour m’assurer de leur santé, pour échanger des idées, pour partager des projets.

Mon émoticon de la solidarité humaine, adopté par le SAMU social international.
ArtsHebdoMédias : Quelles ont été les commentaires, les comportements, les nouveautés qui vous ont le plus étonné, marqué, interrogé… ?
Hervé Fischer : L’émergence, malheureusement brutale, de la pensée planétaire nous a tous frappés. Pas avec les ailes fragiles, imperceptibles de l’effet papillon, mais comme une chape de plomb gris qui nous immobilisait, nous confinait. Au moins, elle s’est enfin imposée à nous tous, nous obligeant à nous adapter à cette nouvelle « conscience augmentée », dont je souligne l’émergence et qui nous conduit à l’« hyperhumaniste », grâce à la multiplication des hyperliens qui nous informent à l’échelle planétaire, en temps réel, avec son cortège de morts et de souffrances humaines, mais aussi de rédemptions. Comme disait Hegel, du mal peut émerger le bien : cette « conscience augmentée », catalysée par la puissance des médias numériques, constitue un immense progrès anthropologique. Elle crée une solidarité humaine, de l’empathie pour les plus vulnérables, pour ceux qui sont frappés par le malheur, de l’indignation face à ceux dont le cynisme et la désinvolture nous ont conduit au chaos, bref, enfin, à l’émergence d’une éthique planétaire. Le très bon côté de cette catastrophe, c’est l’évidence incontestable que notre « normalité », cette logique globale que nous imposait, à nos gouvernements et à nous, les maîtres transnationaux du capitalisme néolibéral, nous conduisait droit dans le mur. Même les esprits les plus conformistes, les plus soumis, les plus aliénés en ont pris conscience. Le bon sens a changé de cap. Nous cherchons des alternatives crédibles et qu’il faut rapidement mettre en œuvre. Nous sommes enfin dans l’urgence de nouvelles valeurs, de nouvelles gouvernances.
ArtsHebdoMédias : Vous qui pensez la technologie depuis des décennies, comment avez-vous analysé l’appropriation en masse des outils de communication numérique, comme la visio-conférence ?
Hervé Fischer : Je suis de ceux qui croient depuis longtemps qu’il faut développer un esprit lucide, démystificateur par rapport à la magie numérique, mais qu’il faut aussi en célébrer les vertus créatrices. Je dénonce les hallucinations toxiques des trans- et posthumanismes, je ne suis pas fasciné par un avenir de cyborgs en bonne santé machiniste - disons numérique -, mais pense plutôt que la mort donne un sens à la vie, que l’homme et la nature sont aussi fragiles que puissants, et je propose donc l’alternative de l’hyperhumanisme, un technohumanisme en lien, lui aussi, avec le développement du numérique.
ArtsHebdoMédias : Les constats et idées que délivre le Manifeste ne sont pas nées pendant le confinement. Nombre de vos écrits prouvent que les préoccupations et positions énoncées ne datent pas d’hier. Pourquoi choisir la forme du manifeste pour y revenir ?
Hervé Fischer : Nous sommes sous le choc du chaos planétaire qui nous a soudain mis à terre. Il s’agit de ce que j’appelle une divergence qui s’impose dans le ronronnement sociétal, comme la chute du mur de Berlin ou les attentats du 11 septembre 2001. J’ai consacré un livre à cette idée de divergence : elle est pour moi ce qui marque chaque fois les grandes étapes de notre aventure humaine. Aujourd’hui donc, chacun s’interroge, admet que la « normalité » était terriblement toxique, voire létale. Avant ce choc, on voulait encore croire à la capacité humaine de trouver toujours des solutions pour se tirer d’affaire. On ronronnait dans le gaz de voiture. On appuyait sur l’accélérateur dans une fuite en avant collective. Personne ne prêtait une grande attention aux déclarations des sonneurs d’alarme. La logique surplombante des intérêts spéculatifs, alliée à la difficulté de penser des alternatives « crédibles » dans le réalisme fabulatoire du système de pensée dominant aveuglait les maîtres et assourdissait les oreilles des masses.
Soudain, le déni se tait. On parle de mutations nécessaires, on dit que l’impensable est devenu pensable. On parle même d’urgence, de compte à rebours. Les politiques, les écologistes, les économistes, les intellectuels parlent de tout, tout le temps, dans les grands journaux, sauf les artistes : grand silence des artistes, alors que le monde artistique est devenu chaotique bien avant cette pandémie, depuis des décades. Le binôme « Market art » spéculatif et « n’importe quoi est art » capricieux y font leurs délices. Les grands journaux pensent donc sans doute que les artistes ne méritent pas qu’on leur donne la parole, ou qu’ils n’ont rien d’important à dire. Cela m’a fâché. Les artistes ont pu prendre conscience depuis longtemps de la perte de sens, de valeurs humaines, de responsabilité, dans laquelle nous tournions en rond comme dans un labyrinthe sans issue. Un manifeste naît dans un moment de saturation de la pensée conformiste en perte de légitimité. C’est une protestation vitale, d’appel à la divergence pour sortir de l’impasse avec de nouvelles valeurs, de nouveaux objectifs correspondant aux exigences d’une nouvelle image du monde. La déclaration publique du manifeste s’est imposée à moi pour prendre dans l’urgence mon droit de parole publique.
ArtsHebdoMédias : Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par « nouveaux engagements artistiques » ?
Hervé Fischer : Mon manifeste les expose synthétiquement ; ces engagements constituent un changement de posture de l’art dans sa fonction sociale. Le temps est passé du ronronnement ou des folies esthétiques aujourd’hui épuisées. C’est l’éthique qui s’impose. Ce que j’appelle le « market art » instrumentalisé cyniquement par le capitalisme libéral n’a plus de sens autre que spéculatif. Une marchandise, piètre chant du cygne d’un monde qui a implosé. Le drame capitaliste a tourné à la tragédie humaine apocalyptique, où l’argent même, dont nous avions fait une religion, s’évapore par centaines de milliards. Face au chaos planétaire, l’art doit se réinventer selon des questionnements philosophiques sur le sens de notre aventure humaine, moins sur notre « image du monde » aujourd’hui brisée, que sur le changement en accélération, et donc sur la direction à prendre pour construire une nouvelle image du monde, à laquelle l’humanité puisse aspirer, qui puisse nous réunir.
ArtsHebdoMaédias : Vous écrivez que « la spirale verticale des philosophes postmodernes a perdu toute crédibilité », qu’entendez-vous par-là ?
Hervé Fischer : Les désenchanteurs, les déhumanistes postmodernes ne croyaient plus à la flèche du temps, parce que nous avons décrédibilisé le mythe du progrès linéaire dans des génocides monstrueux. Ils croient donc que l’humanité change, certes, mais en faisant du surplace quant au progrès. Ils ont remplacé la flèche du temps par la métaphore de la spirale, qui monte en puissance ou descend. Nous serions donc actuellement en décadence. D’où la crise. Alors que nous sommes retombés dans le chaos, je suis de ceux qui croient donc encore et plus que jamais à la nécessité du progrès humain collectif, fusse-t-il utopique, pour nous en sortir.
ArtsHebdoMédias : Vous exhortez à « repenser l’art et la société » et à donner « un sens à l’art » ainsi qu’« un art au sens », la voie que vous tracez est celle de l’hyperhumanisme et de l’art philosophique. Comment pensez-vous qu’un tel programme puisse être mis en application ?
Hervé Fischer : C’est une utopie. Nous ne pouvons pas vivre sans mythe, fusse-t-il Dieu, le capitalisme ou la technoscience. Mais contrairement aux fabulations trans- et posthumanistes, ou néolibérales, l’hyperhumanisme et l’éthique planétaire ne présentent aucun danger. Ils sont utopiques, certes, mais prennent en compte la fragilité humaine et celle de la nature et proposent à l’humanité de progresser vers son accomplissement, vers une transcendance humaine, plutôt que célébrer son obsolescence biologique.
ArtsHebdoMédias : Vous sentez le monde à un point de bascule mais ne cédez pas à la tentation du catastrophisme. Avec vous, il existe toujours une issue meilleure qu’une autre. D’où tenez-vous cette croyance en l’Homme ?
Hervé Fischer : Oui, nous sommes à un point de bascule, celui d’un âge anthropocène qui nous expose aux plus grands des périls en exploitant et détruisant la nature au nom des droits de l’homme en quête inlassable de surpuissance apocalyptique. Il faut reprendre le contrôle au nom de ce qu’il y a de meilleur dans l’homme. Cet Homme est un mythe. C’est pourquoi il ne peut être qu’une croyance, comme Dieu, mais qui exalte notre liberté créatrice plutôt que notre souffrance et notre soumission. Et à qui d’autre nous en remettre ? À la providence divine ? À la nature ? À la sagesse de la technoscience ? Au destin ? À qui d’autre qu’à l’Homme ?
Art versus science versus société
Cet entretien avec ArtsHebdoMédias m’a permis de préciser les fondements de mon manifeste. Mais je me dois de considérer encore une question très actuelle de l’art, que la brièveté d’un manifeste ne permettait pas d’aborder. Face aux défis de la technoscience, beaucoup d’artistes explorent aujourd’hui les processus de la biotique, de la biogénétique, des modélisations moléculaires, de la robotique, des nanotechnologies et de l’intelligence artificielle qui vont donner un élan exponentiel à notre évolution, pour le meilleur assurément, mais aussi pour le pire possiblement. Ce sont des pratiques artistiques nécessaires et des plus légitimes, aussi tâtonnantes puissent-elles être dans leurs ambitions et dans leur diffusion.
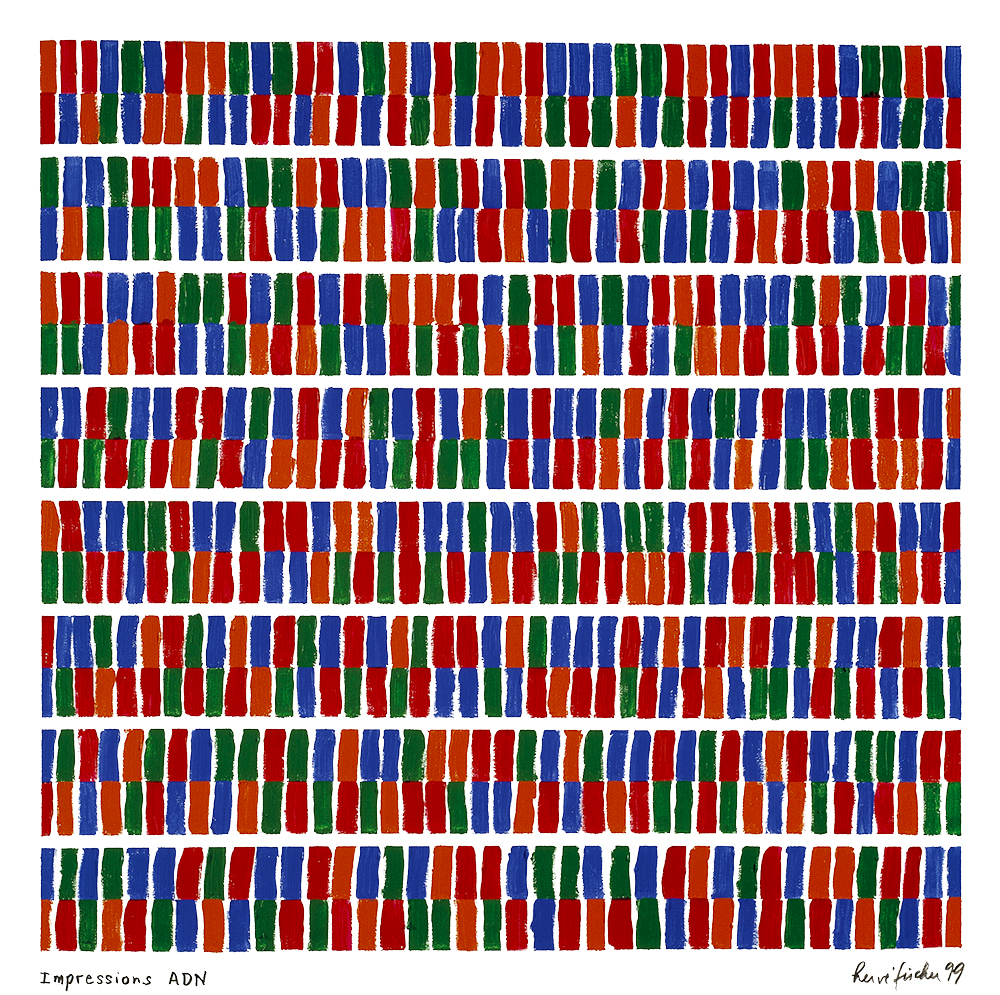
Impressions ADN, acrylique sur toile, 101x101cm, 1999 (collection MNBA, Santiago du Chili).
L’art doit explorer l’actualité de la technoscience, cela s’impose, autant que celle de l’économie à laquelle nous nous soumettons dans ce système techno-capitaliste aujourd’hui omniprésent. Beaucoup d'institutions de financement artistique le reconnaissent aujourd'hui, et s’en font même une recette de bon aloi, après en avoir négligé les pionniers dans les années 1980-90, qui étaient alors sans moyens financiers et pourtant souvent beaucoup plus créatifs que ceux qui leur succèdent aujourd'hui. Ils étaient alors les « patenteux » des logiciels qu'ils programmaient, des mécanismes électroniques et robotiques qu'ils bidouillaient envers et contre tout, tout seuls: j'en témoigne en connaissance de cause au nom des dix années d'expositions « Images du futur » de la Cité des arts et des nouvelles technologies que j'ai fondée à Montréal en 1985 avec Ginette Major [2]. La technologie numérique, à cette époque, n'écrasait pas encore l'expression artistique alourdie aujourd'hui par ses budgets toujours plus considérables, sa complexité technique toujours plus difficile à maîtriser et toujours en évolution, de sorte que nos artistes actuels de la technoscience numérique, aussi justifié que soit leur objectif, n'accouchent souvent que d'une souris. Mais nous ne reprocherons pas à Eduardo Kac d’avoir sorti de son chapeau de prestidigitateur un lapin un peu verdâtre de l’INRA, dont il s’est fait une célébrité. Ses photos dans les journaux ont eu, en dépit de son sourire, peut-être le mérite du sonneur d’alarme face aux expériences de la biogénétique. Et nous voyons émerger des artistes qui, au-delà de l’interactivité ludique et rétinienne des pionniers, abordent désormais ces problématiques fondamentales de l’âge du numérique sans en devenir les otages, et tentent d’en montrer les enjeux philosophiques et éthiques.
Ils demeurent le plus souvent modestes face à des défis si considérables et le temps semble révolu où les artistes du numérique méprisaient ostensiblement les artistes des beaux-arts, qu’ils déclaraient « passés-date », « obsolètes », à l’exemple de Jean-François Lyotard lorsqu’il organisa en 1985 au Centre Pompidou l’exposition mémorable Les Immatériaux. Il me semble qu’une réconciliation est en cours entre les beaux-arts et les technologies numériques et que se développent « les beaux-arts numériques » que je revendique pour moi-même.
Nous avons besoin que ces artistes travaillent à l’exploration critique du numérique face à sa domination invasive. Nous avons cependant vu émerger parmi eux quelques artistes vedettes de la nouvelle alliance Art et Science, qui se pensent comme des nouveaux génies d’une prétendue « Renaissance », cette fois antihumaniste, car ils se déclarent fascinés par l’utopie posthumaniste de l’obsolescence de l’homme de vieux carbone. Le silicium serait plus intelligent et plus noble que le carbone, bien qu’il soit aussi commun dans la nature. Ils célèbrent finalement le numérique, avec une sophistication adhésive à notre croyance technoscientifique, sans en questionner sérieusement les valeurs éthiques, esthétiques et encore moins la pensée magique. Je ne partage évidemment pas l’enthousiasme des artistes qui prétendent devenir des cyborgs, fiers de préfigurer un futur transhumain ou posthumain merveilleux. Ils se prennent pour des nouveaux Léonard de Vinci, sans en avoir ces compétences extraordinaires d'ingénieur qu'il a démontrées en son temps, et encore moins le génie. Et comme ils maîtrisent inévitablement mal les exigences de plus en plus grandes de l’informatique, de la génétique, de la robotique, de l’intelligence artificielle, ils font appel dans leurs ateliers à des assistants experts, dont ils deviennent totalement dépendants, et à des industriels mécènes et des programmes de subvention publique qui les soutiennent, au point d’oublier eux-mêmes la fonction interrogative et critique de l’art.
De ce fait, beaucoup d’entre eux sacrifient inévitablement aux industries du divertissement et réalisent des gadgeteries spectaculaires d'effets multimédias interactifs, comme les artisans des divertissements du Versailles du Grand Roy, oubliant que ceux-là étaient eux-mêmes les experts les plus talentueux pour concevoir et faire fonctionner des jeux d'eau, créer des effets de perspective paysagiste, monter les machineries de spectacles grandioses. Bien sûr, les grands peintres de jadis avaient leurs ateliers, mais leurs assistants étaient eux-mêmes des artistes en apprentissage, qui souvent sont devenus à leur tour de grandes signatures. C'était le cheminement normal et nécessaire à la formation des artistes, tandis qu'actuellement, l'informaticien qu'emploie un artiste retourne après cet épisode artistique dans son laboratoire suivre sa carrière normale. Certes, l'expérience artistique a pu lui être personnellement et professionnellement très profitable. Il deviendra peut-être même un assistant très recherché. Mais la démarche solitaire de l'artiste demeure un symbole romantique d'une telle puissance idéologique, que seul celui-ci bénéficiera socialement de la signature de l’œuvre, même si son rôle n'a été que de demander à des professionnels de réaliser une idée insolite. Il en est de même en architecture, lorsqu'un créateur recherché, tel Frank Gehry ou Ming Pei, vient voir des ingénieurs pour faire tenir debout en acier, verre, béton et autres matériaux intelligents ce qui n'est qu'un coup de crayon barbouillé sur une feuille de papier, défiant les lois de la gravité et de l'architecture et créant ainsi un effet d'autant plus spectaculaire pour célébrer son prince financier. Pas moins de 30 brevets ont été déposés pour la seule installation des panneaux de verre de la Fondation Vuitton à Paris. Cela fait partie de ses titres de gloire, mais qui en connait un seul auteur ? Nous ne connaissons et admirons - éventuellement - que Frank Gehry.
Artistes ou mystificateurs ?
Ces problématiques demeurent d’une grande complexité, qu’on ne saurait reprocher aux artistes qui s’y aventurent, mais qui les expose à des défis particulièrement difficiles. Les artistes courtisans de Louis XIV ou de Napoléon, qui peignaient la gloire des Grands, avaient des talents immenses et sans partage ! La technoscience contemporaine a désormais aussi ses courtisans pensionnés, mais qui ne sont que des artistes amateurs en science et en technique, dénués des capacités nécessaires pour interroger leur nouveau maître plutôt que de le flatter. Les concepteurs de jeux vidéo ou d’effets spéciaux au cinéma d’aujourd’hui ont manifestement ces talents d’experts qui font cruellement défaut à la plupart des artistes du numérique. Cela se voit. Et cela les empêche d’exercer tout esprit critique. Il faut savoir maîtriser soi-même ce que l'on crée pour ne pas s’y aliéner. Il faut savoir questionner les maillons faibles du numérique, savoir exploiter soi-même l'intelligence artificielle dont on se réclame, pour aller au fond des questions artistiques et éthiques qu'elle pose. Certains s'y essaient prudemment, modestement, inévitablement de plus en plus difficilement, tandis que ces technosciences deviennent des champs de compétences pointues dans lesquels ils seront toujours de plus en plus à la traîne.
Le physicien et philosophe des sciences Jean-Marc Levy-Leblond, aussi intéressé par les arts que par les sciences, a clairement mis en évidence les différences irréconciliables qui existent entre art et sciences. Il est très difficile pour un artiste d’en connaître assez sur les nouvelles technosciences médicales et de se tenir à la pointe de l’information sur le génome pour faire œuvre géniale en biogénétique ! Il en est de même en intelligence artificielle, en informatique, en robotique, etc. Ces artistes légitimement fascinés par la technoscience de la vie risquent de devenir illégitimes et de passer pour des mystificateurs, affichant des compétences qu'ils n'ont pas. Et comme les arts numériques sont devenus le nouvel art officiel des institutions publiques, heureuses de subventionner des créations qui n'expriment plus de critiques politiques et rejoignent notre nouvel engouement pour le divertissement (curiosité pour la performance technique et magie de l’interactivité), le danger est bien réel. Il ne faut pas oublier le rôle essentiel, humain, fragile, nécessairement individuel de l'artiste en proie à plus de questions que de solutions, sur notre condition mortelle et notre rédemption. Et le langage numérique n’est pas nécessairement le meilleur moyen d’en questionner ses propres accomplissements. Ce n'est pas le progrès de la technologie qui fait l'art. La question du progrès n'a aucun sens en art. C'est la fragilité de l'homme qui fait la grandeur de l'art.
À cet égard, les artistes écologistes me semblent actuellement mieux en mesure de questionner les menaces que fait peser la nouvelle puissance technoscientifique sur la nature et donc sur notre avenir. Mais ce n’est pas tant en déployant des dispositifs numériques interactifs spectaculaires et exorbitants, qu’en usant du langage et des artefacts familiers de la nature elle-même, comme le font les artistes des cultures autochtones [3]. La plupart en recueillent certes moins de célébrité que les gourous du numérique, mais la simplicité de leur démarche critique et l’efficacité de leur communication avec le public, serviraient utilement de modèle aux artistes qui ont choisi de faire œuvre dans les arcanes du bio-numérique. Je le dis en artiste passionné des avancées technoscientifiques et soucieux d’en faire partager à une large audience les défis de plus en plus étonnants, mais qui ne relèvent pas de l’amusement public, c’est le moins que l’on puisse dire [4].
Tout cela étant dit, je me demande comment un artiste peut se concentrer obsessionnellement sur une question d'artiste, alors qu'il doit gérer un atelier, un budget, des expertises et des relations publiques aussi complexes. Certes, Rubens en était capable, mais il était le premier à dominer toutes les compétences des assistants qu'il recrutait, dans un art dont la technique n’était encore qu’un artisanat qui ne posait pas de questions métaphysiques par lui-même. Et quelle aurait été la réponse de Giacometti ?
Les convergences d’une grande diversité de contributions à cette publication
Simultanément à la diffusion de ce manifeste, j’ai répondu à l’invitation d’Orazio Maria Valastro de réunir des contributions pour un numéro spécial de la revue en ligne M@GM@ sur le thème que je lui proposais : art versus science. Voici l’appel à contribution que j’ai donc lancé en mai 2020.
L’histoire des rapports entre art et société est vieille comme l’humanité même si le concept d’art est plus récent. Ces rapports ont été au cours des millénaires animistes, magiques, religieux, politiques, aujourd’hui capitalistes, tantôt intégrateurs, tantôt militants, tantôt critiques, niés aussi à plusieurs reprises. Ils ont pris diverses formes, rituelles, visuelles, musicales, théâtrales, chorégraphiques, littéraires, cinématographiques, multimédia. Leurs institutions et leurs modes de diffusion ont considérablement évolué aussi au fil des sociétés et des technologies. Invité par Orazio Maria Valastro à préparer un numéro spécial de la revue électronique italienne M@GM@ qu’il a fondée, sur le thème art versus science, je pense à une douzaine de contributions dont la vôtre, si vous le voulez bien, que je souhaite vivement. Je conçois cette publication orientée vers la modernité et l’actualité, sans exclure des regards rétrospectifs insistants. Je souhaite qu’elle constitue un événement de référence incontournable et je vous invite donc à la plus grande liberté de pensée et d’écriture. Les textes pourront compter de 1000 à 10 000 mots. L’édition électronique permet d’inclure des illustrations couleur. Sa version papier éventuelle sera inévitablement plus restrictive, mais renverra aux illustrations des deux numéros spéciaux de la revue en ligne M@GM@.
J’ai tenu à faire appel à une grande diversité de points de vue, tenant aux cultures, aux biographies et aux activités des un(e)s et des autres : artistes, historiens d’art, sociologues, philosophes, essayistes, engagés dans des démarches personnelles ou dans des projets collectifs. Le nombre des contributions a triplé au fil des jours, créant un panorama très international, qui est aussi celui du réseau d’amitiés qui m’anime depuis une cinquantaine d’années, démontrant une prise de conscience planétaire. S’anime et se renforce ainsi, dans cette démarche de plus en plus partagée, un collectif de femmes et d’hommes qui partagent une exigence de questionnement et réactualisation de la fonction interrogative et critique de l’art. Car nous voyons apparaître de nombreuses convergences au cœur de cette diversité de cultures. Beaucoup sont pessimistes, voire désabusés. Les uns et les autres font le constat d’une perte de sens et de valeur dans le chaos des catastrophes et le magma de la consommation massmédiatique de divertissement. Mais au-delà de la résignation postmoderne, demeure, même chez les plus réalistes et les plus angoissés, une lueur d’espoir. Ils sont convaincus qu’il faut éviter les illusions, combattre les dérives menaçantes, mais aussi concevoir un technohumanisme difficile à penser mais nécessaire. Je veux espérer que la dynamique de ce collectif s’amplifiera, engendrant la confiance active de contribuer ensemble à un tournant de la pratique artistique, cette divergence philosophique et éthique planétaire de l’art que j’appelle.
Entropie et néguentropie
Si nous tentons de redonner un sens à l’art et un art au sens, il nous faut revenir à la fonction cosmologique de l’art, dont toute société se nourrit. Où en sommes-nous aujourd’hui, alors que les religions nous apparaissent comme des superstitions toxiques et que l’astrophysique progresse en se perdant elle-même dans des fabulations de plus en plus incertaines, sans réussir à sortir du dilemme entre le hasard et la nécessité ? Quelle image du monde un artiste peut-il aujourd’hui concevoir pour esquisser les espoirs d’une société ? Doit-il s’en tenir à une posture interrogative, comme je l’ai proposé au début des années 1970 dans la théorie et la pratique de l’art sociologique ? Cette exigence ne suffit plus. Face à la crise planétaire actuelle, à son cortège de souffrances humaines, à l’injustice qui accable les populations les plus vulnérables, à l’urgence de « réparer » les destructions que nous avons infligées à la nature, s’impose l’exigence d’un engagement éthique et écologique.
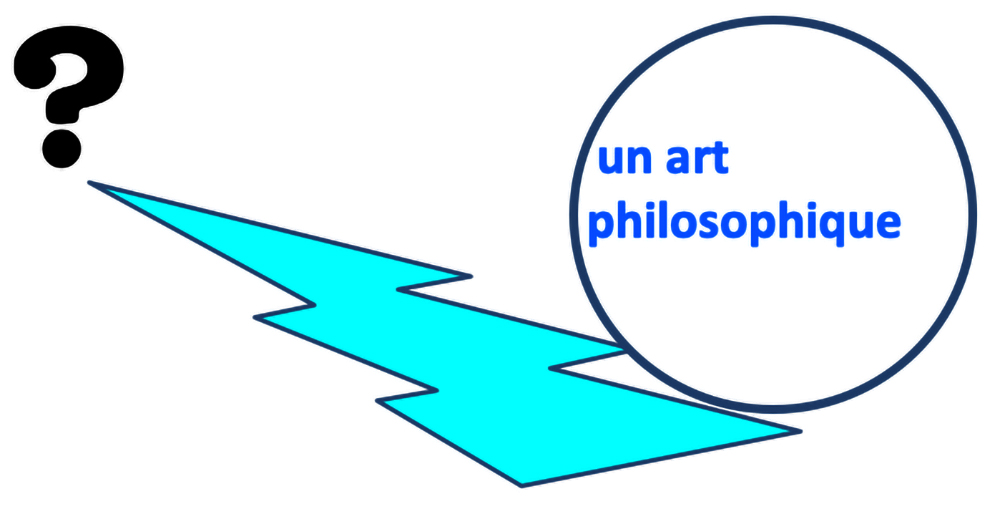
Twet art, 2017.
Parlons d’abord de la brisure de notre cosmogonie occidentale. Il nous faut admettre que ces crises à répétition couronnées par la Covid 19, ont le mérite de questionner notre ancienne « normalité », de nous imposer de repenser nos valeurs fondamentales, de nous mettre en quête d’une mutation humaniste. C’est, au prix de grandes souffrances, une opportunité vitale qu’il faut saisir pour surmonter cette crise en progressant vers un nouvel équilibre entre mondialisation et enracinement local, société et individu, homme et nature. Bien sûr il n’y a d’universel que le respect des droits fondamentaux de l’Homme, quelle que soit la diversité des cultures. Et le droit à la différence tout comme le droit à la liberté d’expression individuelle s’imposent à nous non seulement comme deux de ces droits universels, mais aussi comme une valeur essentielle de l’humanité, fondatrice de l’art. La diversité de nos cosmogonies doit prévaloir, tant que l’une ou l’autre, longtemps celle du monothéisme du Vatican, aujourd’hui celle de l’islam intégriste, demain si nous n’y prenons pas garde celle du Grand Ordinateur Central des ingénieurs-prophètes de l’intégrisme numérique, alliée à la logique implacable du capitalisme conquérant, ne deviennent pas des hallucinations toxiques cherchant à nous soumettre mondialement à leur loi.
Entropie et néguentropie vont de pair comme une danse de tango, dans une constante tension sans laquelle il n’y aurait pas d’évolution. Il ne faut pas diaboliser l’entropie, comme le font les utopies trans- et posthumanistes. Il ne faut pas condamner la fragilité de l’homme, ni les cycles de la vie qui incluent la mort à l’égal de la naissance pour assurer son évolution. Mais à l’entropie il faut opposer des valeurs humaines porteuses d’espoir, celles de la solidarité planétaire. Face au désordre éthique et social, il y a de cela plus de deux millénaires, Confucius fit l’éloge des liens humains. En Occident, c’est Aristote qui souligna que l’homme est un « animal politique » - la polis étant la communauté humaine. Tout récemment le biologiste et généticien français Albert Jacquard rappelait que « nous sommes les liens que nous tissons ». La pandémie, mettant simultanément en évidence, pour le meilleur et pour le pire, l’unité biologique de l’humanité et la nécessité sociale de nos liens les plus individuels, convoque la mythanalyse qui travaille à repérer et déchiffrer nos imaginaires sociaux. Le paradoxe, c’est que ce virus qui nous lie mondialement, détruit nos liens de proximité les plus précieux. Nous avons besoin de reconstruire sur de nouvelles bases le mythe de notre unité humaine et la gouverne de la planète.

Crisis – Neuquen, peinture acrylique sur toile, 90x140 cm, 2009.
Assurément cette pandémie ne sera pas la dernière. Et de crise en crise, économique, financière, sociale, écologique, migratoire, virale, nous nous éduquons. Malgré les potentats qui y opposent leurs cerveaux reptiliens, nous sommes de plus en plus nombreux à chérir et développer plus solidement et plus finement dans nos consciences et dans nos institutions cette coopération mondiale. Nous la jugions souhaitable, mais elle est désormais incontournable pour préserver nos vies, restaurer la nature à laquelle nous appartenons à part entière, et même créer une économie sociale, si nous ne voulons pas que l’écart exponentiel entre notre puissance technologique et notre conscience humaine encore si arriérée ne nous conduise à l’apocalypse. Certes, nous pouvons encore nous protéger par le confinement, puis un vaccin et nous viendrons à bout de ce virus ; mais comment échapper aux effets planétaires beaucoup plus durables du réchauffement climatique et aux bouleversements tragiques qu’il provoque partout, creusant l’inégalité des communautés, des standards de vie. La solidarité planétaire ne concerne pas seulement la santé publique. Nous découvrons qu’elle est encore plus fondamentale au niveau écologique. Face à ceux qui opposent aux changements climatiques un déni irresponsable, fallait-il le surgissement d’une pandémie létale pour découvrir l’aveuglement de notre instinct de puissance, de nos obsessions économiques à court terme, de notre désinvolture éthique ? Faudra-t-il plusieurs autres pandémies, encore plus catastrophiques, pour que nous devenions collectivement lucides ? Cela me semble inévitable, mais je suis un optimiste à long terme. Nous n’aurons pas le choix et nous progresserons. C’est l’affaire de tous, mais aussi de chacun.
Conscience augmentée et hyperhumanisme [5]
Le virus a révélé à ceux qui n’y voyaient qu’un fantasme la réalité indéniable de la mondialisation de nos liens humains, même les plus intimes. La pandémie nous montre la puissance aujourd’hui destructrice de notre dépendance planétaire, et en retour la nécessité de la solidarité humaine, planétaire elle aussi, qu’elle induit pour surmonter la catastrophe. Nous apprendrons aussi à en tirer les avantages incontestables. La mondialisation se renforcera inévitablement. Et nous avons maintenant, du fait des terribles destructions du tissu social, une preuve de la nécessité absolue de la solidarité humaine, qu’elle nous éclaire par ses exploits ou par son absence phosphorescente. La solidarité humaine est là, active ou bafouée mais présente à l’esprit de tous. Nous le savions déjà du point de vue économique, écologique et migratoire, mais cette fois elle s’est imposée, non plus comme un horizon inaccessible, mais dans l’expérience ordinaire de chacun de nous, le confinement, les faillites d’entreprises, le chômage généralisé, la limitation des libertés individuelles, la perte de jouissance de nos habitudes les plus simples et jusqu’à la mort de centaines de milliers de personnes. Dans la lutte aussi que nous menons ensemble. Nous ne pouvons plus nier l’interconnexion planétaire de l’humanité comme une communauté de conscience mondiale.

Sisyphe et la Tour de Babel, acrylique sur toile, 178x178cm, 2010.
Nous parlons certes de l’anthropocène. L’humanité modifierait désormais davantage notre planète que les forces de la nature. À l’âge du numérique, nous nous en croyons maîtres et nous la détruisons en épuisant systématiquement ses ressources, nous manipulons la génétique, et les gourous ingénieurs des trans- et posthumanisme, intégristes du numérique, nous annoncent que bientôt, avec des molécules synthétiques et l’intelligence artificielle, nous allons vaincre la vieillesse et même la mort. Pourtant, à l’opposé de ces fabulations, nous constatons tous la difficulté bien réelle que nous avons à contrôler et vaincre un minuscule virus qui a plus transformé notre écosystème humain en quelques semaines que les technologies numériques en une génération. Et ce n’est pas peu dire !
Tandis que la pandémie fait rage, nous avons découvert à quel point il est difficile de s’isoler individuellement d’une contamination planétaire. Nous avons dû bloquer l’économie, les compagnies aériennes, les transports en commun, fermer des routes, des ponts, contrôler avec des drones et des applications numériques invasives nos déplacements et même nos libertés individuelles. Nous avons accepté que soient interdits les gestes quotidiens les plus simples de socialité, les poignées de mains, que nous soient imposés des « gestes-barrières », un néologisme de circonstance, soudain traduit dans toutes les langues. Nous changeons de trottoir en croisant d’autres personnes. Voilà que nous avons peur des autres, et même des soignants ou de nos grands-parents dans les résidences de personnes âgées ! Tous ces gestes, toutes ces contraintes sanctionnées par la loi, contrôlées par la police et l’armée, toute cette désorganisation instituée, ce bannissement de nos liens humains usuellement tant prisés, nous nous y soumettons pour sauver des vies ! Tel est le leitmotiv de nos gouvernements, de nos médecins. L’éradication de ces liens naturels a constitué une véritable chirurgie sociale, lourde et handicapante, un basculement sociétal vécu souvent dans une grande souffrance, la détresse et une augmentation conséquente des violences domestiques. Autre surprise : la science, à laquelle beaucoup de gens refusent encore toute crédibilité pour des raisons archaïques, notamment religieuses, a pris le pouvoir sur les politiques, qui s’en sont fait le relais sous peine de se décrédibiliser eux-mêmes s’ils n’y sacrifiaient pas l’économie, les élections, leurs réflexes partisans et même la convivialité. On n’avait encore jamais vu ça, alors même que les experts scientifiques se contestent entre eux ! Le traumatisme est si profond qu’il induira peut-être durablement, après la crise, une mutation sociale, une nouvelle gouverne dont la nécessité nous est apparue en négatif à travers les maillons faibles de nos réseaux humains.
J’appelle « conscience augmentée » cette conscience planétaire, en temps réel, émergente, dont nous observons la réalité indéniable à l’occasion de la pandémie. Ni la peste, ni le choléra, ni la grippe espagnole n’ont créé en leur temps cette conscience augmentée.
Cette conscience augmentée est planétaire. Nous sommes informés des drames naturels et humains, partout dans le monde, et aussi des secours humanitaires. Nous avons appris à prendre conscience de l’unité biologique de l’humanité. Mais nous sommes désormais aussi tous liés technologiquement dans une conscience commune de notre destinée humaine. Jamais cela n’était arrivé. Du fait de la multiplication exponentielle des hyperliens numériques qui nous informent en temps réel et à l’échelle planétaire de tout ce qui se passe de bien et surtout de mal sur la Terre, qu’il s’agisse d’incendies dans la forêt amazonienne, de retour de la poliomyélite en Afrique, du permis de conduire des femmes en Arabie saoudite, du réchauffement arctique ou d’un tweet scandaleux de la Maison blanche à Washington. Nous voyons avec nos yeux sur nos écrans les êtres humains confrontés à ces situations. Nous entendons les dénonciations, les appels à solidarité. Nous participons de visu à distance aux grands événements culturels et sportifs. Nous sommes impliqués dans notre conscience, émus, indignés par toutes ces informations planétaires. C’est un phénomène anthropologique inédit, aux conséquences positives incalculables ! L’internet, de plus en plus invasif, est devenu le moteur du développement de la transparence nécessaire à la démocratie. Certes les réseaux sociaux charrient des torrents de haine, diffusent des propagandes racistes, des fake news et des rumeurs toxiques, des niaiseries dérisoires, mais leur effet régressif me semble mineur face à l’augmentation des prises de conscience éthiques qu’ils suscitent. Je n’y vois qu’un mal passager, car nous apprendrons à les filtrer beaucoup mieux avec le temps et la multiplication des sources d’information qui se confrontent à tout instant.
L’autre vertu de cette conscience augmentée, c’est en effet qu’elle se constitue en temps réel. Nous connaissons immédiatement, grâce aux hyperliens numériques, tel drame naturel ou humain, telle décision politique, un scandale surgi dans l’autre hémisphère. Nous en ressentons d’autant plus l’intensité émotionnelle, qui fait vibrer notre conscience, qui nous fait ressentir plus fortement notre indignation ou notre joie, qui nous incite à juger, réagir, dénoncer, aider, bref qui nous engage réactivement dans le grand corpus planétaire de cette conscience augmentée. Nous devenons tous et chacun partie prenante de cette conscience augmentée, planétaire, en temps réel. C’est un progrès inédit du point de vue anthropologique.
Durant cette pandémie nous avons pu suivre chaque jour les défaillances et les progrès de la lutte collective. Les rois pris au dépourvu étaient nus. Nous avons vibré, chacun de nous, au rythme de ces informations, des pulsations de cette conscience augmentée qui s’est imposée à nous, dans notre boîte crânienne volens nolens. Nous sommes devenus citoyens de la planète autant que de notre communauté locale.
Notre conscience individuelle ne sera plus jamais étroitement limitée à notre micro enracinement. Nous vivons chacun chez soi, mais avec fenêtre grande ouverte sur la planète entière. C’est le journal télévisé quotidien qui nous apprend, par exemple, que les communautés noires et latino des États-Unis connaissent des taux plus sévères de mortalité que les communautés blanches. Et nous nous demandons alors qu’en est-il dans les camps de réfugiés ? En Afrique, en Inde, dans les pays dont les infrastructures sanitaires sont fragiles, où les cultures et la pauvreté favorisent les pandémies ? Nous apprenons à craindre que le virus ne s’y répande sans limite. Et nous nous sentons concernés, non seulement par empathie, mais aussi parce qu’il risque de revenir en boomerang dans nos pays riches. Nous prenons face aux ravages et à la puissance de cette pandémie, encore davantage conscience de la nécessité de la solidarité humaine planétaire pour la vaincre. Nous devenons responsables de toute l’humanité dans laquelle nous sommes inclus parce que nous sommes exposés à subir l’effet létal de tous ses maillons faibles.
L’émergence indéniable et assurément définitive de cette « conscience augmentée » est à mes yeux beaucoup plus importante anthropologiquement que l’invention assurément remarquable de la « réalité augmentée ». Car il s’agit en l’occurrence d’un progrès de la conscience, qui demeurera toujours beaucoup plus déterminant que le progrès de la technologie pour l’avenir de l’humanité. C’est notre conscience de la complexité mondiale qui augmente. Prendre conscience : l’expression le dit bien.
Cette pandémie planétaire est là pour le pire - nous en faisons l’expérience -, mais aussi, nous le croyons, pour le meilleur. Elle nous contraint à construire les valeurs nouvelles de notre conscience augmentée, un humanisme plus fort, un hyperhumanisme. Hyper aussi parce c’est grâce à la multiplication des hyperliens numériques que nous devenons des milliards de consciences interconnectées engendrant constamment cette conscience augmentée, qui pulse et vit au rythme des informations qui y circulent, comme dans un réseau synaptique planétaire. C’est un autre paradoxe qu’il faut souligner : la technologie numérique crée de la conscience. L’hyperhumanisme c’est le technohumanisme que fait émerger l’âge du numérique.
Notes
[1] Publié le 5 août 2020, www.artshebdomedias.com.Je le reprends ici avec son accord, dans la mesure où cet entretien peut éclairer plusieurs aspects du manifeste.
[3] Et plusieurs artistes plus urbanisés, tels Joseph Beuys, Barbara et Michael Leisgen, Lucy et Jorge Orta, Michael Pinsky, Lorenzo Quinn.
[4] C’est la tâche que je me suis moi-même donnée en fondant en 1990 au Québec le Festival Téléscience, que j’ai animé pendant dix ans, y accueillant des personnalités aussi prestigieuses que Buzz Aldrin, le professeur Montagnier, Hubert Reeves, le prix Nobel llya Prigogine et en fondant en 1998, au Québec aussi, le regroupement Science pour tous des organismes de culture et vulgarisation scientifique, que j’ai présidé pendant vingt ans.
[5] Hervé Fischer, L’Âge hyperhumaniste. Pour une éthique planétaire, éditions de l’Aube, La Tour-d’Aigues, 2019.