Obtient son Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique en 2012 à l'École supérieure d'arts et de design du Havre. En 2013, elle intègre la résidence artistique de la Villa Calderon de Louviers (Eure), résidence conclue par une exposition collective intitulée Tellement vrai.
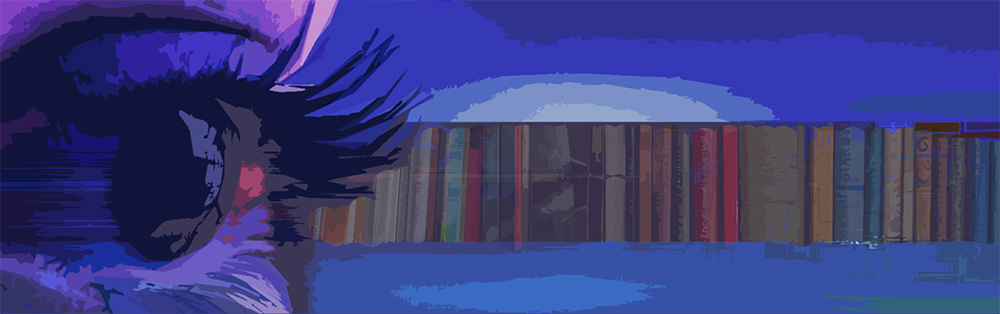
Imaginons l'empereur Kublai Khan dans un des jardins de son palais. Il prend le frais à la tombée du jour accompagné d'un homme, un explorateur, Marco Polo. Ce dernier lui décrit les villes qu'il a pu voir lors de ses nombreux voyages. Les deux hommes conversent dans un endroit hors du temps, un ailleurs dont la réalité est encore à prouver.
Cette histoire n'est plus à imaginer, elle existe déjà, Italo Calvino nous la raconte dans son roman Les Villes invisibles. Mais ce livre est-il simplement une suite de descriptions de villes ?
Calvino y intègre déjà des commentaires, ceux de deux hommes, appartenant à deux mondes bien différents. C'est dans les dialogues entre Khan et Polo que le lecteur peut entrevoir un autre devenir à ce roman, un travail de réflexion entamé sûrement dans d'autres œuvres de l'auteur et qui pourrait être l'origine des recherches qui vont suivre.
Qui est Marco Polo dans ce roman ?
Il est décrit comme un explorateur, un marchand ou bien encore un voyageur mais il n'est pas que cela. C'est un conteur, il raconte des histoires. Il est donc à la fois rapporteur de faits et héros d'aventures diverses.
Dans le contexte de la recherche qui va nous occuper, nous pourrions choisir d'autres mots pour le décrire : celui qui raconte est un auteur, c'est lui qui élabore les histoires et qui décide de la façon dont elles se terminent ; mais celui qui voyage, est aussi un lecteur, il avance sans jamais s'arrêter et conserve des souvenirs de ce qu'il a pu voir.
Si Marco Polo est à la fois auteur et lecteur, est-il réellement en train de parler de villes inconnues ?
« Parfois, il me suffit d'une échappée qui s'ouvre au beau milieu d'un paysage incongru, de l'apparition de lumières dans la brume, de la conversation de deux passants qui se rencontrent dans la foule, pour penser qu'en partant de là, je pourrais assembler pièce à pièce la ville parfaite, composée de fragments jusqu'ici mélangés au reste, d'instants séparés par des intervalles, de signes que l'un fait et dont on ne sait pas qui les reçoit. Si je te dis que la ville à laquelle tend mon voyage est discontinue dans l'espace et le temps, plus ou moins marquée ici ou là, tu ne dois pas en conclure qu'on doive cesser de la chercher. Peut-être tandis que nous parlons est-elle en train de naître éparse sur les confins de ton empire ; (…)[1] ». N'est-ce pas là une description du travail de création ? Assembler des éléments « pièce à pièce », issus de rencontres ou d'apparitions afin de donner naissance à un objet qui traverse le temps et dont l'origine est difficile à déterminer. Marco Polo cherche l’œuvre parfaite comme chaque auteur lorsqu'il crée une nouvelle histoire et comme chaque lecteur, lorsqu'il ouvre les premières pages d'un livre.
Les Villes invisibles nous parle donc de littérature. Ce roman évoque le langage, Kublai Khan étant capable de comprendre ce que ses envoyés racontent dans « des langues incompréhensibles (…) qu'ils avaient entendu dans d'autres langues à eux-mêmes incompréhensibles. ».
Calvino évoque l'idée qu'un voyage peut se faire en restant immobile, que l'imagination remet en cause la réalité mais surtout, il met en scène Khan et Polo en train de développer leur propre vision d'une ville modèle (ou d'un livre modèle ?). Pour l'un, cette ville est faite de tous les éléments qui répondent à la norme et pour l'autre de toutes les exceptions à cette même norme. L'empereur a souvent l'impression que les villes décrites par son envoyé se ressemblent, l'explication du marchand vénitien est très claire : « Les villes aussi se croient l’œuvre de l'esprit ou du hasard, mais ni l'un ni l'autre ne suffisent pour faire tenir debout les murs. Tu ne jouis pas d'une ville à cause de ses sept ou soixante-dix-sept merveilles, mais de la réponse qu'elle apporte à l'une de tes questions. »
Ce roman a-t-il répondu à une question que se posait Italo Calvino ? Une question qui concerne les livres et leurs origines. L'auteur italien a peut-être lui aussi envisagé que les fictions naissaient d'éléments divers déjà existants quelque part et glanés ici ou ailleurs par les écrivains d'hier et de demain. C'est cette même question que l'on va envisager ici en utilisant d'autres œuvres et d'autres auteurs. Calvino sera toujours là, en train de lire par-dessus notre épaule comme les deux protagonistes de son roman, qui observent l'empire depuis un lieu atemporel et incertain.
C'est un voyage à travers trois siècles que nous nous préparons à débuter. L'itinéraire ne sera pas linéaire, d'un point A à un point B, il sera fait de va-et-vient entre les temps. La chronologie n'aura aucune prise sur notre recherche. Les années vont s'assembler, deux par deux, grâce à une création commune : une fiction qui se dédouble, un livre écrit deux fois, par deux auteurs différents, à deux instants éloignés l'un de l'autre par des décennies. Une fois cette barrière du temps balayée, que reste-t-il ? Les livres, ceux qui les écrivent, les auteurs, et ceux qui les lisent, les lecteurs. C'est donc à travers eux, leur subjectivité et leur inconscient que nous commencerons par l'explication la plus logique, celle de l'influence des écrits du passé sur ceux du futur. Puis, nous ferons volte-face, nous cheminerons à contre-courant pour arriver à la question inévitable, le passé peut-il anticiper le futur ? Ou, comme vont le montrer les œuvres qui vont suivre, une fiction du passé peut-elle rêver une fiction à venir ?
« Est-ce que tu avances toujours avec la tête tournée en arrière?[2] »
Les années 1890 et 1956 forment la première étape de notre voyage. Elles se retrouvent réunies par deux œuvres emblématiques de leurs auteurs. La première, si l'on suit l'ordre chronologique, est le roman d'Oscar Wilde le plus connu, Le Portrait de Dorian Gray. La seconde est la nouvelle intitulée Rapport Minoritaire écrite par Philip K. Dick. Ce texte a été adapté en 2002 par le réalisateur Steven Spielberg sous le titre Minority Report. Cette adaptation a son importance dans la lecture du texte original. Loin d'être fidèle, elle apporte un élément supplémentaire à l’œuvre de Philip K. Dick et à ses liens avec celle de Wilde. Commençons donc par observer l'année 1890...
Assis devant une feuille blanche, Oscar Wilde écrit des mots que ceux de Philip K. Dick traversent de temps en temps. Dans son esprit résonne la voix d'un autre, une voix qu'il n'entendra jamais plus. Phénomène de transmigration ? De métempsycose ? Peu importe. Aujourd'hui, il a décidé d'écouter cette voix, de s'en servir parfois, de la considérer toujours. Son roman, il l'a déjà en tête, il sait ce qu'il va dire, ce qu'il va écrire. Pourquoi cet autre l'influence-t-il ? Qu'est-il en train d'entrevoir ? On lui décrit des êtres monstrueux, surnaturels. Ils sont difformes, des légumes qui ne peuvent même pas parler. Ils pensent, ils entrevoient, c'est tout ce qu'ils sont capables de faire. Ces monstres, ces singes, voient ce qui n'est pas encore arrivé. Ils voient l'avenir, ce sont des prophètes. Des hommes comme Lord Henry s'en servent, ils sont leur création. Son héros, « merveilleusement beau, avec ses lèvres vermeilles et finement arquées, ses yeux bleus si francs, sa chevelure aux boucles dorées », il ne le laissera pas devenir un monstre lui aussi. Dorian Gray restera à jamais cet adolescent qui les fascine tous. L'avenir sera toujours présent, mais il sera en deux dimensions. Il se jouera à plat sur une toile comme une projection sur un écran, une vision annoncée et inévitable.
La voix recommence à se manifester. Elle lui dépeint une société sans vice, sans péché. Un monde où l'on arrête les gens avant qu'ils ne deviennent des criminels, où l' « on a peur de soi-même. » Lord Henry a déjà pressenti cela aussi, « La coutume sauvage de la mutilation a son prolongement tragique dans ce renoncement personnel qui désenchante notre vie. Nous portons la peine de nos résistances. Tout désir que nous cherchons à étouffer, couve en notre esprit et nous empoisonne. Que le corps pèche une bonne fois et c'en est fait de son péché, car l'action a une vertu purificatrice. Il n'en reste rien, que le souvenir d'un plaisir ou la volupté d'un regret. » Tout est question d'influence et de paradoxe ici. Un homme a accès à une vision de son avenir, mais cette vision n'est qu'une version possible des faits, ce n'est pas la réalité. « Le chemin des paradoxes est le chemin du vrai. Pour éprouver la Réalité, il faut la voir sur la corde raide. On ne juge bien des Vérités que lorsqu'elles se font acrobates. » Celui dont parle la voix est un meurtrier ou pas encore un meurtrier. Les monstres lui disent qu'il en sera un, mais du moment où il sait, rien ne peut plus se passer comme prévu, « Parce qu'influencer quelqu'un, c'est lui donner son âme. Quiconque est influencé n'agite plus ses propres pensées, ne brûle plus de ses propres passions. Ses vertus ne lui appartiennent pas vraiment. Ses péchés – s'il exista jamais rien de tel – sont pareillement d'emprunt. Il devient l'écho d'une musique étrangère, il joue un rôle composé par un autre. »
Wilde entend un nom que l'autre murmure, « Kaplan », est-ce lui qui tire les ficelles ? Il invite le héros à monter sur une estrade « Pour que tout le monde voie la preuve vivante de ce que j'avance. Le meurtrier et sa victime. Debout, côte à côte, dévoilant toute la sinistre et terrible supercherie entretenue par la police. »
La police ? Pourquoi cela lui fait-il peur ? Il pressent autre chose, mais il ne sait pas quoi. La voix prend toute la place dans son esprit. Il faut qu'il écrive. Dorian Gray monte sur une estrade, il doit poser pour son portrait. Première confrontation du meurtrier et de sa victime. Un face à face qui se répétera sans cesse dans son roman, jusqu'au dénouement tragique. Oui, il sait comment ça va se terminer, l'autre le sait aussi. « Effacer le passé, on le pouvait toujours : c'est une affaire de regret, de désaveu, d'oubli. Mais on n'évitait pas l'avenir. »
L'ultime rencontre entre un héros et son futur ne doit laisser qu'un seul survivant. « Il saisit la lame et transperça le portrait. / Kaplan poussa un unique cri aigu – un cri de terreur. / (…) un homme en habit de soirée gisait, un couteau dans le cœur. / Sa maigre poitrine n'était plus qu'un trou fumant dont des cendres s'échappaient au gré des tressaillements du corps. / Son visage était flétri, ridé, repoussant. »[3] .
La voix ne dit plus rien, elle n'existe plus. Est-ce lui qui l'a créée ? Ou bien, venait-elle d'un ailleurs encore inconnu de tous ? Oscar Wilde a terminé son roman, il a l'impression qu'il manque maintenant quelque chose sur sa table de travail, mais quoi ?
Cet écho de l'avenir, Philip K. Dick n'en aura jamais conscience, en tout cas pas de cette façon. Le passé ne lui parlera pas, il ne lui viendra pas en aide. L'influence n'existe que dans un sens et ce n'est pas celui attendu. Il s'agit de considérer un élément qui semble nécessaire à l'existence d'un texte : son auteur.
C'est la rencontre entre deux écrivains qui a lieu dans ce rapprochement, deux hommes qui semblent créer simultanément la même œuvre dans deux temps différents, qui se déroulent avec 66 années d'écart. L'un connaît l'existence de l'autre, il peut donc avoir lu son œuvre. Mais l'influence mise en avant ici est tout autre, c'est celui qui ne peut pas connaître l'autre, parce qu'il est né bien avant lui, qui s'en inspire. C'est Wilde qui réécrit Dick, c'est Le Portrait de Dorian Gray qui recouvre Rapport Minoritaire. C'est donc la responsabilité de l'auteur que nous allons questionner, le rôle qu'il joue lorsqu'il écrit et sur ce qu'il écrit en abordant la notion de plagiat. Ces développements nous amèneront à nous interroger ensuite sur la place de l'auteur dans le travail d'écriture ainsi que son importance réelle (ou non) dans le processus de création littéraire.
Afin de comprendre quels liens unissent ces deux œuvres tellement différentes mais finalement semblables, il faut se tourner vers la réponse la plus évidente, l'un a plagié l'autre. Mais lequel d'entre eux ? Voilà où nous en sommes, en train d'enquêter pour savoir qui a enfreint la loi, qui a commis l'irréparable.
Il serait facile d'expliquer la connexion entre ces deux auteurs en avançant l'idée que Philip K. Dick, ayant forcément lu le célèbre roman d'Oscar Wilde l'a tout simplement plagié. Volontairement ou non, il offre, dans sa nouvelle, une version moderne du personnage de Dorian Gray et dépeint une société proche de celle évoquée dans le roman du XIXème siècle. On y retrouve la confrontation entre un personnage et ses démons, transformant un homme bon en un meurtrier de sang froid dans un monde où le péché n'a pas sa place.
Dans son essai Voleurs de mots, Michel Schneider offre une image parfaitement appropriée au rapprochement des œuvres de Philip K. Dick et d'Oscar Wilde : « On approche ici de l'insistance moderne sur la notion de texte comme tissu, écran de réminiscences, un texte ne donnant jamais accès à la chose écrite pour la première fois. Il est, comme le souvenir-écran, souvenir d'un écran. Texte se souvenant d'un texte antérieur. » Rapport Minoritaire serait donc le second degré du roman Le Portrait de Dorian Gray, le souvenir qui s'affiche sur un écran, comme le fait l'avenir dans l'adaptation cinématographique qu'a réalisée Steven Spielberg de l’œuvre de Philip K. Dick. L'explication est simple, rationnelle, elle ferait facilement basculer le procès, mais elle omet un élément très important, l'ordre temporel. La parole est à la défense !
Pour envisager différemment la relation entre ces deux œuvres, nous devons faire appel à un essai de Pierre Bayard intitulé Le Plagiat par anticipation. Dans ce livre, l'auteur explore la notion de plagiat sous toutes ses formes et notamment celle du plagiat par anticipation, terme inventé par les membres de l'Oulipo. Il envisage l'existence d'une influence à rebours du temps entre les auteurs qui mènerait à une écriture s'inspirant de ce qui n'existe pas encore.
Sur la toile du tableau de Dorian Gray, Wilde décrit la vie du héros de Dick en train de se jouer. Mais peut-on qualifier ce dont nous parlons de plagiat par anticipation ? Pierre Bayard définit un autre critère afin de différencier un plagiat par anticipation d'un plagiat classique, la dissonance qu'il explique par l'isolement d'un texte dans l’œuvre complète de son auteur.La dissonance permet ainsi de définir un texte majeur et un texte mineur, le texte mineur étant évidemment antérieur à l'autre pour pouvoir parler de plagiat par anticipation. Les textes qui nous intéressent ici trouvent pleinement leur place dans le travail de leurs auteurs. Ils poursuivent les interrogations présentes dans d'autres textes, ils ne sont pas dissonants. L'explication du plagiat par anticipation n'est donc pas suffisante pour comprendre ce qui réunit nos deux textes car « tout se passe, (…) comme si les auteurs – ou les groupes d'auteurs – séparés par la barrière illusoire du temps, avaient trouvé le moyen de travailler ensemble. ».
Ici, c'est de nouveau Pierre Bayard qui tente de définir un autre lien unissant les textes celui du plagiat réciproque. Une influence qui s'affranchit de la notion de temps et qui révèle une réelle communication simultanée entre les auteurs, un travail à deux, trois ou même quatre mains. Cette constatation repose, selon nous, sur un élément important, le langage.
Dans l'essai Voleurs de mots, Michel Schneider envisage qu'un auteur écrit (ou réécrit) les livres qu'il a lu. De manière inconsciente un artiste reproduit ce qu'il a déjà vu, entendu, ce qui est déjà en lui. Afin de comprendre cette vision de l'écriture, il faut trouver le dénominateur commun à toutes les œuvres écrites à ce jour, et qui rend possible ce phénomène, le langage. Nous puisons tous dans le langage la base de nos réflexions, de nos pensées ou de nos écrits. Il est donc logique qu'en utilisant les mêmes mots et les mêmes agencements de mots, les idées se confrontent et parfois se ressemblent. Le langage est le moyen de communication entre les auteurs et « il est difficile de ne pas supposer que leurs échanges, même effectués à bas bruit, produisent de part et d'autres des effets sur leurs textes.[4] ».
Le plagiat réciproque apporte donc une bonne explication aux liens entre Oscar Wilde et Philip K. Dick, c'est d'ailleurs ce que nous avons essayé de mettre en scène au début de cette partie, et ce que développe Clément Rosset dans son essai Le Philosophe et les sortilèges lorsqu'il convoque la pensée de Lacan : « (…) le langage, selon Lacan, n'a de sens que s'il est vivifié par une parole venue d'ailleurs : les propos de ce monde-ci ne deviennent audibles que sous la garantie de propos venus d'outre-monde. ».
Les auteurs ont donc besoin de la voix d'un autre, ils doivent convoquer une autre partie d'eux-mêmes pour que leurs propos puissent exister. Une œuvre se fait donc toujours à deux, l'un qui écrit et l'autre qui chuchote à son oreille. Si l'influence est réciproque, Wilde a d'abord écrit en écoutant Dick puis ils ont échangé leur place, après plus d'un demi-siècle. Un prêté pour un rendu... À charge de revanche...
Alors que peut-on conclure de tout cela ? Le plagiat, voilà tout ce qui se trouve entre ces deux œuvres littéraires ? L'enquête était aussi facile à résoudre que cela ? Tous coupables ! Ou plutôt personne. Les deux parties se serrent la main et se quittent bons amis. Mais se quittent-ils vraiment ? La porte du tribunal reste fermée, le procès n'est pas encore terminé. Oscar Wilde et Philip K. Dick sont toujours là, l'issue du procès ne leur convient pas, il y a sûrement autre chose.
L'audience reprend donc là où elle s'est arrêtée. Deux hommes, deux auteurs face à une incertitude : qui, du passé ou du futur, a agi sur l'autre ? Pour apporter un élément de réponse, un homme se présente spontanément à la barre, c'est un auteur et lui aussi se laisse parfois influencer par le temps. Cet homme, c'est Jorge Luis Borges. L'auteur argentin s'est souvent mis en scène dans ses écrits en train de converser avec une autre version de lui-même, plus jeune ou plus ancienne. Son œuvre revendique ses influences, les textes dans lesquels il a puisé l'inspiration ou encore les auteurs avec qui il échange en faisant abstraction lui aussi du temps chronologique.
Dans un de ses textes intitulé Kafka et ses précurseurs, il rédige une liste non exhaustive des auteurs qui, selon lui, ont annoncé les romans de Franz Kafka. Il ne revendique absolument pas une influence du passé sur le futur, pour lui Kafka ne s'est pas servi des auteurs antérieurs à lui pour construire son écriture bien au contraire. Il est le révélateur, celui qui fait émerger ces écrivains, qui les lie les uns aux autres pour en faire ses précurseurs.
Par le simple fait d'exister, les auteurs sont donc capables de réécrire le passé littéraire, de redistribuer les cartes et de réorganiser un ordre établi depuis des siècles. La chronologie n'a définitivement plus d'influence sur les auteurs qui sont assaillis de toute part par des voix venues de tous les temps.
« Si l'écriture se fait bien en compagnie de certains fantômes, il conviendrait donc d'ajouter, aux revenants que sont les écrivains passés qui nous influencent, une autre catégorie de fantômes, que je propose d'appeler des survenants, lesquels sont convoqués par l'écriture et viennent fournir à l'écrivain – par ce surgissement que tout à la fois il espère et produit – les images inconscientes bienfaisantes de modèles à imiter.[5] »
Mais si tout est déjà sous-jacent, si l'écriture des uns est dissimulée dans celle des autres, les auteurs ont-ils réellement un rôle à jouer ? Ne sont-ils pas plutôt simples porteurs d'une parole qui les dépasse et dont ils sont le vecteur ? Si l'on suit cette idée jusqu'au bout, on pourrait donc conclure que si Kafka n'avait pas écrit ses chefs-d’œuvre, quelqu'un d'autre l'aurait fait à sa place. Un autre individu qui aurait capté d'une certaine façon cette parole qu'il ne restait plus qu'à révéler. Pierre Bayard évoque cette idée dans son livre Le Plagiat par anticipation, il parle d'idées « possédantes » et non « possédées » en affirmant que « (…) nos idées ne nous appartiennent pas. Elles ont parfois été pensées par d'autres, elles sont parfois, en même temps que chez nous, en cours de penser chez nos contemporains, nous pouvons également nous les faire subtiliser. ».
Le questionnement ne se situe donc pas entre deux auteurs mais entre deux textes. Paul Valéry a démontré ce principe de la mise à l'écart de l'auteur dans la notion qu'il a appelé poétique. Cette notion laisse une grande place au hasard, permettant ainsi d'envisager que les textes acquièrent un fonctionnement organique et formel. Dans le rapprochement qui nous occupe, l'explication pourrait se trouver dans la poétique. En effet, la connexion qui unit ces deux textes pourrait être le fruit du hasard, une coïncidence, entre deux écrits qui puisent dans le même langage, dans les mêmes idées. Wilde ou Dick, finalement peu importe, il ne reste que les récits qui se croisent et s'interpénètrent.
Dans le tribunal, c'est le silence qui règne maintenant. Nous avions un procès qui était en train de se dérouler devant nos yeux, un procès qui opposait deux individus mais voilà que le verdict se passe d'eux. En réalité, cela ne les concernait pas, ils n'étaient que des intermédiaires. Pas de plagiat ni d'influence réciproque, les accusés et les chefs d'accusation étaient erronés. Mais alors, qui devrait se présenter à la barre ? Qui doit être désigné coupable dans cette affaire bien plus complexe qu'il n'y paraît ? Si l'auteur n'est pas à l'origine de ces connexions atemporelles entre les textes, il ne reste qu'une seule personne à accuser, une personne qui pourrait en être une autre ou même toutes les autres, le lecteur.
« Ton voyage se déroule t-il seulement dans le passé ?[6] »
La seconde étape de notre recherche consiste donc en un retournement. Nous observions l'auteur pour chercher sa faille alors qu'il fallait regarder ailleurs, en chacun de nous. Car nous sommes tous des lecteurs, et, en tournant des pages recouvertes de mots, nous effectuons à notre façon un voyage vers un ailleurs difficile à situer dans le temps. Parmi nos multiples errances à travers les livres, l'année 1940 nous a réservé une surprise, elle nous donne à lire ces mots :
« Hier soir, j'ai fait ce rêve :
J'étais dans un asile d'aliénés. Après une longue consultation (le procès ?) avec un médecin, ma famille m'avait conduit là. Le directeur était Morel. Par moments, je savais que j'étais dans l'île ; par moments, je croyais être dans l'asile ; par moments, j'étais le directeur de l'asile.
Je ne crois pas nécessaire de prendre un songe pour la réalité, ni la réalité pour de la folie. »
Ce rêve, c'est le naufragé anonyme du roman L'Invention de Morel d'Adolfo Bioy Casares qui le raconte. Mais ce rêve est-il un songe, la réalité ou bien la folie ?
Si l'on reste en 1940, il n'est qu'un songe, si l'on connaît le futur, il devient réalité et si un lecteur s'en empare, il n'a plus qu'à être folie. Si nous pouvons affirmer de telles choses, c'est parce que nous avons vécu le futur de cette histoire. Pas seulement celui de ce naufragé, mais celui d'un autre homme de fiction, échoué lui aussi sur une île.
L'Invention de Morel a donné naissance à un autre roman, ou plutôt, c'est le rêve du naufragé qui est à l'origine de cette apparition. Près de 63 ans après ces mots, d'autres lui font écho. Dans son roman Shutter Island écrit en 2003, Dennis Lehane raconte l'histoire d'un marshall, Teddy Daniels qui se rend sur une île qui abrite une prison pour patients dangereux afin d'enquêter sur la disparition d'une criminelle. Très vite, la frontière entre réalité et rêve va être compromise et l'issue de l'histoire nous fait comprendre que Daniels est en fait un patient de l'île qui vit en boucle le même délire qu'il croit (tout comme nous, lecteur) être la réalité.
À l'image du lien entre Oscar Wilde et Philip K. Dick, les deux œuvres, ci-dessus, ainsi que l'adaptation cinématographique très fidèle du roman de Lehane par Martin Scorcese en 2010, nous remettent face à un paradoxe. En effet, Dennis Lehane cite en exergue de son roman, les livres qui l'ont aidé à rédiger Shutter Island et,il ne parle pas de L'Invention de Morel. 2003 n'a donc pas pu utiliser 1940 comme source d'inspiration. Ni hommage ni emprunt, simplement une connexion qui se fait une fois de plus à rebours du temps. Mais, cette connexion ne se fait pas entre deux individus, deux auteurs qui citent les mêmes mots, ce sont les deux histoires qui se chevauchent littéralement.
Tout commence donc par un voyage ou le rêve d'un voyage peut-être. Un homme se retrouve face à lui-même, sa propre image, ses propres limites. Le premier glissement est là. Nul ne sait si l'homme est arrivé à destination. Son corps s'est peut-être échoué sur la plage offrant aux mouettes son cerveau béant. On déambule dans un rêve ou dans l'hallucination d'un esprit dévoré par des animaux. On ne peut être sur de rien et pourtant l'île est bien là. Sauvage et dangereuse, elle est le théâtre d'un mystère que personne ne veut résoudre. Ses habitants sont à son image, fantomatiques, inquiétants et fugaces. Au début, l'homme se cache et puis peu à peu il tente de les dompter parvenant même à les côtoyer. Mais ils restent de marbre face à toutes ses tentatives, il est un spectre parmi les fantômes. Il souffre, un peu plus chaque jour. Son mal est difficile à définir, il ignore qui de son corps ou de son esprit cédera le premier. Il s'enfonce inlassablement dans la projection d'une réalité indéfinie qu'il est le seul à vivre. Il glisse, inlassablement. La nature le tuera, il ne voit plus que cela. Les vents, l'eau ou la végétation, cette île sauvage aura raison de lui. Et puis, il y a la lueur d'espoir, ce morceau de tissu coloré au milieu de la nuit. Ce souvenir de celle qu'il aime lui donne envie de se battre. Il ira contre le vent et contre eux, tous ceux qui veulent le voir tomber, il les poussera hors de son chemin. Il sait comment faire, il a trouvé la clé du mystère. Il ne lui reste plus qu'à trouver un plan.
La vérité se trouve à un seul et même endroit, un lieu circulaire et clos, dans lequel personne ne peut pénétrer à part lui. Un lieu où tout est déjà écrit, un lieu où tout se répète, son propre esprit. Son esprit... Il ne s'était même pas rendu compte qu'il vivait une illusion. Les habitants de l'île, les rôles qu'ils endossaient, tout cela était une invention, une projection issue de sa folie. Mais alors... La femme qu'il aime ? Est-elle aussi une illusion ?
Non, c'est impossible, il l'a vu trop de fois, il la voit encore. Elle est bien réelle, c'est elle qui doit le sauver de sa solitude, le sauver de lui-même. Il la cherche, l'aperçoit mais elle disparaît à nouveau. Et il finit par accepter. Accepter l'illusion, accepter sa situation. Rien ni personne ne le sauvera. Il doit faire un choix pour sortir de cette réalité. Ce choix, il parvient à le définir : être un monstre ou juste un homme. Il sera un homme car il refuse de voir la vérité en face, il n'accepte pas ce qu'il est. Il sera un homme même si c'est accepter l'illusion et y participer. Il sera un homme même si cela le conduit à la fin. Il sera donc un homme mort parmi les morts.
Ce voyage entre ces deux textes, les auteurs ne le réaliseront jamais. Il n'est accessible qu'à une seule personne, le lecteur, celui qui, l'un après l'autre ou bien simultanément, a tenu les livres entre ses mains.
Dans son essai Lector in fabula, Umberto Eco développe l'idée d'un Lecteur Modèle, un individu pour lequel un livre serait écrit, capable de comprendre tout ce que l'auteur avait prévu même si, comme il le dit lui-même : « on n'espère pas (ou ne veut pas) que ce quelqu'un existe concrètement ou empiriquement. ».
L'auteur doit alors accepter de laisser ses mots être lus et actualisés par un autre. Le lecteur est donc comme un voyageur qui détient une carte qui lui présente son itinéraire, à lui de prendre les chemins de traverse s'il le souhaite. Mais quels autres outils sont fournis à ce lecteur-voyageur, pour survivre dans son errance ? Nous questionnerons d'abord la subjectivité du lecteur et comment elle le transforme en explorateur de la littérature puis, nous évoquerons le principe d'une littérature atemporelle dans laquelle le lecteur met à mal la chronologie préétablie menant à l'idée que chaque lecture d'un texte définie un temps unique dans l'existence de celui-ci.
« générer un texte signifie mettre en œuvre une stratégie dont font partie les prévisions des mouvements de l'autre – comme dans toute stratégie. », voilà comment Umberto Eco envisage le lien qui peut unir auteur et lecteur. Mais cette relation ne tient-elle que dans un rapport de force ? Un décideur et un suiveur ? N'est-ce pas minimiser le rôle du lecteur que de le réduire à un simple individu tout juste bon à suivre le chemin tracé pour lui ?
Le lecteur est l'ultime maillon de la chaîne que représente la création littéraire. Il est le seul à pouvoir faire vivre (ou survivre) un texte abouti. Les textes de fictions sont l'environnement dans lequel évolue celui qui lit mais ils sont également tributaires de ce voyageur étranger et curieux. Lorsqu'une personne s'empare d'un livre, elle l'ajoute à sa propre liste des autres œuvres déjà possédées. Pour donner une image familière à cet acte, le lecteur range ce nouveau livre dans sa bibliothèque ou bien au milieu d'une pile d'autres livres. Il lui trouve une place arbitraire mais sûrement pas aléatoire dans son univers littéraire.
Au-delà, de cette représentation physique de l'appropriation d'une œuvre, il ne faut pas oublier l'aspect profondément créateur de la lecture. Toujours dans son essai Le Plagiat par anticipation, Pierre Bayard développe une notion importante dans la définition de la place du lecteur, celle d'illusion créatrice. Il affirme que « toute lecture produit de la similitude » et qu'un livre n'est pas un élément fixe qui se ferme aux inconscients de chacun au contraire, une fiction s'associe forcément à d'autres à partir du moment où elle passe par le prisme d'une lecture extérieure à celle de l'auteur. La notion qu'il faut questionner est celle de la subjectivité. Car dans le cas de l'illusion créatrice c'est la seule intime conviction du lecteur qui crée la connexion rétrospective entre les œuvres. Et cette conviction, celui qui lit ne peut se la forger que grâce à tout ce qu'il a lu avant et peut-être même, grâce à ce qu'il projette de lire après.
L'historien de l'art et initiateur de l'iconologie Aby Warburg, donne un parfait exemple de la subjectivité du lecteur dans son « principe du bon voisin ». Warburg a toujours été fasciné par les bibliothèques. Lorsqu'il arrive en France pour effectuer ses études d'histoire de l'art, il est vite marqué par l'organisation différentes qu'il peut trouver dans les rayonnages. Il aime la simple idée qu'il suffît de pousser une porte pour entrer dans un univers littéraire et théorique différent. La notion de « bon voisin » s'applique à la construction d'une bibliothèque qu'il a mise en place au tout début du XXème siècle, elle se résume en une phrase : « Quand vous allez prendre un livre dans les rayons, celui dont vous avez réellement besoin n’est pas celui-là, mais son voisin. », d'où l'importance du classement subjectif que le lecteur effectue dans sa bibliothèque ou bien dans les souvenirs qu'il conserve de ses lectures passées.
C'est en cela que le lecteur est un voyageur, pour atteindre son but, il passe par plusieurs étapes, plusieurs textes qui le mènent parfois vers ce qu'il n'avait pas du tout imaginé. Les livres deviennent des portes qui s'ouvrent sur d'autres, permettant au lecteur d'emprunter différents itinéraires tout en laissant accessibles une multitude d'interprétations.
Le lien qui unit les textes d'Adolfo Bioy Casares et de Dennis Lehane est une illustration parfaite de cette vision du voyage littéraire. Ils reposent tous les deux sur un questionnement de la réalité du personnage principal et ils se connectent via un rêve qui va traverser les deux fictions. D'ailleurs un rêve n'est-il pas une sorte de voyage ?
Il n'est donc même plus question du rôle que pourraient jouer les auteurs dans les rapprochements effectués ici car comme l'explique Maurice Blanchot dans son essai L'Espace littéraire, « Il (l'auteur) sent en lui, vivante et exigeante, la part du lecteur encore à naître et, bien souvent, par une usurpation à laquelle il n'échappe guère, c'est le lecteur, prématurément et faussement engendré, qui se met à écrire en lui (…) ».
Le lecteur devient donc subitement le seul responsable de ces connexions à rebours du temps puisqu'il prend le pouvoir avant même que l'auteur se soit séparé de son texte.
C'est à cette conclusion qu'arrive Blanchot lorsqu'il pose la question : « Qu'est-ce qu'un livre qu'on ne lit pas ? », ce à quoi il répond : « Quelque chose qui n'est pas encore écrit. Lire serait donc, non pas écrire à nouveau le livre, mais faire que le livre s'écrive ou soit écrit, – cette fois sans l'intermédiaire de l'écrivain, sans personne qui l'écrive. ».
Les textes deviennent ainsi parfaitement autonomes à partir de l'instant où une voix (silencieuse le plus souvent) leur donne la vie.
Si le lecteur l'emporte sur l'auteur, l'anticipation peut donc être une clé qui pourrait nous permettre de comprendre comment une fiction du passé peut rêver une fiction du futur.
Lorsque l'on parle d'anticipation, il faut forcément convoquer l'idée de temps. C'est d'ailleurs de cela que nous parlons depuis le début, du temps, ou plutôt, des temps qui se suivent, se précèdent ou se chevauchent.
En 1937, Paul Valéry mène plusieurs conférences au Collège de France afin d'enseigner la poétique. Il propose une redéfinition complète de l'Histoire de la Littérature qui « devrait donc être comprise, non tant comme une histoire des auteurs et des accidents de leur carrière ou de celle de leurs ouvrages, que comme une Histoire de l’esprit en tant qu’il produit ou consomme de la « littérature », et cette histoire pourrait même se faire sans que le nom d’un écrivain y fut prononcé. ».
Si l'on abandonne complètement l'idée que l'auteur est responsable des questions qui nous occupent, c'est tout un pan de l'histoire littéraire que l'on met de côté. Il ne faut pas lire les livres avec en tête leur contexte de création ni même considérer la biographie de ceux qui les ont écrit, mais les lire au regard les uns des autres en faisant abstraction de la chronologie qui les unit initialement. Il ne reste plus qu'à abandonner le principe de rangement de certaines bibliothèques qui se basent sur les siècles de création des œuvres au profit d'un classement beaucoup plus subjectif à l'image de celui qu'à initié Warburg à Hambourg en 1933.
Mais cette atemporalité ou bien cette chronologie redistribuée, pose également une autre question, celle de l'aspect profondément changeant, mouvant de la littérature. Car si chaque lecture nous apporte un nouvel éclairage sur les œuvres de notre passé (de lecteur), alors notre propre vision globale de notre univers littéraire peut à tout moment changer de visage, et c'est en cela que le lecteur est et sera toujours un voyageur hors du temps ou bien qui évolue dans un monde où le temps n'a aucune prise sur les choses. Et c'est là que nous trouvons une réponse possible à notre interrogation de départ : une fiction du passé peut rêver une fiction du futur car « Dans l'absence de temps, ce qui est nouveau ne renouvelle rien ; ce qui est présent est inactuel ; ce qui est présent ne présente rien, se représente, appartient d'ores et déjà et de tout temps au retour.[7] ». Et si l'on veut pousser davantage la réflexion et l'anticipation de notre futur littéraire on peut même imaginer que la relecture d'un texte à une époque donnée de notre vie, entre tel et tel livre, nous apparaisse totalement différente du souvenir que l'on en avait gardé.
Si aujourd'hui, nous plaçons dans notre bibliothèque mentale, Shutter Island et L'Invention de Morel côte à côte, hier, le roman d'Adolfo Bioy Casares pouvait très bien trôner fièrement entre Le Magicien d'Oz de Frank Lyman Baum et La Machine à explorer le temps d'H. G. Wells.
Les œuvres littéraires seraient-elles « à tiroirs », à l'image de l’œuvre de Salvador Dali, La Vénus de Milo aux tiroirs ?
Elles donneraient donc à voir, à lire, une facette chaque fois différente d'elles-mêmes, une interprétation qui serait guidée par ce qui les a précédées. Il existe donc un temps pour chaque lecture, un moment vers lequel tend chacun des voyages d'un lecteur pour accéder à cet instant unique et parfois inaccessible si toutes les conditions ne sont pas réunies.
« La lecture n'est pas une conversation, elle ne discute pas, elle n'interroge pas. (…) Mais le livre qui a son origine dans l'art, n'a pas sa garantie dans le monde, et lorsqu'il est lu, il n'a encore jamais été lu, ne parvenant à sa présence d’œuvre dans l'espace ouvert par cette lecture unique, chaque fois la première et chaque fois la seule. », l'idée d'une lecture unique revient plusieurs fois dans L'Espace littéraire. Maurice Blanchot rapproche ce constat du « sentiment que les œuvres échappent au temps », et c'est sûrement ce sentiment qui pousse le lecteur-voyageur a toujours être sur la route, à continuer ses déambulations parmi les textes espérant à chaque fois retomber sur un territoire familier dans lequel il resterait encore des endroits à découvrir.
Sommes-nous toujours dans la salle d'audience ? Si oui, elle doit être bien vide à l'heure qu'il est. Toute l'assemblée l'a désertée c'est évident. Ils ont vu la tournure du procès et ils ont tous eu peur d'être accusés, oui, eux qui n'étaient venus là que par curiosité. Même les auteurs sont partis sur la pointe des pieds car, eux aussi ont été et sont toujours, des lecteurs. Plus personne n'est là pour reporter la séance, le tribunal disparaît, il s'est évaporé en même temps que les certitudes des uns et des autres. La parole est à qui veut bien la prendre...
On dirait que quelqu'un était finalement resté dans les parages. Un homme se présente donc à la barre, lui seul à le pouvoir de faire revenir tous les autres. Car il sait parler aux lecteurs, il l'a déjà fait, en 1979 dans son roman, Si par une nuit d'hiver un voyageur. Cet homme, c'est lui qui a ouvert ces réflexions, qui les a introduites, c'est Italo Calvino. Il a envie de raconter une histoire, une histoire qu'un autre a déjà raconté, une autre version de cette histoire.
Nous sommes en 1967 et Calvino est en train de rédiger sa nouvelle, Le Comte de Monte-Cristo. Il met en scène Edmond Dantès, emprisonné au château d'If, en train de réfléchir aux différents moyens de s'évader. Si Dantès est plutôt cérébral, un autre prisonnier l'abbé Faria qui poursuit le même but, s'obstine à creuser tous les murs de la forteresse pour trouver une issue. Mais ce que le héros décèle peu à peu, c'est que sa prison est un labyrinthe d'où on ne peut pas sortir, ou plutôt il commence à l'imaginer comme telle la rendant ainsi potentiellement réelle.
Difficile de voyager lorsque l'on est enfermé dans une prison, pourtant Edmond Dantès y parvient : « Mais si la forteresse grandit au rythme même du temps, pour fuir il faut aller encore plus vite, et remonter le temps. Le moment où je me retrouverais dehors serait celui-là même où je suis entré ici : je débouche pour finir sur la mer ; et qu'est-ce que je vois ? Une barque pleine de gendarmes, prête à toucher If ; au milieu, il y a Edmond Dantès couvert de chaînes.»
Peut-on faire meilleure analogie de la réflexion qui nous a occupée jusqu'ici ?
Voyager immobile, dans un lieu clos, voilà ce que fait un lecteur lorsqu'il ouvre un livre. Les personnages de Calvino nous représentent, ils ignorent si ce qu'ils voient est la réalité ou bien une projection de leur esprit.
Les œuvres d'Oscar Wilde, de Philip K. Dick, d'Adolfo Bioy Casares et de Dennis Lehanne présentes ici, peuvent toutes se relier entre elles de cette manière également. Elles posent la question de l'autonomie d'une œuvre, autonomie gagnée grâce aux lecteurs, à sa subjectivité et à sa capacité à s'affranchir du temps chronologique.
Nous n'affirmons pas qu'un lien réel existe entre elles, c'est la succession de nos lectures qui nous met face à ce constat. « remonter le temps », voilà ce que signifie parfois lire.
Nous sommes au terme de notre voyage, celui qui a commencé quelques pages plus haut. Mais le but n'est pas atteint car l'intérêt n'est pas de savoir ce qu'il y a au bout de ce voyage mais plutôt toutes les étapes auxquelles nous devrons accéder pour y parvenir. Ces étapes, nous les avons peut-être déjà franchies sans nous en rendre compte mais rien n'est perdu, un livre nous y ramènera forcément. Le passé doublera alors l'avenir qui fera ce qu'il peut pour le rattraper. C'est alors que nous retrouverons le chemin qu'il nous reste encore à parcourir.
Bibliographie
Pierre Bayard, Le Plagiat par anticipation, Lonrai, Les Éditions de Minuit, 2009, 154 p.
Adolfo Bioy Casares, L'Invention de Morel, Saint-Amand, 10/18, 2012, 116 p.
Maurice Blanchot, L'Espace littéraire, Saint-Amand, Folio Essais, 1996, 374 p.
Italo Calvino, Les Villes Invisibles, Barcelone, Gallimard, 2017, 198 p.
Italo Calvino, Cosmicomics, « Le comte de Monte-Cristo », Malesherbes, Gallimard, 2013, 523 p.
Philip Kindred Dick, Rapport Minoritaire / Souvenirs à vendre, Malesherbes, Folio Bilingue, 2017, 257 p.
Umberto Eco, Lector in Fabula, Paris, Grasset, 2016, 298 p.
Dennis Lehane, Shutter Island, Manchecourt, Rivages/noir, 2006, 393 p.
Michel Schneider, Voleurs de mots, Mesnil-Sur-L'Estrée, Gallimard, 2011, 390 p.
Clément Rosset, Le Philosophe et les sortilèges, Lonrai, Les Éditions de Minuit, 2014, 116 p.
Oscar Wilde, Le Portrait de Dorian Gray, Paris, Stock, 1974, 280 p.
Notes
[1] Italo Calvino, Les Villes Invisibles, Barcelone, Gallimard, 2017, pp. 197-198.
[2] Phrase issue du roman Les Villes Invisibles d'Italo Calvino.
[3] Les citations de ce paragraphe sont issues de deux œuvres : Oscar Wilde, Le Portrait de Dorian Gray, Paris, Stock, 1974, 280 p. (passages non soulignés) et Philip K. Dick, Rapport Minoritaire / Souvenirs à vendre, Malesherbes, Folio Bilingue, 2017, 257 p. (passages soulignés).
[4] Pierre Bayard, Le Plagiat par anticipation, Lonrai, Les Éditions de Minuit, 2009, p. 56.
[5] Ibid., p. 55.
[6] Phrase issue du roman Les Villes Invisibles d'Italo Calvino.
[7] Maurice Blanchot, L'Espace littéraire, Saint-Amand, Folio Essais, 1996, p. 27.