Chercheur postdoc en sociologie de la culture à l’Università della Calabria. Il travaille sur les pratiques de lecture dans la vie quotidienne. Docteur en littérature générale et comparée (Université de Paris 8 Vincennes - St-Denis) et esthétique (Università degli Studi di Siena), il a travaillé sur la réception de Proust chez les philosophes du XX siècle et notamment sur la question du secret dans la Recherche.
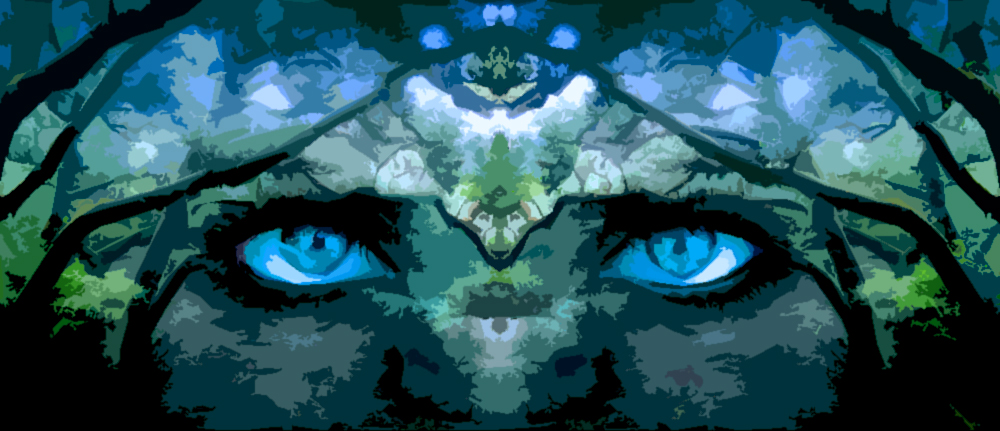
Introduction
Aujourd’hui la question de la lecture est un sujet concernant plusieurs champs du savoir. Si on l’entend dans sa formulation plus simple, c’est-à-dire en tant que relation concrète entre un sujet lisant et un texte, on trouvera des approches théoriques très approfondies dans les domaines des études littéraires, de la philosophie, de la psychologie, de l’anthropologie, de la sociologie des médias, des sciences de l’éducation. Mais on peut regarder aussi à des formes de dialogue entre la culture humanistique, les sciences sociales et les neurosciences, pour saisir l’actualité d’une question qui se pose au cœur des transformations culturelles, sociales et cognitives du présent. En ce sens, on parle beaucoup de la crise de la culture imprimée face à la révolution numérique : dans un contexte communicatif où l’« économie de l’attention » est devenue un capital de spéculation (au double sens d’exploitation de ses ressources et de réflexion sur ses dynamiques), il est devenu de plus en plus urgent d’interroger les avatars de notre manière de lire et notre capacité à façonner l’expérience de lecture.
Devant l’ampleur et la complexité des questions concernant la lecture au présent, on peut commencer par l’analyse des pratiques de lecture consacrées aux fictions littéraires. On sait bien que le texte est un « donné », quelque chose qui « existe » et fait partie de la « réalité » avant que n’importe qui commence à le lire ; mais il est tout aussi incontestable que l’ensemble des signes dont le texte se compose est destiné à rester inaperçu jusqu’au moment où l’œil du sujet lisant intervient pour le déchiffrer.
Voici donc une première définition de la lecture : l’activité qui consiste à vivifier un ensemble de mots structurés selon les normes d’une certaine langue, afin de communiquer un message. Mais cela est encore insuffisant si l’on veut analyser les pratiques de lecture par rapport à la littérature, voire aux fictions littéraires, et leur productivité en termes d’orientation existentielle pour les sujets lisant.
En fait, un texte littéraire est écrit dans le but de stimuler la sensibilité et la capacité interprétative de ses lecteurs : il ne veut pas tout simplement informer ou prescrire des comportements, parce qu’il vise un jeu de séduction avec ce que Mikhaïl Bakhtine a défini comme la « deuxième conscience » du texte, c’est à dire la conscience de celui qui en prend conscience (Bakhtine 1979 ; cf. Lavagetto 1996).
Le moment du lecteur dans les théories littéraires
Que veut dire prendre conscience d’un texte littéraire ? Cette question pourrait guider notre analyse sur les pratiques de lecture, à condition de prêter attention aux différentes trajectoires que les études sur la lecture dessinent à travers des formes d’hybridation interdisciplinaire, sans privilégier une approche théorique par rapport aux autres.
On partira donc d’une simple constatation : en dépit de la fortune que l’étude de la lecture a reçue dans plusieurs champs du savoir, aujourd’hui un développement organique de ce sujet sous la forme d’une « théorie de la lecture » est encore très difficile à repérer. Parmi les théoriciens les plus zélés dans ce domaine multidisciplinaire, Roland Barthes a défini l’impossibilité d’une « Science de la lecture » (Barthes, 1984, 47) : on devrait parler plutôt d’une « science de l’népuisement, du Déplacement infini » (ibidem), car la lecture est la « traversée » d’une « hémorragie permanente », un « jeu » qui implique une « vérité ludique » plus qu’une vérité uniquement objective ou subjective (ibid., p. 35).
Il a reconnu le manque d’un concept fort de lecture et, parallèlement, l’ambiguïté de cette catégorie qui renvoie à un ensemble de pratiques disséminées derrière l’apparent automatisme de son fonctionnement technique.
Au delà des aspects qui touchent l’alphabétisation et le « savoir-lire » (ibid., p. 39), Barthes s’arrête face à l’infinité des horizons que la lecture ouvre aux désirs de ses pratiquants. Son renoncement à fonder une analyse cohérente et systématique de la lecture coïncide avec son admiration pour une pratique transformative et im-pertinente, qui remet en jeu l’identité en négociant sans cesse son rapport à l’altérité.
En suivant la piste qui vise à la pluralisation plutôt qu’à la réduction des signifiés mobilisés par les pratiques de lecture, on doit mentionner aussi l’effort de Wolfgang Iser (1976) et Hans Robert Jauss (1977) dans le contexte académique de l’École de Constance au milieu des années 1970, en relançant le défi lancé par l’herméneutique en direction des théories de la réception et de la lecture.
On reconnaît dans les recherches de Iser et Jauss une direction structurante capable d’influencer aussi le domaine sémiotique. Les catégories de « lecteur implicite », « lecteur réel », « lecteur collectif », « lecteur individuel » et « horizon d’attente » ont ouvert le terrain à des analyses sur la multiplicité des réceptions possibles, c’est à dire sur la production de sens qui est un caractère spécifique des actes de lecture. A ce propos, le lien entre cette tradition philosophique et l’élaboration sémiotique pratiquée par Umberto Eco (1979) est bien reconnaissable dans l’idée d’un écart productif entre l’hypothèse d’un lecteur supposé idéal, protagoniste de la « réception programmée », et les conditions réelles des lecteurs effectifs : la singularité des circonstances existentielles, culturelles et sociales qui façonnent l’attitude des lectrices et des lecteurs face aux textes. Au centre de ce dispositif théorique on trouve un intérêt profond pour les pratiques d’interprétation, c’est à dire pour l’activité au fondement de tout type de communication et de connaissance.
Avec différents accents, les approches herméneutiques et sémiotiques soulignent la participation du lecteur à la construction du sens, sa coopération avec les intentions de l’auteur et du texte, en interrogeant en même temps les limites de cette interaction en termes de légitimité.
Si on regarde encore du côté des études littéraires, la question de la lecture se trouve au centre d’une analyse fortement polyphonique opposant l’idée d’une pratique systémique et totalisante, à la base des canonisations, des systèmes de classifications et des paradigmes culturels qui structurent les communautés interprétatives, aux ambiguïtés des textes qui offrent des espaces possibles pour la lecture en tant qu’exercice de contestation.
Parmi les partisans les plus passionnés de ce modèle pluralisant, Stanley Fish est considéré comme un point de repère dans le courant du « Reader-response Criticism ». On est encore un fois vers le milieu des années 1970 quand cette école concentre son activité sur l’étude des situations de lecture, voire sur les façons de faire l’expérience du texte pour des lecteurs individuels ou des communautés de lecteurs.
L’attention est portée sur la création de sens par les usagers des textes : la lecture est un travail de création qui engage le lecteur jusqu’à sa dimension psychologique profonde, ce qui était explicitement repoussé par les théoriciens adverses du New Criticism. Ces derniers défendaient en fait le « déterminisme textuel », contre la redoutable «affective fallacy» des lecteurs (Bertoni 1996, 140). Par contre, la perspective de Fish vise la productivité du texte par rapport à la relation qu’il entraîne avec un sujet à travers la lecture : le signifié de la littérature est dans ce qu’elle fait, donc dans les expériences des lecteurs. Dans ces conditions le signifié de la lecture est à entendre en termes d’événementialité et de performativité ; plus que dans la page imprimée, il est à rechercher dans la rencontre du texte avec les lecteurs, donc dans ce que la littérature « fait », non pas – du moins non seulement – dans ce qu’elle dit (cf. Fish 1976).
A la même époque et dans le contexte culturel des universités états-uniennes, la critique déconstructionniste exprime la centralité de la catégorie de lecture par des voies différentes.
Paul de Man publie Allegories of Reading (1979), un essai très dense dans lequel il souligne l’ambiguïté du langage littéraire qui offre la possibilité d’élaborer par les mêmes mots des signifiés à la fois littéraux et figurés, comme dans la technique visuelle de l’allégorie.
Les deux options réciproquement incompatibles sont présentées comme possibles en même temps et dans le même lieu ; elles forment un double lien (double bind) dans lequel le lecteur est pris comme un prisonnier ne pouvant pas décider de leur vérité. «Everything in this novel signifies something other than what it represents» (De Man 1979, 77). Cette notation du critique d’origine belge fait allusion à la Recherche de Proust, mais on pourrait la prendre comme emblème de son idée de lecture, qui conduit à l’indécidabilité à propos du vrai sens d’un texte littéraire (cf. Garritano 2013). C’est une façon de formuler la coprésence de plusieurs sens dans le jeu de la figuration littéraire, l’inépuisabilité de notre relation au langage et, comme conséquence directe de ce passage, de « contester son autorité en tant que modèle de la cognition naturelle et phénoménique » (Bertoni 1996, 173).
« Lire : cela va tellement de soi qu'il semble, à première vue, qu'il n'y ait rien à en dire » (Todorov 1978). En dépassant les paradigmes plus rigides du formalisme et du structuralisme, Tzvetan Todorov assigne au problème de la lecture un rôle décisif dans la construction du sens littéraire. Dans La lecture comme construction (ivi, p. 175), il considère la « logique de la lecture » comme un ensemble de règles qui guident les lecteurs vers « la construction d’un univers imaginaire ».
En se référant aux romans en tant que « texte de fiction classique, plus exactement des textes dits représentatifs », Todorov répond à une question apparemment très simple : comment se fait-il que les lecteurs traduisent l’univers des livres – dans leur univers imaginaire ? D’ailleurs sa réponse, en orientant le discours de la construction vers la signification et la symbolisation, n’évite pas de problématiser la relation de lecture à travers les catégories des « filtres narratifs », c’est à dire les façons dont notre imagination travaille un texte de fiction.
En particulier, Todorov considère le « mode », le « temps » et la « vision » comme les paramètres qui filtrent la réception et qui, par conséquent, sont préalables à la construction de la lecture des textes narratifs. On retrouve quelque chose de l’idée barthesienne selon laquelle lire est essentiellement « un jeu mené à partir de certaines règles » (Barthes 1984, 35) : un jeu qui se fait à partir de certaines contraintes à la fois intra- et extra-textuelles.
L’ensemble de ces recherches sur la lecture situées dans le domaine des études littéraires des années 1970 témoigne d’une attention dirigée vers la figure du lecteur, vers ses possibilités de construire et de déconstruire le sens de ses lectures. On peut supposer que cela reflète aussi un moment historique où la culture du livre se développait avec enthousiasme, grâce à l’alphabétisation des générations nées après la Seconde Guerre Mondiale, à la modernisation des accès au capital culturel et aux formes de socialisation des savoirs élaborés pendant les années 1960. Le sujet lisant est le protagoniste de ce moment heureux qui se traduit dans les langages scientifiques en dévoilant les implications complexes que la lecture produit dans plusieurs domaines de la vie humaine.
L’apprentissage de la lecture : du discours savant au discours de l’expérience
L’activité d’un sujet lisant un livre de fiction ne peut être comprise qu’à partir de l’interaction entre la connaissance de la langue et un ensemble de connaissances du monde qui permettent l’attribution d’un signifié à l’information. C’est un travail silencieux, fondé sur des accords implicites qui sont souvent recouverts par l’habitude, l’appartenance culturelle et le sens commun, voir par l’identité du sujet lisant.
La psychologue Maria Chiara Levorato (2000) a résumé efficacement l’ensemble de ces non-dits qui côtoient la compréhension textuelle et qui sont de l’ordre des « représentations mentales : les connaissances du monde et du Soi, qui consistent dans les attitudes, opinions, croyances, valeurs » (ibid., p. 34). Mais la lecture des fictions littéraires n’est pas seulement une affaire de connaissance et de décodage ; elle marque encore l’activité mentale par rapport à la mémoire et à la sensibilité, c’est à dire aux dimensions profondes de la conscience. La capacité d’accéder à cette dimension souterraine est à la fois exigée et entraînée par les pratiques de lecture, qui ouvrent au lecteur des chances de découvrir quelque chose de soi ou d’en approfondir la connaissance à travers des actes d’introspection.
La dimension expérientielle de la lecture est au centre d’un essai qui date désormais de plus d’un siècle : Journées de lecture de Marcel Proust (1905). Son incipit est une provocation si bien connue qu’on la trouve utilisée comme claim pour des campagnes de promotion livresque, comme le petit calendrier Einaudi qui se trouve sur mon bureau au moment où j’écris : « Il n’y a peut-être jours de notre enfance que nous ayons si pleinement vécus que ceux qui nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré » (Proust 1905, 160).
On remarque d’emblée que « dans ces pages admirables du jeune Proust, le mot texte n’apparaît pas une seule fois » (Pontalis 1988, 5). C’est le livre, en tant qu’objet matériel et dispositif de communication (medium au sens propre), qui suscite la réflexion proustienne : la distance entre cette perspective et les approches théoriques évoquées en ouverture peut être mesurée par la différence terminologique entre livre et texte.
Proust entrelace visiblement son opinion sur la lecture et sa propre expérience de lecteur, à ses souvenirs d’enfance évoqués par la tension entre l’expropriation et l’appropriation du temps vécu pendant la lecture. Le paradoxe prend la forme d’une symétrie entre plein et vide : « les jours d’abandon à la passivité de la lecture sont en fait les plus actifs dans la vie d’un enfant » (Bertini 2010, 191). Cela ne veut pas seulement dire que la lecture est une activité, mais qu’elle est aussi un jeu, une sorte de création de soi, et non pas une forme d’abandon passif ou de réception unilatérale d’un contenu qui passe à travers le medium du livre.
En fait, il y a un élément qui est encore plus important pour Proust : la référence à l’enfance transporte le discours dans une atmosphère quasi initiatique ; elle découpe une expérience qui se sépare de l'histoire individuelle pour définir le terrain commun d’un devenir-sujet collectif, opération soulignée dans le texte par le choix du pronom « nous ».
Dans sa formulation définitive, Proust exprime la puissance du paradoxe en évoquant le « miracle fécond d'une communication au sein de la solitude » (Proust 1971, 174).
La recherche exclusive de profit intellectuel réduit le livre à un objet d’érudition, de savoir ou de contemplation esthétique : il est vrai que la lecture nous permet de maîtriser plus de données par rapport à l’expérience directe, mais ici il est question de « ce qui nous pousse à lire, ce que nous attendons de la lecture, et ce que nous y trouvons en nous y perdant » (Pontalis 1988, 6).
La lecture n’est pas un dialogue au sens que John Ruskin assignait à cette pratique, c’est-à-dire une « conversation avec tous les honnêtes gens des siècles derniers », ce qui est très proche d’une forme d’idolâtrie. Au contraire, la relation que Proust décrit dans son essai implique un mouvement de distanciation qui mène vers des pratiques créatrices : la lecture d’un bon livre laisse son lecteur avec des questions sans réponse. En d’autres termes, le lecteur ne parvient jamais à une appropriation fusionnelle du contenu d’un livre ; il crée son contenu à travers l’interaction complexe entre sa mémoire, son vécu, son imaginaire et le monde fictionnel. Ce processus de « communication » laisse toujours de l’excédent, des écarts grâce auxquels la pensée du lecteur est conduite à s’activer dans la solitude, en se détachant du texte jusqu’à s’éloigner de son influence.
Pour l’auteur de Journées de lecture, la « Lecture » est un « acte psychologique original » (Proust 1971, 172) qui travaille le livre en tant que dispositif transférentiel, espace d’une élaboration symbolique entre le moi et l’autre, lieu d’échange à la fois individuel et social. Le livre, non pas le texte, est traversé comme un contenant d’expériences : bien évidemment celles que son auteur y a inscrites au dedans, mais aussi les expériences du lecteur qui habite le livre à sa propre façon, en transférant une partie de soi dans cet espace hybride qui s’approche de la notion winnicottienne d’« espace potentiel entre l’objet subjectif et l’objet perçu objectivement, entre les extensions du moi et le non-moi » (Winnicott 1971, 139).
Si on l’approche de ce côté, la question de la lecture révèle toute sa richesse psychologique : « ce qui nous porte ailleurs, au plus intime et au plus étranger de soi, ce qui réveille des désirs secrets, en fait naître d’inattendus, ce qui donne à désirer » (Pontalis 1988, 5).
Les ressources activées par les pratiques de lecture (pensée, remémoration, imagination, plaisir) sont strictement liées à un événement : une prise de distance que le poète Yves Bonnefoy définit comme le moment où le lecteur « lève les yeux de son livre ». Cela ne veut dire pas que le contenu du livre – les mots, les phrases, les images – est écarté en faveur du solipsisme enthousiaste et démiurgique des lecteurs. C’est plutôt une œuvre de traduction qui engage le lecteur et le livre dans la tentative pour trouver « au cœur de l’interruption, la communication » (Bonnefoy 1988, p. 14) : faire travailler la conscience de l’écart, reprendre le problème d’un autre côté.
Il faut garder cette idée d’interruption créatrice, « l’idée que l’interruption, dans la lecture d’un texte, peut avoir une valeur essentielle et quasiment fondatrice dans le rapport du lecteur à l’œuvre, et d’ailleurs aussi, tout d’abord, dans celui de l’auteur à sa création en cours » (ibid., p. 13).
En se tournant vers sa propre vie, le lecteur fait de la création, en traversant un espace relationnel qui va du moi à l’autre et de l’autre vers le moi. Au centre de cette trajectoire on retrouve la figure du sujet lisant en tant qu’explorateur et amplificateur du texte de départ, comme habitant mais aussi comme créateur d’un monde entre fiction et réalité : « […] le sens d’un texte ne peut commencer à valoir pour nous qu’après la vérification qui consiste, instinctivement d’ailleurs, à en recharger les mots de nos souvenirs ou de nos expériences présentes » (ibid., 18).
Si on regarde du côté des théories littéraires, il faut se référer encore aux idées de Barthes pour voir assignée à sa juste place cette façon de faire expérience de la lecture (« lire en levant la tête »), même s’il s’agit de passer par son interruption (cf. Barthes 1984, 33). Mais il faut aussi bien accepter, comme conséquence de ce discours, une limite très forte sur le plan théorique : l’impossibilité de faire une science de la lecture, donc l’abandon de la dimension abstraite en faveur d’une pensée expérimentale qui vise l’exploration de la lecture en tant qu’activité transformatrice.
Le livre numérique existe-t-il vraiment ?
On a récemment vu remonter l’intérêt scientifique pour les pratiques de lecture. Des différents types de recherches ont interrogé des lecteurs et des lectrices, ainsi que des opérateurs et des opératrices de la culture et du monde de l’éducation, sur l’importance de la pratique de lire dès le plus jeune âge. Le thème qui guide certaines de ces recherches est l’efficace de la lecture de fictions narratives en tant qu’activité mentale produisant des effets bénéfiques sur les dimensions cognitive et affective, sur l’imagination, sur l’orientation existentielle et sur les compétences pour la vie (cf. Batini, Giusti 2017).
Partons d’un cas concret : la lecture à haute voix est un exemple significatif qui se réfère à une pratique historiquement ancienne, datant des époques où la consommation des livres passait en règle générale par la voix et l’incorporation. On sait que le nom « lecteur » représentait au Moyen Age un titre d’enseignant, précisément celui qui enseigne à travers la lectio, voire l’interprétation d’un texte dans la forme d’une « production propre du “lecteur” » (De Certeau 1990, 245). Prêter sa voix au texte signifie aussi admettre un degré d’appropriation, de ré-élaboration et d’invention dans la pratique de lecture, qui devient une forme de consommation transformatrice.
Presque tous les livres étaient lus à haute voix jusqu’à la Renaissance, quand la nouvelle technologie typographique a commencé à faciliter la lecture silencieuse, avec une approche fondée exclusivement sur le sens de la vue (cf. Manguel 1996). D’autre part, il est intéressant d’interroger aujourd’hui les raisons qui nous portent à considérer la lecture à haute voix comme quelque chose de primitif : une pratique ancrée dans des cultures qui ne connaissaient pas les avantages, pour la rapidité et l’information, de la lecture silencieuse ; l’indice d’un retard scolaire dans l’apprentissage de la lecture : « la prononciation […] est un obstacle à une bonne lecture et empêche de dépasser le seuil fatidique des quinze mille mots à l’heure », c’est à dire de la mesure considérée comme le standard du « bon lecteur » (De Rudder 1983, 98) ; une façon de se prendre soin des plus petits, un rituel qui passe souvent par la lecture d’histoires entre parents et enfants avant d’aller se coucher.
Aujourd’hui la valorisation de cet élément primitif résiste au moins dans une phase de la vie humaine ; son importance a été soulignée par des recherches sur les ressources qualitatives que les pratiques de lecture peuvent engendrer dans la vie des individus et des groupes dans les contextes scolaires (cf. Batini, Giusti 2017).
Pour l’instant, il est intéressant de remarquer que la question des transformations de l’expérience de lecture a été souvent reprise en fonction d’une réflexion sur la diffusion des technologies qui modifient nos relations physiques et mentales aux livres.
La typographie moderne avait déjà changé le paysage de la lecture par rapport à la production et à la circulation des textes, en déterminant un évident passage d’époque. Et si aujourd’hui la culture numérique a multiplié d’une façon inédite la disponibilité et les possibilités d’accès aux patrimoines littéraires, il est indéniable que de telles innovations techniques modifient à fond l’écosystème des expériences de lecture et de nos interactions avec les livres, avec des conséquences qu’il faut considérer en détail.
On a commencé à interroger des experts – bibliophiles, historiens, pédagogues, sociologues, médiologues, critiques de la culture – sur le futur de la lecture, c’est à dire sur l’évolution des « situations de lecture » et sur la possible « ouverture de nouveaux horizons pour lecture de textes en un nouveau format » (Casati 2014, 23).
Parmi les réflexions les plus signifiantes de ces dernières années, celle du philosophe Roberto Casati souligne les difficultés de sauvegarder le caractère méditatif et créateur de la lecture dans un environnement numérique où se déroule de façon toujours plus exclusive et dispersive l’exploitation de nos ressources d’attention. D’abord, l’auteur de Contro il colonialismo digitale prend en considération la lecture sans limiter son domaine aux fictions narratives : son lecteur modèle est (aussi) lecteur d’essais et de manuels, c’est-à-dire (aussi) de non fiction ; il est de plus un sujet en formation, c’est-à-dire d’âge scolaire. Casati se réfère de préférence aux effets cognitifs de la lecture, en différenciant qualitativement les domaines de la culture imprimée de celle numérique : l’innovation de la « navigation » sur écran appliquée à la lecture, tout en s’efforçant d’imiter la forme traditionnelle du livre (e-book), transforme le style de l’assimilation, du décodage et de la méditation de la lecture. Le livre numérique demande en fait au lecteur d’utiliser ses ressources d’attention dans un contexte communicatif différent, en investissant ses désirs sur l’exhaustivité d’une information ou sur la vitesse de la lecture. La question de la mémoire représente un exemple très clair de cette discontinuité : le « design général de la situation de lecture » sur dispositif numérique, avec l’introduction des logiciels d’indexation, a facilité les recherches des choses lues, mais a aussi fragilisé l’engagement personnel du lecteur dans le traitement cognitif de l’information. L’interruption créatrice de la lecture, le moment de discontinuité où le lecteur communique avec soi-même par l’interaction avec le livre, se transforme en interruption systématique et structurale, voire en recherche d’autres informations à travers la « navigation » sur les logiciels de lecture.
Au lieu de bousculer les archives de la mémoire existentielle, en réactivant un passage entre le vécu et la pensée, ce type de lecture pousse le sujet lisant à ouvrir des fenêtres virtuelles pour chercher à combler ailleurs son désir de savoir, avec d’autres informations complémentaires.
Pour reprendre un argument de Marco Belpoliti (2012) à propos de la lecture numérique, il faut souligner que le souvenir d’un texte est mêlé d’éléments qui appartiennent à la mémoire physique du livre : couleur, couverture, dimension, poids, emplacement sur le rayon. Ce genre d’idées sur les conditions de mémorisation amènent directement à une critique de la lecture numérique. Il est question des temps et des espaces de lecture : non seulement la segmentation et la dissémination des ressources d’attention aux dépens de l’immersion méditative, mais aussi la structure spatiale du support matériel – ce que Casati appelle le « design général de la situation de lecture » et Belpoliti la « bidimensionnalité » – agit sur nos expériences de lecture numérique, qui apparemment manquent de profondeur.
Quand Proust, vers le final du Temps retrouvé, fait tomber son protagoniste sur une copie de François le Champi dans une bibliothèque qui n’est pas la sienne, il mentionne d’abord la surprise de retrouver un fragment de ses lectures d’enfance dans le village de Combray. Mais ce qui frappe à fond la sensibilité du personnage proustien est « une impression bien ancienne, où mes souvenirs d’enfance et de famille étaient tendrement mêlés et que je n’avais pas reconnue tout de suite » (Proust 1927, p. 463).
L’étrangeté du souvenir d’enfance (« cet étranger c’était moi même, c’était l’enfant que j’étais alors ») est provoquée par le contact avec le livre, avec son titre et sa couverture. Il s’agit d’un exemple typique des résurrections du passé qui sont à la base du projet littéraire proustien, mais l’élément révélé ici n’est pas la bibliophilie du personnage, voire son culte pour les livres en tant qu’objets sacralisés. « Pour les exemplaires eux-mêmes des livres, j'eusse été, d'ailleurs, capable de m’y intéresser, dans une acception vivante. La première édition d’un ouvrage m’eût été plus précieuse que les autres, mais j'aurais entendu par elle l’édition où je le lus pour la première fois » (ibid., p. 465). Ce qui frappe la sensibilité du personnage proustien est plutôt le fait d’avoir retrouvé dans la matérialité du livre quelque chose qui lui appartenait déjà, un fragment de l’histoire de sa propre vie (cf. Garritano 2016).
Les usages de la lecture dans le monde numérique
Les positions plus critiques sur les mutations des pratiques de lecture dans l’environnement numérique témoignent au moins de la prise de conscience d’un changement radical dans le paysage culturel où les figures des lecteurs et des lectrices bougent, se rencontrent et se racontent leurs expériences.
On peut trouver une approche plus optimiste, sinon explicitement enthousiaste, dans l’œuvre de Milad Doueihi, professeur d’humanisme numérique à l’Université de Paris-Sorbonne. Le titre de son livre, Pour un humanisme numérique (2011), se présente comme un manifeste de l’intégration entre le savoir et la sensibilité humaniste et les possibilités d’étendre des formes de socialité, voire de véritable « amitié », dans la sphère culturelle des media numériques.
Quand l’historien des Digital Humanities parle de la « conversion numérique », il se réfère clairement à des façons inédites de construire les temps et les espaces, qui restent à interroger pour comprendre les transformations des champs du savoir, du politique et du social. Intéressé à saisir les « techniques du corps » (cf. Mauss 1936) mobilisées par l’interaction avec ces nouveaux espaces hybrides, Doueihi désigne comme objet de son analyse les formes de la construction d’identités et d’imaginaires pratiquées par les usagers de l’environnement numérique.
En se concentrant sur les habitudes culturelles des consommateurs, il oppose la « fixité » de l’imprimé – la stabilité de son usage, « inscrit à la fois dans la loi et les pratiques et dans la matérialité même » de ses objets – à l’« interopérabilité » du numérique, qui ouvre des possibilités inédites en posant au même temps d’autres contraintes sur les modalités d’usage.
Une vision positive de ce processus imprègne la catégorie d’humanisme numérique, en soulignant la puissance émancipatrice et prométhéenne des nouvelles ressources vouées à la « mobilité ». L’emblème de cette transformation en cours, qui regarde « la réalité d’un changement radical dans notre vécu quotidien comme dans notre culture », est l’« urbanisme virtuel », c’est à dire la construction d’espaces hybrides où le réel se mélange au virtuel pour faciliter la circulation d’informations et des savoirs. Et pour construire des formes de sociabilité dans un monde numérique qui devient de plus en plus habitable.
Dans ce contexte, le rôle du lecteur change radicalement au fur et à mesure de son adaptation aux nouvelles « techniques du corps » (cf. Perec 1985, 103), qui répondent également aux contraintes environnementales des outils et des plates-formes. En bref, on retrouve dans les pratiques de lecture le même contraste général entre la mobilité du numérique et la fixité de l’imprimé ; même si un rapport d’opposition si simple est parfois neutralisé par les coûts des outils et les inégalités géographiques d’accès aux ressources techniques. D’ailleurs, il est intéressant de noter que même la culture imprimée, au cours des siècles de son histoire, a connu ce genre de contradictions : on sait que la typographie a sans doute accéléré la circulation des livres et multiplié leurs diffusion en réduisant les coûts de production matérielle. Il suffit de penser au concept de « multiple transmission » (cf. Williams 1958), formulé à propos du genre romanesque et de son public dans les classes moyennes urbaines au milieu du XVIIIe siècle.
Dans le cas du livre numérique, la mobilité a privilégié des aspects quantitatifs et logistiques : le transport d’archives de textes, les systèmes de recherche à base statistique, la vitesse même des actes de lecture. Plus que la qualité ou le plaisir de la lecture, la question de la quantité d’informations traitables semble être le centre de l’investissement numérique sur le livre.
D’autre part, on peut être d’accord avec l’analyse de Doueihi pour ce qui concerne la mutation des pratiques de lecture dans les usages sociaux de la culture numérique : « la lecture se transforme ainsi, grâce à des formes d’automatisation de plus en plus populaires dans les plates-formes actuelles, en un partage primordial. Lire veut aussi dire sélectionner, faire le tri, classer ces choix selon un ordre spécifique, puis les rendre publics » (Doueihi 2011).
Le tournant que Doueihi appelle « culture anthologique » ne regarde pas la lecture de livres en format numérique, mais les usages de la lecture – même des livres imprimé – dans l’environnement numérique. La fragmentation, le partage et l’échange des lectures sont à la base du déploiement social de la culture du livre dans l’« urbanisme virtuel » du numérique. Les communautés de lecteurs sont incitées à devenir ce que Alvin Toffler aurait défini comme des « prosumers » (cf. Toffler 1980), c’est à dire la « nouvelle espèce » humaine des producteurs-consommateurs, « engendrée par la consommation artistique de masse » (De Certeau 1990, 239) et par la popularisation de la production écrite. Si l’instrument de l’anthologie était par principe « connecté intrinsèquement à l’identification du canon », donc aux classifications institutionnelles et savantes des savoirs (Alfano 2013), on trouve aujourd’hui, dans les espaces hybrides de la culture numérique, beaucoup d’exemples de lectures productrices de citations, réinterprétations, reconstructions, pastiches et appropriations créatives du capital littéraire traditionnel.
Par exemple, on peut mentionner l’existence du compte Twitter géré par Patrick Alexander (@ProustTweet), un ex-professionnel de la finance avec une formation littéraire et philosophique, qui fragmente et réécrit les sept volumes de la Recherche par des séries de tweet quotidiens depuis 2010. Il ne s’agit pas tout simplement de copier et coller les phrases de Proust (ce qui serait techniquement impossible sur Twitter), mais plutôt d’adapter ironiquement son roman aux contraintes de la plate-forme numérique basée sur la concision des messages. On dirait donc que cette opération culturelle tient de la lecture anthologisante, mais aussi de la transposition et de la réinvention. D’ailleurs, l’intérêt sémiotique pour les possibilités et les limites du décodage dans la communication de masse a déjà souligné la différence entre « usage » et « interprétation » textuelle, le premier étant une libre opération productrice de signifié à partir d’une prise du texte en tant que « stimulus imaginatif » (Eco 1979, 59).
Dans le contexte des pratiques de lecture et d’écriture ancrées dans l’environnement numérique des réseaux sociaux, cette distinction va se nuancer avec le phénomène des media fandom, c’est à dire des subcultures consommatrices qui « cessent d’être une simple audience de textes populaires, en devenant plutôt des participants actifs dans la construction des signifiés textuels et dans leur circulation » (Jenkins 1992, 24 ; cf. Pezzini 2007, 143). L’exemple principal de ce type d’engagement du public est la production de fan fiction : une forme d’écriture pratiquée par le media fans qui découle de la réélaboration créative et non autorisée d’autres œuvres. Ce phénomène naît avec des communautés de spectateurs intéressées d’abord par les films et les fictions télévisuelles. Mais on a l’impression que les pratiques de lecture dans le monde numérique, en évoluant vers une nouvelle « culture anthologique » par la fragmentation, le partage et l’usage social des textes, mettent en œuvre des dynamiques d’appropriation qui rapprochent le rôle des lecteurs de celui des spectateurs participants.
Conclusions : la lecture comme construction
Pour tirer des conclusions de ce raisonnement, il faut d’abord dire que la lecture est encore loin d’entrer dans un discours théorique monodisciplinaire. Et, parallèlement, que l’idée barthesienne d’une « science de la lecture » en tant que « science de l’inépuisable, du déplacement infini » est de plus en plus actuelle.
Pour suivre les évolutions de cette pratique culturelle on a besoin de nombreuses professionnalités, de savoirs traditionnels et des avant-gardes théoriques, mais aussi des lectrices et des lecteurs qui racontent leurs expériences de vie avec les livres.
Après avoir exploré les limites et les possibilités d’un ensemble d’enquêtes sur les théories, les expériences et les contextes de lecture, il vaut mieux maintenant concentrer le discours sur la lecture des fictions, donc de textes littéraires, et sur son effet pour l’orientation existentielle des personnes.
On a vu comment au XXe siècle le concept de lecture a été travaillé dans des directions variées à partir d’une certaine hégémonie des études littéraires, en soulignant, d’une part, la centralité du texte et, de l’autre, les possibilités que les lectures ont de produire des interprétations différentes à partir du même texte. La singularité des actes de lecture nous dit que lire ne va pas de soi, contrairement aux impressions communes : il s’agit plutôt d’un ensemble d’opérations complexes qui regardent les capacités cognitives, imaginatives, éthiques et affectives des sujets engagés à tourner les pages de leurs livres en suivant le fil d’une histoire, le rythme des phrases, la puissances des mots. Ce dernier point a été éclairci par la réflexion sur la dimension expérientielle de la lecture, voire sur l’engagement du sujet lisant dans des opérations complexes qui entrent en relation l’une avec l’autre sans arrêt : la symbolisation, l’élaboration de liens et la rêverie, l’identification, la capacité de rendre le monde habitable en négociant les limites du familier et de l’étranger, l’enrichissement des possibilités de comprendre la condition humaine par l’imagination narrative.
En suivant cette perspective d’étude, il est intéressant de mentionner au moins deux œuvres parues en France depuis le début du siècle : Eloge de la lecture de l’anthropologue Michèle Petit (2002) et Façons de lire, manières d’être de l’historienne de la littérature Marielle Macé (2011).
Il n’est pas du tout marginal de remarquer que ces réflexions récentes sur le pouvoir de la lecture en termes d’orientation existentielle ont été produites par deux chercheuses. Au cours du XXe siècle, le récit de soi comme processus de subjectivation a été central pour la prise de conscience de la condition féminine ; et la lecture a été traditionnellement traitée comme une activité préférée par les femmes et les artistes. C’est Petit qui approche plus directement ce point, quand elle parle du problème de la réputation masculine des lecteurs dans des milieux sociaux où lire est perçu comme un signe de faiblesse. L’anthropologue renverse le paradigme de la faiblesse, en travaillant aussi sur les contextes ruraux et populaires où la transmission familière et scolastique des livres est fortement limitée. Sa recherche interroge de près des sujets et des expériences de lecture très différentes entre eux, réunis par le fait de provenir des milieux qui ne bénéficient pas d’un « capital culturel légitime ». Au delà du rapport immédiat entre lecture et réussite scolastique, qui ne va pas de soi, le vrai but de cette enquête est indiqué par le sous-titre de l’œuvre : la construction de soi. « Tout récit de lecteur comporte de la même façon une évocation des morceaux qu’il a emportés pour édifier sa maison, qui ont donné lieu a des réemplois, des réinterprétations, des transpositions souvent insolites » (ibid., p. 20).
La création d’un « espace potentiel » entre jeu et réalité (cf. Winnicott 1974), entre monde intérieure et extérieure, transgenre et transgénérationnel, a beaucoup à voir avec la valeur existentielle des pratiques de lecture. On ne pourrait pas sous-évaluer l’interminable mouvement d’échange entre littérature et vie, qui conduit le lecteur vers une meilleure compréhension de soi même et des attitudes, des sentiments, des émotions qui définissent la condition humaine. En fait les modes de faire expérience de la littérature par la lecture peuvent être considérés comme des « formes de vie », parce que « des lecteurs diversement situés sont amenés à prendre les textes comme des échantillons d’existence » en les utilisant « comme de véritables démarches dans la vie » (Macé 2011, p. 16).
Ce mouvement d’orientation est approfondi par Macé qui décrit des trajectoires d’individuation à travers une circulation entre pratiques de lectures et formes de vie, en présentant la lecture comme un « corps à corps » (ibid., p. 23) entre les formes du récit et celles des conduites subjectives. Il ne s’agit pas tout simplement d’un éloge du « bovarysme », de la tendance à se fabriquer des personnalités fictionnelles par amour des fantasmes littéraires, décrite par Jules de Gaultier grâce au roman de Flaubert. Et pourtant le « bovarysme » nous dit quelque chose sur le pouvoir de la lecture : la possibilité de donner un nom à des phénomènes complexes au niveau psycho-social et culturel, en les comparant aux histoires et aux personnages d’un livre de fiction.
L’enjeu de cet échange entre fiction et réalité est la compréhension du monde réel par la connaissance du monde du récit ; et, en sens inverse pour le lecteur, la compréhension d’un texte par sa propre expérience de vie.
Les ressources créatives activées par l’usage des fictions dépendent en principe de cette circulation à double sens et incontrôlable, parce que « la lecture est d’abord une “occasion” d’individuation : devant les livres nous sommes conduits en permanence à nous reconnaître, a nous “refigurer”, c’est-à-dire à nous constituer en sujets et à nous réapproprier de notre rapport à nous-même dans un débat avec d’autres formes » (ibid., p. 18).
Bibliographie
Giancarlo Alfano, « Ciò di cui siamo fatti. Per una descrizione del nostro modello di mondo », dans Le parole e le cose, 1 octobre 2013 : www.leparoleelecose.it.
Mikhaïl Bakhtine, « L’auteur et le héros » (1979), dans Esthétique de la création verbale, trad. franç., Paris, Gallimard, « Bibliothèque des Idées », 1984, pp. 25-210.
Roland Barthes, Le bruissement de la langue, Paris, Seuil, « Essais Critiques », 1984, IV.
Federico Batini, Simone Giusti (dir.), Empowerment delle persone e delle comunità, Lecce-Rovato, PensaMultimedia, 2017.
Marco Belpoliti, « Perché non ricordo gli e-book ? », dans Doppiozero, 9 juillet 2012 : www.doppiozero.com.
Federico Bertoni, Il testo a quattro mani. Per una teoria della lettura (1996), Milano, Ledizioni, 2010
Mariolina Bongiovanni Bertini, « Moralité de la lecture. De la vision pédagogique de Ruskin à la complicité proustienne », dans Mariolina Bongiovanni Bertini, Antoine Compagnon (dir.), Cahiers de la littérature française. Morales de Proust, Paris, L’Harmattan, 2010, IX-X, pp.189-200.
Yves Bonnefoy, « Lever les yeux de son livre », dans Jean-Bertrand Pontalis (dir.), Nouvelle Revue de Psychanalyse, 37, printemps 1988, pp. 9-19.
Roberto Casati, Contro il colonialismo digitale. Istruzioni per continuare a leggere, Roma-Bari, Laterza, « i Robinson/Letture », 2013 (ePub).
Michel De Certeau, L’invention du quotidien, Paris, Gallimard, « folio Essais », 1990, t. I.
Paul De Man, Allegories of reading : Figural language in Rousseau, Nietzsche, Rilke, and Proust, New Haven, Yale U. P., 1979.
Orlando De Rudder, « Pour une histoire de la lecture », dans Médiévales, 3, 1983, pp. 97-110.
Milad Doueihi, Pour un humanisme numérique, Paris, Seuil, « Librairie du XXIe siècle », 2011, aussi publié en e-book dans la collection « Washing Machine » de publie.net 2011 (ePub).
Umberto Eco, Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi (1979), Milano, Bompiani, « Tascabili », 2015.
Stanley Fish 1976, « How to do Things with Austin and Searle : Speech Act Theory and Literary Criticism », dans Modern Language Notes, 91 (5), oct. 1976, pp. 983-1025.
Daniele Garritano, « De Man chez Proust : allegoria, traduzione e pratica del dettaglio », dans Quaderni proustiani, 7, 2013, pp. 121-129.
Daniele Garritano, Il senso del segreto. Benjamin, Bataille, Deleuze, Blanchot et Derrida sulle tracce di Proust, Milano-Udine, Mimesis, 2016, « Percorsi di confine/Saggi ».
Wolfgang Iser, L’acte de lecture : théorie de l’effet esthétique (1976), trad. franç., Bruxelles, Pierre Mardaga, « Philosophie et langage », 1985.
Hans Robert Jauss, Pour une herméneutique littéraire (1977), trad. franç., Paris, Gallimard, « Tel », 1988.
Henri Jenkins, Textual Poachers : Television fans and Participatory Culture, New York, Routledge, 1992.
Mario Lavagetto (dir.), Il testo letterario. Istruzioni per l’uso, Roma-Bari, Laterza, « Manuali Laterza », 1996.
Maria Chiara Levorato, Le emozioni della lettura, Bologna, il Mulino, « Studi e ricerche », 2000.
Marielle Macé, Façons de lire, manières d’être, Paris, Gallimard, « NRF Essais », 2011.
Alberto Manguel, Une histoire de la lecture (1996), trad. franç., Arles, Actes Sud, 2000.
Marcel Mauss, « Les techniques du corps », dans Journal de psychologie, XXXII, 3-4, mars-avril 1936, pp. 271-293.
Georges Perec, Penser/Classer (1985), Paris, Seuil, « La Librairie du XXIe siècle », 2003.
Michèle Petit, Eloge de la lecture : la construction de soi, Paris, Belin, « Nouveaux mondes », 2002.
Isabella Pezzini, Il testo galeotto. La lettura come pratica efficace, Roma, Meltemi, 2007.
Jean-Bertrand Pontalis (dir.), Nouvelle Revue de Psychanalyse, 37, printemps 1988.
Marcel Proust, « Journées de lecture » (1905), dans Contre Sainte-Beuve, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1971, pp. 160-194.
Marcel Proust, Le Temps retrouvé (1927), dans À la recherche du temps perdu, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1989, t. IV.
Tzvetan Todorov, Poétique de la prose. Suivi de : Nouvelle recherches sur le récit, Paris, Seuil, « Points », 1978.
Alvin Toffler, The Third Wave. The Classic Study of Tomorrow, New York, Bantham Books, 1980.
Raymond Williams, Culture and Society (1958), New York, Columbia U.P., 1963.
Donald Woods Winnicott, Jeu et réalité. L’espace potentiel (1971), trad. franç., Paris, Gallimard, « Folio », 1975.