
Le Grand Lifting des fées : avatars postmodernes du merveilleux
Christian Chelebourg et Noémie Budin (sous la direction de)
M@gm@ vol.14 n.3 Septembre-Décembre 2016
TRANSFIGURATION DE LA FIGURE FÉERIQUE ENTRE MURKMERE ET AMBERGATE DE PATRICIA ELLIOTT : LA FÉÉRIE MODERNE ET LE SUBLIME
Anne-Lise Bégué
annelise.begue@yahoo.fr
Doctorante en littératures générales et comparées à l’université du Maine. Elle effectue une thèse sur Les Géographies de l’enfance dans Alice’s Adventures in Wonderland (1865) de Lewis Carroll, Le Avventure di Pinocchio (1883) de Carlo Collodi, Peter Pan (1911) de James Matthew Barrie et Le Petit Prince (1943) d’Antoine de Saint-Exupéry, sous la direction de Nathalie Prince. Elle est entre autres chargée de diffusion de la culture scientifique auprès d’un public large lors d’actions de valorisation (Nuit des chercheurs, Fêtes de la science…) et de coordination éditoriale pour TraverSCE, la revue de l’école doctorale SCE du Mans.
 The Fairy Feller’s Master Stroke (1855-1864) - Richard Dadd (1817-1886) |
Face aux recherches sur le merveilleux médiéval et son influence dans la littérature d’aujourd’hui, face aux nombreuses réécritures ou adaptations des grands textes du moyen-âge qui amplifient la dimension merveilleuse des signes dans la nature et des actions héroïque, « [c]e qui nous fascine, c’est la propension de la mentalité médiévale à intégrer au quotidien une dimension que notre rationalisme nous refuse, aujourd’hui déplacée et reléguée dans le domaine du rêve ou de l’imaginaire [1] ». Aussi pour comprendre, aujourd’hui, le devenir du merveilleux, faut-il chercher en se déplacement les transfigurations faites sur les spécificités de ce merveilleux. Pour ce faire, les deux ouvrages écrits par Patricia Elliott Murkmere [2004] [2] et Ambergate [2005] [3] semblent propices à une étude de cette transfiguration merveilleuse par rapport à l’exploitation de la figure féérique et des espaces dans lesquels elle évolue. En effet, ces deux ouvrages s’appuie d’une part sur une matière de Grande Bretagne, d’autre part sur une mythologie Irlandaise comme le tient à préciser Patricia Elliott en guide d’épigraphe dans ses deux ouvrages : « Les superstitions de ce roman sont issues du folklore britannique [4] ». Les deux romans dressent un cadre propice au déploiement de cet imaginaire féerique si on s’en tient à la définition de Laurent Guyénot : Le féerique parle de l’autre monde et de la destinée de l’homme après la mort, mais sa sémantique ne peut être saisie qu’en relation avec d’autres imaginaires auxquels il se confronte. C’est un discours vernaculaire qui interagit, de manière souvent provocatrice et parfois énigmatique, avec le discours normatif des clercs [5].
Murkmere et Ambergate déploient ce même cadre dans lequel deux discours sont confrontés : la religion imposée par le Seigneur Protecteur et la légende des Avias issu d’un folklore traditionnel. Et une légende particulière gravite autour de ces superstitions, celle des Avias, « ces hommes qui osèrent, à l’aube des temps, posséder des ailes et voler comme les dieux [6] » Pour avoir fait preuve d’hybris et transgresser l’interdit, « ils ont été punis, perdus pour l’éternité entre deux natures, ni vraiment hommes, ni vraiment oiseaux [7] ».
Ces créatures, ces Avias, rappellent les nombreuses légendes sur ces figures féériques hybrides, entre deux natures, qui, par les airs, conduisent des héros vers une autre terre, considérée parfois comme le paradis terrestre. Dans les deux œuvres de Patricia Elliott, cette figure féérique de la femme-fée emportant dans son sillage un héros vers l’Autre monde est en effet réemployée et ré-exploitée dans une même figure, un même personnage principale, Leah, que l’on soupçonne d’être une Avia, une femme-oiseau, une femme-cygne. Le folklore Irlandais est remplies de légendes autours d’enfants-cygnes qui ont nourri les textes français médiévaux des xiie et xiiie siècles [8] et qui ont d’ailleurs donné au début du xixe siècle de très beaux contes issus de la tradition orale [9].
Or, les deux romans n’endossent pas le même point de focalisation ; le lecteur suit en effet dans Murkmere les aventures de sa Dame de compagnie Aggie tandis que Ambergate raconte celles d’une jeune cuisinière Scuff. Toutes deux sont vouées à rencontrer ces figures féeriques, les Avias. Et, tout comme le regard et le point de vue changent, l’exploitation de la figure féérique évolue. Ambergate pousse à son paroxysme la transfiguration tandis que Murkmere commençait à peine à la développer, à poser les nouvelles bases de cette transfiguration. Or si « les rapports que les fées entretiennent avec le merveilleux semblent aller de soi » et que « l’expérience que nous avons de ces femmes surnaturelles, magiques ou fantastiques, comme l’on voudra, est d’abord celle d’un texte, c’est-à-dire d’un double prisme, idéologique et artistique » [10], l’étude des différentes exploitations de la figure féerique entre ces deux ouvrages pourrait poser quelques pistes de réflexion sur ce processus de transfiguration ; vers quel point peut tendre la féerie ? Quels chemins peut-elle emprunter ? Comment comprendre donc le merveilleux aujourd’hui ?
Les occurrences de la féerie
La première apparition de Leah auprès du personnage principal, que ce soit dans Murkmere ou Ambergate, se situe près de l’étang, à l’image classiques des nymphes ou numphae, ces « belles jeunes femmes surnaturelles aperçues près d’un point d’eau [11] ». Leah est en effet représentée dans Murkmere telle « une créature immobile sur la rive lointaine, une silhouette pâle perdue parmi les roseaux [12] » tandis que dans Ambergate la jeune Avia annonce elle-même le lien qu’elle a avec ce point d’eau : « L’étang m’appartient [13] ».
Mais parallèlement à la figure de nymphe qu’elle endosse, Leah est décrite comme une créature spectrale. Aggie la prend en effet pour un spectre et Scuff la décrit comme « une âme qui se noyait [14] ». Cette apparition spectrale, presque surnaturelle, endosse, telle la fée médiévale, une dimension mortuaire. Cette relation à la mort et la capacité de Leah à pouvoir voler font d’elle un être à part n’appartenant pas au même monde que les autres personnages. Aggie finit d’ailleurs par s’en faire la réflexion à la fin de Murkmere : Près du rivage, les premières lueurs de l’aube se reflétaient sur la surface argentée. Le visage de Leah avait la même pâleur. Elle appartenait au ciel et à l’eau, j’appartenais à la terre [15].
Être aquatique et céleste (elle appartenait au ciel et à l’eau), Leah est bien cette figure hybride entre nymphe et oiseau ; elle peut se transformer en cygne. Or cette capacité à s’envoler de la part de la jeune femme ou des Avias reconstitue ces voyages médiévaux entre le monde terrestre et l’autre monde. Dans Murkmere, le départ de Leah préfigure ce voyage, car il est microstructurellement dirigé vers une île, île pouvant représenter le Paradis Terrestre ou rappeler la célèbre Avalon, cette île que l’on peut atteindre en bateau chez Geoffroi de Monmouth. Leah devient ainsi cet Avia lorsqu’elle monte dans la barque pour rejoindre cette île, et c’est en l’atteignant qu’elle devient symboliquement figure féerique. Entre les deux ouvrages, le lecteur ne sait ce qui est advenu de Leah jusqu’à ce que les hommes de Grounted la retrouve dans Ambergate ruisselante près d’un lac. Cette incertitude liée à sa capacité à s’envoler renforce l’idée d’un possible et constant voyage entre les deux mondes. Elle fait d’ailleurs partie de l’équipage à la fin d’Ambergate qui s’enfuie par les galeries souterraines clairement représentées comme le Paradis Terrestre [16], se situant à l’ouest : Nate posa les rames et laissa glisser la barque. Il s’abstint de réveiller les deux jeunes filles, mais Chance souleva la tête et contempla avec émerveillement le spectacle magique qui s’offrait à ses yeux. Les jardins du Paradis, la nécropole abandonnée située à l’ouest de la Capitale. […] C’était un lieu irréel et mystérieux, où régnaient les esprits [17].
De nombreux motifs indiciels [18] font de la crypte une porte vers l’Antre-Monde. La barque, la capacité de voler et le cygne qui suit de près l’embarcation sont d’autant de signes que « [l]e départ pour l’autre monde est, dans la tradition irlandaise figurée soit par une navigation, soit par une métamorphose en cygne [19] », figuration qui a contaminée Le Chevalier au cygne dont « [l]’une des particularités formelles […] est la nef tirée par un cygne[20] »,résultat « d’une superposition de deux versions du mythème funéraire, l’une où le héros disparaît sous forme de cygne, l’autre où il disparaît sur une nef magique (guidée surnaturellement) [21] ». Ces deux mythèmes funéraires, comme les nomme Laurent Guyemot se retrouve ainsi à la fin d’Ambergate par le biais de deux figures suivanntes : l’embarcation et le cygne. Patricia Eliott insère alors dans ses œuvres une autre des fonctions de la fée médiévale, celle de pouvoir conduire les héros vers l’autre monde et ainsi les soustraire à la mort. Erland avant sa transformation en cygne est blessé mortellement. Quelques minutes après sa mort, un cygne fantomatique surgit derrière l’embarcation. Tout dans le texte indique qu’il puisse s’agir d’Erland ; il faut comprendre que sa métamorphose après trépas appelle une fonction de transfert, de psychopompe. La fée conduit dans l’autre monde cet amant qui pourra ainsi échapper à la mort, car « la métamorphose magique constitue une façon de féeriser les morts, et l’implicite de la mort s’efface derrière l’explicite de la métamorphose [22] ».
Déplacement du motif : amplification et matérialisation
La féerie dans Murkmere et Amberagte s’appuie ainsi sur deux aspects : la figuration des Avias en Leah par la symbolisation qu’endosse sa peau de cygne considérée comme ses ailes, et les différents espace-temps mimétiques du Paradis Terrestre ; autrement dit sur un objet-merveille et sur un espace-temps altéré, un autre monde issu de la tradition féérique.
La peau de cygne figure les ailes des Avias. Définies comme une relique dans les deux œuvres, elle « « frappe originellement le regard et implique quelque chose de visuel [23] ». Moins objet-merveilleux qu’objet-merveille car elle est dans un premier temps dépourvue de caractère surnaturel, elle provoque le même effet que le merveilleux qui « se caractérise par la rareté et l’étonnement en général admiratif, qu’il suscite [24] » mais ne pose pas de question de crédibilité. Cette définition du merveilleux correspond parfaitement à la fonction de la peau de cygne dans les deux œuvres ; elle fige sur place, méduse, étonne étymologiquement, c’est-à-dire, elle frappe celui qui la perçoit comme s’il était frappé par la foudre.
Par ailleurs, tout comme le merveilleux, la peau de cygne relève du passé. Elle tient son importance d’un passé à la fois collectif – par la légende même des Avias – et personnel puisque, dans les deux œuvres, les peaux de cygnes appartiennent à des générations passées, qu’il s’agisse des ailes de la mère de Leah dans Murkmere ou de celles de la Grand-mère d’Erland dans Ambergate.
Entre les deux œuvres, la figure féérique subit alors un processus de multiplication, un dédoublement certainement, voire un triplement. Alors que dans Murkmere Leah est la seule à être une Avia, dans Ambergate, la grand-mère d’Erland vient s’ajouter à la liste et le lecteur peut même soupçonner que Scuff en est une elle-aussi à cause des nombreux indices disséminés dans le texte. Elle fait une chute de plus de trente mètres et survit miraculeusement, et le lecteur finit par apprendre qu’elle est la cousine de Leah. Avant même de connaître son nom, sa famille et ses origines, c’était un chant qui la définissait : J’ai laissé mon amour près de la Porte d’Ambre. Clef de son identité, ce chant [e] captiver l’esprit […], comme si un sortilège [a] raison de [la] bestialité [25] » humaine, et a pour résultat le silence, « un silence absolu [26] » (p. 259), car sa voix est ce qui la rapproche d’une nature autre : Ma voix flottait dans les airs, claire et sincère. Il me semblait qu’elle ne m’appartenait pas. C’était celle d’un oiseau, libre et légère[27].
Le chant de Scuff rappelle dans l’œuvre celui du cygne et devient ainsi un motif indiciel. Cette voix est d’ailleurs ce qui permet de faire glisser la superstition des Avias non plus du côté du magicus, tel que Jacques Le Goff l’a défini, opposé au miraculosus, mais du côté du mirabilis. Alors que Murkmere reprenait une dualité magicus / miraculosus, Ambergate brise cette dualité par l’insertion d’une appréhension autre de la légende et de ses éléments, par l’intermédiaire des mirabile.
De la même manière, alors que le caractère féerique des Avias dans Murkmere reste cloisonné sur cette peau de cygne, dans Ambergate, elle est annonciatrice de l’apparition cette fois-ci fantastique – à comprendre dans son sens étymon grec phantasein – du cygne derrière la Porte d’Ambre. Murkmere joue sur ce glissement entre merveille et fantastique tandis qu’Ambergate n’hésite pas à le figurer. Dans le premier ouvrage, ce sont les superstitions qui permettent ce jeu à travers de nombreuses discussions sur l’existence réelle ou non des Avias [28]. C’est à partir de ces superstitions dressées autour de la légende des Avias que la nature de la peau de cygne prend tout son sens. Merveille dans un premier temps, elle permet de renforcer la dimension fantastique de la légende et de préparer le surgissement du surnaturel à la fin de l’ouvrage. Ambergate met aussi en scène ce glissement, notamment dans les nombreuses discussions entre Nate et Chance ou Le Seigneur Protecteur et Mather sur la légende des Avias, mais l’hésitation entre ailes ou simple peau de cygne est figurée dans l’apparition même de ce cygne à la fin de l’ouvrage qui revête entièrement son caractère fantastique : Il vit une silhouette blanche glisser sur les eaux noires. Son cœur fit un bond, car il lui sembla que la créature avait jailli du tunnel dans leur sillage.
Le cygne dans le crépuscule, était fantomatique, semblable aux esprits qui hantaient la nécropole désolée. Pourtant, aux yeux de Nate, cette apparition n’avait rien d’étonnant. La Porte d’Ambre les avait conduits ver la liberté, un monde encore inconnu où tout, désormais, pouvait être réalisé [29]. Le cygne a perdu son caractère merveilleux, il n’a plus rien d’étonnant, il n’est plus que cette représentation « fantomatique » d’Erland abandonné derrière la porte d’Ambre tout comme ce cygne « semblable aux esprits qui hantaient la nécropole désolée ».
Si la merveille est une préparation au surgissement du fantastique – qu’il soit implicite dans Murkmere ou figuré dans Ambergate –, il en est de même du traitement spatial. Dans Murkmere, Aggie ne quitte pas le domaine bien qu’il endosse toutes les caractéristiques de l’espace merveilleux : il est menaçant et hostile mais surtout isolé et clôt, entouré de hauts murs, de grilles et d’un portail qui ne s’ouvre que très rarement pour Aggie qui n’a qu’une envie, fuir. Les mêmes caractéristiques décrivent le domaine dans Ambergate, mais dès le début, le narrateur prévient le lecteur d’une possible altération spatiale : « Tout était possible dans ce mystérieux domaine [30] ». Contrairement à Aggie dans Murkmere, Scuff est amenée dans Ambergate, sous les impulsions de l’errance, à quitter le domaine. L’étang n’est ainsi plus le seul lieu étrange lié à la légende des Avias, comme c’était le cas dans Murkmere. Scuff passe d’un monde isolé et reculé à un monde merveilleux régi par des règles qui lui sont propres : la Lande. Dans la Lande, « le cours du temps [est] différent [31] » car « [c]’est un lieu magique et sauvage, qui obéit à ses propres lois [32] » et dans lequel peuvent surgir des « créatures irréelles [33] ». Pourtant cet espace-temps merveilleux n’est qu’une étape dans l’appréhension du monde féérique, l’errance aboutit en effet derrière la porte d’Ambre dans ce canal mimétique du Paradis Terrestre.
Si un espace merveilleux peut se définir par des chronotopes autres, bien définis et qui sont ancrés hors du réel, un espace fantastique trouve son altération dans le réel car, tandis que l’espace merveilleux est régi par des règles qui se définissent au fur et à mesure de son installation, l’espace fantastique dans le genre du fantastique appelle un surnaturel qui « doit donc s’intégrer d’abord au réel possible du lecteur [34] », chamboulant ainsi le monde [35]. L’espace fantastique pourrait ainsi être défini par un ancrage dans le réel sans pour autant proposer de règles claires, définies et indiscutables, et ce à cause du surgissement du surnaturel.
Le surgissement du surnaturel, ici le cygne fantomatique, rend poreux la frontière entre l’espace réel et l’espace imaginaire. Les Jardins du Paradis, tels qui le sont décrits, prennent leur source au-delà de la crypte, à la sortie du sombre tunnel, sur le canal. L’espace-temps dans lequel ils s’ancrent est totalement différent de celui de la Lande clairement et explicitement définie comme un lieu magique avec ses propres codes.
Or, dans Murkmere, ce passage entre deux mondes n’étaient que figuré – Aggie ne voit même pas Leah passer de l’un à l’autre – tandis que, dans Ambergate, ce passage est matérialisé, la Lande est ce lieu qui permet, à travers l’errance, de faire le glissement entre un simple espace isolé où l’étrange peut survenir, et un espace mimétique du Paradis Terrestre où le fantastique se déploie dans toute sa grandeur.
Ainsi, bien que Murkmere et Ambergate exploitent la même matière féérique, ces deux ouvrages la transfigurent de manière différente. Même si Murkmere constitue à elle seule une diégèse, il apparait qu’elle pose le cadre propre à une transfiguration plus élaborée dans l’ouvrage qui la suit, Ambergate. Cette matière féérique subit en effet un processus d’amplification, que ce soit par la multiplication des figures féériques, par une redéfinition de sa nature et par la matérialisation d’un type d’espace seulement énoncé et implicite dans le premier ouvrage.
De l’unilatéralité à la double réception ou le glissement vers le sublime
Parallèlement à ce glissement entre merveille et surgissement du fantastique, entre espace merveilleux et espace fantastique, la double réception de la merveille est en constant renforcement. Dans Murkmere, qu’il s’agisse d’ailes mécaniques [36] ou de peau de cygne, l’objet-merveille inspire de la crainte et de la révulsion. Ce ressentit négatif est en partie causée par les superstitions qui gravitent autour des oiseaux et des Avias. Seule Aggie à la fin de Murkmere change son regard. Ambergate reprend ces sentiments ambivalents autour de la relique mais les cristallise dans un même ressentit, au même instant, durant une seule et même appréhension. Le caporal Chance, qui est chargé de s’occuper des « ailes » de Leah jusqu’à son mariage, est partagé entre révulsion et attraction : Chance retint son souffle. La relique était d’un blanc éclatant. Chaque plume avait une forme et une disposition parfaite. Aussitôt, il fut pris du désir irrépressible de la toucher, de sentir sa douceur, d’y plonger profondément les doigts. Si Nate ne s’était pas trouvé à ses côtés, il aurait fait voler la vitre en éclats et enfoui son visage dans cet objet d’une beauté fascinante. Pourtant, ce spectacle le révulsait. […] Que lui passait-il par la tête ? Il détestait ces créatures. Il se détourna et constata qu’il tremblait de tous ses membres [37] ».
Emmanuel Kant a défini le sublime comme provoquant une violence de l’esprit devant un objet non-fini, c’est-à-dire impossible à représenter, démesuré, hors-norme. Dans Murkmere, le même objet n’inspirait qu’un seul ressenti à la fois, alors que dans Ambergate il cristallise deux sentiments extrêmes qui provoquent cette violence intérieure : pulsion et répulsion, attraction et révulsion, la première étant liée aux perceptions de l’observateur, la seconde liée à ce qu’il sait de l’objet appréhendé, ici les superstitions liées à l’objet-merveille. Or, la relation entre le merveilleux et le sublime est loin d’être nouvelle puisque le traité antique attribué à Longin et traduit par Nicolas Boileau au xviie siècle fait ce parallèle dans le sous-titre même de l’ouvrage : Le Merveilleux dans le discours. Pierre Hartmann remarque à propos de ce traité que : Dans de nombreux passages, le merveilleux tend à se confondre avec le sublime, à former avec lui une unité indissociable. Le sublime peut donc également se comprendre comme le surgissement dans le discours d’un élément surnaturel, qui ne tient évidemment pas aux seules caractéristiques du style [38].
Il faudrait ainsi non pas considérer le seul surgissement du surnaturel comme facteur de sublime mais retrouver dans son appréhension la confrontation possible entre ce que nos sens nous poussent à ressentir et ce que nous savons, nous connaissons, matière en totale contradiction avec le ressenti premier lié à l’entendement. La beauté de la relique s’oppose à l’interdit sociétal et religieux qui entoure les Avias. Bien que Chance « détest[e] ces créature », il a ce « désir irrépressible de la toucher, de sentir sa douceur, d’y plonger profondément les doigts [39] » devant la blancheur et la perfectibilité de la merveille. Cette confrontation est à l’origine du travail de l’esprit, de la réception active et des émotions que Kant attribue à la réception du sublime. Ce mouvement de l’esprit chez Chance est d’ailleurs caractérisé par une réaction physique lorsqu’ « il constat[e] qu’il trembl[e] de tous ses membres [40].
Selon Emmanuel Kant, cette réaction active de l’esprit suit plusieurs étapes : exaltation liée à l’émerveillement, peur devant notre impuissance et notre finitude face à la grandeur et à la non-finitude de l’objet sublimé, et raisonnement qui permet de dépasser cette impuissance. La tension entre attraction et répulsion ou pulsion et répulsion naitrait ainsi d’un accablement devant une force écrasante, devant un objet impossible à saisir et qui retranche l’esprit dans une infériorité, une insignifiance et une finitude absolue. Pourtant Et face à cet accablement, pour Emmanuel Kant, nous trouvons en nous une faculté de nous juger indépendants par rapport à cette force irrésistible et de nous mettre en position de supériorité par rapport à la nature. La fin de Murkmere semble s’accorder avec cette réception du sublime, notamment lors de la mort d’Erland, non représentée et non représentable autrement que par le surgissement du chant angélique : Quelqu’un chantait près de la Porte d’Ambre.
C’était une voix claire et angélique, si belle que les larmes nous montèrent aux yeux, celle d’un homme qui semblait avoir attendu toute sa vie et s’abandonnait tout entier à cette chanson. Elle emplit mon cœur et mon âme, vibra autour de nous. Ces sons éthérés venaient d’un autre monde. Je n’avais jamais rien entendu de tel auparavant, et désespère de l’entendre de nouveau. Cette mélodie évoquait les joies et les malheurs de la vie. Car celui qui recherche le bonheur doit affronter la tristesse. […] La chanson s’acheva par une note tenue, semblable à une plainte qui refusait de s’éteindre. Le silence se fit, et nous n’entendîmes plus que le ressac de l’eau contre les flancs de la barque [41].
Le chant provoque après ravissement plusieurs réactions diverses : le silence et les cris, le désespoir et l’espoir, car il prépare la résurrection fantastique d’Erland. La voix est en effet « celle d’un homme qui semblait avoir attendu toute sa vie » dont les sons éthérés venaient d’un autre monde » formant à la note finale « une plainte qui refusait de s’éteindre ». Patricia Eliott en s’appuyant sur cette tradition féérique de l’équipage guidé par un être hybride vers l’autre monde fait du sublime la marque de la subversion de la mort dans un autre espace-temps. Le cygne, représentant symboliquement et métaphysiquement Erland a en effet tout d’une créature spectrale, et n’est que le prolongement du chant entendu un instant plus tôt. Ainsi, tout comme « [l]e sublime nous procure […] une issue hors du monde sensible [42] », la mort d’Erland est détournée car les sens qui l’ont appréhendée sont rejetés. Elle est ainsi transfigurée, héroïsée par le surgissement de ce chant et du cygne, tout comme ces héros dont la mort était rejetée par leur trajet vers l’autre monde. Le fantastique, en tant qu’apparition, surgissement de la merveille, rejette la deuxième étape du sublime Kantien ; l’accablement. Alors que la relique, lorsqu’elle arbore les traits du merveilleux, crée pulsion et répulsion, le fantastique, l’apparition saisissante d’une figure féerique, ici le signe, achève la troisième étape Kantienne et permet ainsi de sublimer la mort du héros.
*
* *
L’étude comparée de l’exploitation de la figure féerique dans Murkmere et Ambergate de Patricia Elliott tisse donc un lien entre la merveille et le sublime. Cette exploitation semble en effet tendre vers un processus d’amplification et de matérialisation de l’objet-merveille et de l’espace-temps altéré, amplification et matérialisation qui participent à la double réception propre au sublime. Or, Pierre Hartmann disait qu’ « [i]l y aurait dans le sublime comme l’avènement inopiné et la découverte saisissante d’un autre monde, transcendant à celui où évolue ordinairement l’humanité [43] » (p. 29). Même s‘il s’agit bien évidemment d’un monde dominé non plus par le sensible mais par la raison dont parle Pierre Hartmann, le sublime provoquant la redécouverte du monde ne pourrait-il pas illustrer la création d’un autre monde par ce même passage qu’empruntent Scuff et ses amis ? Car l’ouvrage présente une fin ouverte où la subversion de la mort d’Erland par sa métamorphose en cygne et le passage indiciel vers l’Autre Monde ouvre l’espace fantastique, celui d’un espace réel, altéré, qui n’est plus perçu de la même manière, sur un autre espace-temps, un autre monde : « La Porte d’Ambre les avait conduits vers la liberté, un monde encore inconnu où tout, désormais, pouvait être réalisé [44] ».
Notes
[1] S. Gorgievski, Le Mythe d’Arthur : de l’imaginaire médiéval à la culture de masse, Liège, Belgique, Ed.du Céfal, 2002, p. 97.
[2] P. Elliot, Murkmere, traduit par A. Pinchot, Bruxelles, Belgique, 2006
[3] P. Elliott, La Porte d’Ambre, traduit par A. Pinchot, Bruxelles, Belgique, 2006
[4] P. Elliot, Murkmere, op. cit., p. 4 et P. Elliott, La Porte d’Ambre, op. cit., p. 4.
[5] L. Guyénot, La mort féerique: anthropologie du merveilleux, Paris, France, Gallimard, 2011, p. 17.
[6] P. Elliot, Murkmere, op. cit., p. 53.
[7] Id., p. 53.
[8] À ce propos, voir L. Guyénot, La Mort féerique : anthropologie du merveilleux, Paris, France, Gallimard, 2011 et P. Le Stum, Fées, korrigans et autres créatures fantastiques de Bretagne, Rennes, France, Ouest-France, 2001, p. 14 : « Les femmes et enfants-cygnes figurent dans des romans féeriques français des xiie et xiiie siècles. Ces textes fixèrent sans doute des traditions antérieures, dont la source la plus ancienne paraît appartenir à la mythologie irlandaise. Le sort de ces créatures, mi-humaines, mi-animales, est à rapprocher de celui de Mélusine […] ».
[9] Nous pensons par exemple au conte de « Pipi Menou et les femmes volantes » reccueilli par F.-M. Luzel dans ses Contes populaires de la Basse-Bretagne en 1887 dans lequel un jeune garçon observe les transformations de trois jeunes filles en cygnes.
[10] J.-R. Valette, « Pour une poétique du personnage merveilleux : la fabrique des fées », dans C. Connochie-Bourgne (éd.), Façonner son personnage au Moyen Âge, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, « Senefiance », 2014, p. 339‑349.
[11] L. Guyénot, La mort féerique, op. cit., p. 28.
[12] P. Elliot, Murkmere, op. cit., p. 16.
[13] P. Elliott, La Porte d’Ambre, op. cit., p. 10.
[14] Id., p. 327.
[15] P. Elliot, Murkmere, op. cit., p. 299.
[16] Dans l’imaginaire Gallois, c’est une entrée souterraine qui donne accès au Paradis et aux Enfers.
[17] P. Elliott, La Porte d’Ambre, op. cit., p. 354.
[18] Nous employons le terme de « motifs indiciels » comme l’entend Francis Dubost sur ces éléments qui ne comportent pas de spécificités merveilleuses ou même surnaturelles mais qui par leur prédicat, leur nomination ou le contexte laissent cependant pressentir au lecteur la portée surnaturelle de cet élément. Voir à ce propos, F. Dubost « Les motifs merveilleux dans les Lais de Marie de France » in J. Dufournet et, Amour et merveille: les « Lais » de Marie de France, Paris, France, H. Champion, 2013.
[19] L. Guyénot, La Mort féerique, op. cit., p. 128.
[20] Id., p. 127.
[21] Id., p. 127.
[22] Id., 271-272.
[23]Le Goff J. « Au Moyen Âge, le merveilleux est bien réel », L’Histoire, « Les Collections de l’Histoire », no 36, Héros et merveilles du Moyen Âge, juil.-sept., 2007, p. 7-14
[24] Id., p.7-14.
[25] P. Elliott, La Porte d’Ambre, op. cit., p. 138.
[26] Id., p. 259.
[27] Id., p. 259.
[28] Pour exemple : - La légende des Avias, chuchotai-je, quelle est sa véritable lecture ? / Le reflet des flammes dansait sur son crâne. Ses joues creuses et ridées formaient deux crevasses obscures. / - Les hommes inventent des légendes pour exprimer la réalité telles qu’ils la voient. Les deux lectures ont un sens demoiselle. Tout dépend de l’idée que tu te fais du Tout-Puissant, si tu Le vois comme un dieu de pardon ou de punition. / - Mais les Avias sont-ils réels ou issus de l’imagination de l’homme ? […] / - J’ai connu des hommes qui les ont vus. / - Ils ont vu les Avias ? / - Oui, c’est ce qu’ils prétendent. / - Ainsi, l’antique légende reflète une réalité. / - Un homme pourrait les voir, l’autre pas. Chacun voit les choses à sa manière, petite demoiselle (P. Elliot, Murkmere, op. cit., pp.270-271).
[29] P. Elliott, La Porte d’Ambre, op. cit., p. 355.
[30] Id., p. 11.
[31] Id., p. 75.
[32] Id., p. 73.
[33] Id., p. 81.
[34] N. Prince, Le Fantastique, Paris, A. Colin, « 128 », 2015, p.26.
[35] Voir à ce propos Nathalie Prince (id., p. 29) : « Avec le merveilleux, l’ordre du monde est préservé ; avec le fantastique il est chamboulé ».
[36] Toute manifestation liée au désir de voler et ainsi à celui de la transgression et de l’hybris est immédiatement réprouvé. Mais Murkmere met habillement en place une tension entre interdit et fascination des manifestations célestes et aériennes, mais non divines, de la même manière que Jean-Pierre Legay l’a explicitée dans les considérations médiévales. A ce propos, voir J.-P. Leguay, L’Air & le vent au Moyen âge, Rennes, France, Presses universitaires de Rennes, 2011.
[37] P. Elliott, La Porte d’Ambre, op. cit., p. 163-164.
[38] P. Hartmann et F. von Schiller, Du sublime: de Boileau à Schiller, Strasbourg, France, Presses universitaires de Strasbourg, 1997, p. 29.
[39] P. Elliott, La Porte d’Ambre, op. cit., p. 163.
[40] Id., p. 164.
[41] Id., p. 350.
[42] F. von Schiller, « Über das Erhabene », traduit par P. Hartmann, in Du Sublime, op. cit., p. 176.
[43] Id., p. 29.
[44] P. Elliott, La Porte d’Ambre, op. cit., p. 355.





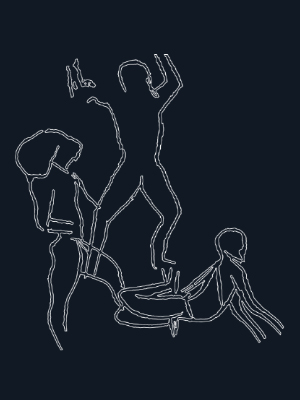

 DOAJ
Content
DOAJ
Content



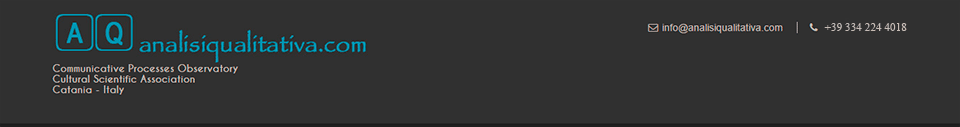
newsletter subscription
www.analisiqualitativa.com