
L’addiction : un mythe, une maladie ou un fléau social contemporain ?
Johanna Järvinen-Tassopoulos (a cura di)
M@gm@ vol.14 n.1 Gennaio-Aprile 2016
CONCEPTUALISER L’ADDICTION : ENTRE L’ÉCUEIL DU MYTHE ET CELUI DE LA
« MALADIE COMME LES AUTRES »
Mélanie Trouessin
melanie.trouessin@ens-lyon.fr
Doctorante en philosophie à l'ENS de Lyon en troisième année, mon travail de recherche porte sur l'addiction, en particulier sur la comparaison entre des paradigmes du modèle moral philosophique (la faiblesse de la volonté) et du modèle médical (la maladie cérébrale). Le titre de ma thèse est: "L'addiction comme pathologie de la volonté: repenser la faiblesse de la volonté à la lumière des Sciences Cognitives". Je donne en parallèle un cours de philosophie des sciences à des élèves de deuxième année de Sciences Cognitives à l’université Lyon 2 et un cours alterdisciplinaire à l’ENS de Lyon, sur les questions philosophiques suscitées par le concept de maladie.
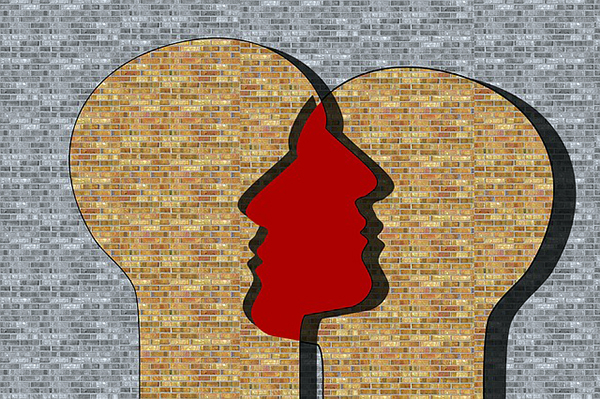 Image : Pixabay CCO Public Domain |
Introduction
Déclarer que l’addiction est un mythe peut signifier la considérer comme une illusion, terme souvent pris pour un synonyme de mythe dans son sens large contemporain. Le mythe, c’est ce qui est affirmé comme réel par certains mais qui n’est pas tangible, tel le monstre du Loch Ness, que Reinarman compare à l’addiction : beaucoup disent l’avoir entraperçu, sans qu’on n’ait jamais réussi à prouver son authenticité, comme c’est le cas pour l’addiction, dont les symptômes et l’étiologie resteraient mystérieux (Reinarman, 2005).
Mais le terme de mythe possède aussi un sens fort quand il est utilisé dans les temps primitifs pour raconter, de manière non rationnelle mais imagée l’origine d’un phénomène, et répondre au besoin d’une collectivité ou en assurer la cohésion. En ce sens, affirmer que l’addiction pourrait bien relever du mythe amène aussi à s’interroger, au-delà du simple scepticisme à propos de l’addiction, sur les raisons voire la nécessité d’un tel mythe.
Il y a parfois chez ceux qui critiquent l’addiction un lien entre ces deux sens de mythe : elle aurait été créée pour répondre à quelque chose, dans un cadre culturel précis, et donc ne correspondrait à rien dans la réalité. A ce stade, une distinction essentielle s’impose entre l’idée d’addiction et le phénomène de l’addiction lui-même. On pourrait ainsi refuser l’idée, parce qu'elle serait le résultat d’une construction, sans refuser le phénomène qui, quant à lui, semble bien réel car observable empiriquement, bien que regroupant des instances variées et diverses. Ce qui est souvent critiqué lorsque l’on affirme que l’addiction est un mythe semble surtout être cette idée que l’on pourrait regrouper sous un concept unique toute une myriade de comportements, de la consommation d’héroïne ou d’alcool au shopping pathologique en passant par la bigorexie. Que de tels phénomènes existent, soit, mais qu’ils soient des instances d’un seul et unique concept, voilà ce qui relèverait du mythe.
Ce n’est d’ailleurs pas n’importe quel concept qui est visé mais celui qui fait de l’addiction une maladie. Nous ne disons pas ici que la totalité des partisans de l’addiction comme mythe visent la conception de l’addiction-maladie mais nous pensons qu’il s’agit cependant de la cible principale. Partisans de l’addiction-maladie et tenants de l’addiction-mythe semblent se disputer la question de la réalité de l’addiction depuis plus de deux siècles, sans que l’on soit parvenu à un consensus, tant les auteurs restent campés sur leurs positions, ce qui peut paraître étonnant étant donné la production de preuves biologiques de plus en plus conséquente (Vrecko, 2010).
On peut comprendre la virulence du débat parce que l’enjeu est de taille : c’est celui du statut de l’addict en matière de responsabilité. Une des idées majeures des conceptions sceptiques de l’addiction est en effet que « l’addiction serait une excuse pour pouvoir consommer de la drogue » (Carter & Hall, 2011). Bien que toutes ces conceptions ne consistent pas forcément en un retour à une perspective moralisatrice, certaines insistant sur les raisons que peuvent avoir les addicts, on peut cependant noter une corrélation forte entre scepticisme et modèle moral de l’addiction, qui revendique une responsabilité nette des addicts. Au contraire, les conceptions de l’addiction comme maladie – culminant avec la conception de l’addiction comme maladie cérébrale à partir du milieu des années 1990 – ont œuvré dans le sens d’une déstigmatisation des personnes addictes, arguant de ce qu’elles sont impuissantes devant une force émanant de la substance psychoactive. Cependant, dans leur détermination à contrecarrer le stigma attaché à l’addiction – et de manière plus générale à la plupart des maladies mentales – les conceptions de l’addiction-maladie semblent porteuses d’une tendance à la normalisation parfois excessive, qui se traduit dans des slogans de type « les maladies mentales sont des maladies comme les autres » (Rapport « Prévention des maladies psychiatriques », 2014). Il peut ainsi sembler que certains chercheurs, dans leur lutte contre l’idée de mythe de l’addiction, afin d’affirmer sa réalité comme maladie, risquent de tomber dans l’écueil de la normalisation qui nierait la spécificité de l’addiction et pourrait donc rendre difficile l’adoption d’un traitement adéquat. Nous pensons au contraire que certains éléments – justement parmi ceux pointés par les sceptiques de l’addiction – gagnent à ne pas être écartés du champ de la recherche scientifique sur l’addiction, car ils ont le mérite de soulever des points qui restent problématiques pour les conceptions de l’addiction-maladie. En particulier, la notion de « perte de contrôle » ou de compulsion nous semble être une notion-clé autour de laquelle s’articulent arguments en faveur et contre la conception de l’addiction-maladie. La perte de contrôle dans l’addiction a d’abord été étayée par le phénomène de dépendance physiologique et les symptômes de manque et de tolérance, puis par celui de dépendance psychologique ou de compulsion, parce que les addictions comportementales ont relativisé la dépendance physique en en faisant un symptôme possible mais non nécessaire ni suffisant pour affirmer que l’addiction est une maladie. Dans cette optique, les neurosciences revêtent une importance particulière parce qu’elles révèlent la possibilité de maladies pour lesquelles il n’y aurait pas de lésions observables mais simplement des troubles fonctionnels. Le point culminant est la conception de l’addiction comme maladie cérébrale au milieu des années 1990 qui en fait une maladie dont la caractéristique centrale est « la recherche et la consommation compulsives d’une substance » c'est-à-dire la perte de contrôle. De nombreuses voix s’élèvent aujourd'hui contre ce genre de conceptions, arguant de ce que la perte de contrôle dans l’addiction serait une illusion, ramenant ainsi l’addiction du côté du mythe.
Si nous réfutons l’idée que l’addiction puisse être un mythe, à la fois comme phénomène et comme idée, nous pensons que les conceptions sceptiques de l’addiction ont le mérite de pointer des problèmes cruciaux sur lesquels un modèle de l’addiction ne peut faire l’impasse, notamment quant au concept de perte de contrôle. Si l’addiction n’est pas un mythe, alors est-elle pour autant une maladie et si oui, quel type de maladie ? Peut-elle être considérée comme une maladie véritable sans pour autant devoir être considérée comme une maladie comme les autres ?
Avant tout, nous approfondissons ces deux conceptions antagonistes de l’addiction, comme mythe et comme maladie, en identifiant trois séries principales d’arguments contre l’addiction-maladie – la liste n’étant point exhaustive – et les problèmes que cela met en exergue. Ensuite, nous remontons à ce qui nous semble être la source de leur aspect apparemment irréconciliable : l’adoption d’un double présupposé commun sur la théorie générale de la maladie et sur le mécanisme plus particulier de la perte de contrôle ou de l’impuissance de la volonté dans l’addiction. Enfin, nous suggérons une autre manière de concevoir la maladie en général comme la maladie addictive, en insistant sur le rapport étroit qu’il y a entre la pathologie et l’action et en redéfinissant la notion de perte de contrôle.
I. L’addiction entre mythe et maladie : un double écueil
La naissance des conceptions sceptiques au sujet de l’addiction et sa labélisation en tant que mythe sont plutôt récentes ; selon Vrecko, elles seraient concomitantes d’un mouvement général de remise en question de la psychiatrie dans les années 1960, sous le giron du mouvement antipsychiatrique. L’antipsychiatrie interroge la validité du concept biomédical de la maladie au mental et son univocité pour le physique et le mental (Giroux, 2011) et considère les étiquette de désordres mentaux comme les expressions de purs jugements de valeur. Pour Szasz en particulier, « la maladie ne peut affecter que le corps » et il ne peut exister quelque chose comme une maladie mentale, le terme ne référant qu’ « à un désagrément, qualifié métaphoriquement de maladie » : dans la pratique, les psychiatres ont affaire à des « problèmes personnels, sociaux et éthiques de l’existence » (Szasz, 1972). L’addiction constitue à ce titre un paradigme : les personnes boivent en excès en raison de « problèmes de l’existence humaine » (problems in human living) mais cette consommation excessive n’est pas une maladie mais une « mauvaise habitude », considérée comme un comportement étrange selon les standards sociaux. Pour Szasz, on utilise cette étiquette bien commode de la maladie mentale pour marquer ce type de comportements qui détonnent dans la société, mais l’important est que ce marquage est dépendant du contexte social et culturel dans lequel il est fait.
Les arguments
Ainsi, une première série d’arguments critique le fait que la notion d’addiction, dont la plupart sont d’accord avec Levine pour situer la naissance à la fin du XVIIIème siècle (Levine, 1978), soit le résultat d’une construction socioculturelle donc soit une idée culturelle, non réelle. La plupart des sceptiques à propos de l’addiction s’inscrivent, à l’intérieur du champ des sciences humaines et sociales, dans une perspective de déconstruction selon laquelle les concepts en général ne désignent pas des choses réelles mais sont le résultat d’une construction sociale, et le concept d’addiction ne déroge pas à la règle.
La façon dont nous concevons l’addiction serait relative et fondamentalement liée au cadre historique et culturel dans lequel son idée est née. Non seulement toutes les cultures ne font pas des substances et de leur consommation excessive un problème ou une maladie, mais encore, c’est une idée proprement occidentale que de concevoir que certains comportements et substances ont le pouvoir de nous ôter tout contrôle sur nos actions : « l’attribution de la perte de contrôle est une attribution spécifiquement culturelle » (Reinarman, 2005).
Les tenants de l’addiction-mythe mettent en lien la perte de contrôle avec les valeurs phares de l’époque occidentale moderne savoir l’individualité et le contrôle de soi : l’addiction et ces valeurs seraient l’avers et le revers d’une même médaille. Dans un article de 2000, Peter Cohen s’attache à mettre ce lien en évidence et voit l’origine de ce mythe de l’addiction dans le besoin de placer notre croyance en quelqu'un ou quelque chose : puisque nous ne croyons plus au diable, ni aux fantômes, ni à la magie – ou à tout dieu de tout système religieux – nous ne pouvons plus croire qu’en nous-mêmes et en notre pouvoir de s’auto-diriger et de s’autocontrôler. Dans ce contexte, nous devons trouver une explication aux possibles échecs de notre pouvoir sur nous-mêmes et c’est là qu’intervient l’idée d’addiction selon Cohen :
« Le concept d’addiction est un produit dérivé (by-product) nécessaire du concept d’individu ; un produit dérivé dont la plupart d’entre nous ont besoin, mais non pas quelque chose qui fait référence à un phénomène qui ‘existe’ réellement en dehors de notre perception socialement construite (…). Dans notre vision du monde et notre environnement culturel d’un individu s’auto-dirigeant, indépendant et entreprenant, c’est la ‘perte de contrôle’ qui est le mal suprême qui doit être reconnaissable et doit pouvoir être exorcisé »[1].
Cohen continue en expliquant que le concept d’addiction permet de valider notre vision du monde et nos théories sur l’individu, en rejetant l’absence de contrôle de soi aux marges et en l’expliquant par une force irrésistible d’une substance ou d’un comportement. Il suggère un lien de causalité entre cette relativité socioculturelle et l’addiction comme mythe, n’existant pas ou du moins, pas en dehors d’une construction socioculturelle donnée.
Cependant, si nous pouvons admettre la dimension intrinsèquement culturelle et sociale de nos concepts de santé et de maladie, il ne nous semble pas que cela remette en cause l’existence même des phénomènes pathologiques. Certes, il apparaît clairement que certaines pathologies sont liées aux valeurs portées par la société occidentale, comme par exemple l’anorexie (Darmon, 2003 ; Ascher, 2005). Les pays occidentaux ne sont d’ailleurs pas les seuls à avoir leurs maux propres : la psychose Windigo, le trouble Zar ou encore le Brain Fog seraient des troubles caractéristiques d’autres sociétés. Bien que la relativité culturelle de certains troubles mentaux soit quasi indubitable, cela ne remet pas en cause leur statut pathologique, d’autant que la plupart des troubles se retrouvent le plus souvent ailleurs sous une autre forme. Ainsi, qu’un phénomène pathologique ait une histoire et une culture, et qu’il soit géographiquement situé, ne semble pas suffire pour critiquer son statut de maladie : de nombreux chercheurs montrent que certaines maladies sont liées à des époques particulières et concernent des lieux en particulier ; pour François Laplantine par exemple, tous les discours sur la santé et la maladie comprennent une part de représentation sociale et culturelle irréductible (Desforges, 2001). Elodie Giroux dresse également ce constat que l’idée d’une démarcation naturelle – et donc anhistorique, puisque non forgée par le culturel – est facilement critiquable. Elle donne l’exemple de l’addiction qui met bien en évidence « la relativité historique et sociale des jugements présidant à la catégorisation d’un état ou d’un comportement comme normal ou pathologique » (Giroux, 2010). L’addiction ne ferait finalement pas exception dans l’ensemble des maladies et aurait bien une histoire, liée à un contexte socioculturel particulier, sans que cela remette en cause le fait qu’elle soit une maladie. Mais, bien que née dans un contexte socioculturel donné, l’addiction a-t-elle vu son sens se fixer de manière déterminée comme pour les autres maladies ? C’est ce qu’il ne semble pas selon les tenants de l’addiction comme mythe.
Une seconde série de critiques concerne alors le caractère flou et élastique du concept de maladie appliqué à l’addiction encore aujourd'hui. Ici, l’addiction est considérée comme mythe car elle ne fait pas l’objet d’une définition objective ni déterminée mais au contraire d’une définition malléable, c'est-à-dire qui n’a pas cessé de se modifier au fil du temps et qui ne s’est toujours pas fixée de manière définitive. Les grandes classifications comme celles du DSM ou de l’OMS, en ne rendant nécessaires que quelques critères parmi d’autres dans une longue liste, témoignent de cette « absence d’étiologie intrinsèque à l’addiction » (Reinarman, 2005) et de ce que des comportements pourraient être qualifiés d’addictifs sans remplir les mêmes critères. Quels critères sont donc essentiels et lesquels secondaires pour définir l’addiction ? Comment être sûr que les phénomènes que l’on qualifie actuellement d’addictifs puissent véritablement être mis sous cette étiquette ? Peut-on être sûr qu’ils n’en modifient pas la compréhension et l’extension ? Ces questions se posent de manière aiguë surtout depuis l’émergence des addictions comportementales, où une substance psychoactive n’est pas en jeu, mais où une phénoménologie identique est présente, notamment le sentiment de perte de contrôle sur son comportement. Le modèle psychosocial de Peele a démocratisé l’extension de l’étiquette d’addiction aux comportements, arguant que ce qui est central dans l’addiction, c’est l’expérience de plaisir et le sens que cela a pour l’individu. On voit cette concomitance entre l’addiction comme mythe et l’extension chez un auteur comme Schaler par exemple, qui étend l’addiction à pratiquement toutes les activités :
« Certaines personnes peuvent être addictes à la musique, d’autres aux livres, d’autres aux promenades à la campagne. Certains sont addicts à une doctrine ou une communauté religieuse (…). D’autres sont addicts à une philosophie politique (…) ou à une ‘cause’, comme les droits des animaux ou le libre-échange. Certains sont addicts à une autre personne (…). Michelangelo était addict à la peinture et à la sculpture, Einstein était addict à la physique … »[2]
Devant cette possible extension à l’infini, qui possède nous semble-t-il l’inconvénient de confondre addiction et passion, des critiques se sont élevées et des conceptions purement biologiques comme celle de l’addiction-maladie cérébrale ont restreint la notion d’addiction aux addictions avec substance, incluant parfois le jeu pathologique (le DSM-V entérine d’ailleurs cette inclusion). La question de savoir si les addictions avec substance et sans substance sont de même nature est une question cruciale, qui pose de manière aigüe la question de l’unité et de la malléabilité de la notion d’addiction. Les implications que cela pose sont bien résumées dans l’introduction d’un livre récent, issu de la sociologie, sur les perspectives critiques de l’addiction :
« Le terme d’addiction possède une élasticité conceptuelle qui lui permet d’être déployée de manière stratégique, non seulement pour expliquer un large éventail de comportements, mais aussi en tant qu’outil de coercition et de contrôle sociaux »[3].
D’une part, le fait que l’on pourrait devenir addicté à tout (Peele, 1985) parle en faveur d’un scepticisme car si nous commençons à faire de toutes nos activités des pathologies, alors où est la limite ? Ce risque est bien perçu par Szasz ici :
« La consommation excessive d’alcool est une habitude. Selon les valeurs de la personne, elle peut la considérer comme une bonne ou une mauvaise habitude. Si nous choisissons d’appeler les mauvaises habitudes des maladies (diseases), il n’y a plus aucune limite à comment définir une maladie et aux traitements involontaires »[4].
D’autre part, l’extension du terme d’addiction à une myriade de comportements a aussi un inconvénient grave du point de vue de la gestion de ces comportements par la société, qui serait instrumentalisée au profit de formes parfois extrêmes de coercition et de contrôle social sur les individus, ainsi que de politiques publiques prohibitionnistes. Szasz est ainsi bien connu pour sa critique de la psychiatrie selon laquelle elle déguiserait sous des jugements cliniques en termes de santé et de maladie mentale ce qui ne serait en fait que des normes éthiques et sociales, afin de contenir les personnes déviant de ces normes. Szasz insiste sur le fait que ce sont les psychiatres qui définissent eux-mêmes ces normes et donc la déviation, ce qui fait qu’ils peuvent instrumentaliser leur jugement pour contrôler des individus. A ce titre, les individus qui consomment de la drogue ou s’intoxiquent avec de l’alcool sont considérés selon Szasz comme des « boucs émissaires » que l’on rejette aux marges de la société pour permettre à celle-ci de continuer à fonctionner. Puisque l’individu a perdu le contrôle sur sa consommation, il faut l’aider même contre son gré à rétablir ce contrôle. Ainsi, les tenants de l’addiction comme mythe s’attachent très souvent à remettre en question cette notion chère aux conceptions médicales, la perte de contrôle : si cette notion est un mythe alors la coercition sur les addicts n’est plus justifiée.
Une troisième ligne de critiques, la principale, concerne ainsi la notion de perte de contrôle qui est quasi unanimement considérée comme le cœur de l’addiction. A ce stade, il faut rappeler quelque chose de fondamental : la critique de l’addiction comme mythe a évolué de manière concomitante avec l’évolution de la conception de l’addiction-maladie. Ainsi, lorsque l’addiction est au départ centrée sur la dépendance physiologique, avec la souffrance engendrée par la tolérance et le manque, c’est par le mythe de la « cold turkey » ou du sevrage brutal que l’addiction est dénoncée, par exemple chez Fingarette : les symptômes de manque ne sont pas si douloureux et certains arrivent à sortir de l’addiction sans grande difficulté et parfois même sans aide extérieure. Ce genre de critique a été réactivé récemment par Mike Fitzpatrick à partir du témoignage de personnes n’ayant pas souffert de forts symptômes de manque après l’arrêt de l’héroïne, signe pour lui que « casser ces mauvaises habitudes n’est peut-être pas si difficile qu’il n’y paraît » (Fitzpatrick, 2003). Cependant, avec l’émergence des addictions comportementales, la dépendance physiologique n’est plus pour la majorité des chercheurs considérée comme le cœur de l’addiction (même si elle en reste une composante importante). C’est alors la notion de compulsion ou de désir impérieux, en faveur d’une dépendance psychologique, qui a fait l’objet d’une véritable déferlante de critiques : il n’existe pas de désir qui soit irrésistible, tout au plus certains désirs peuvent-ils être difficiles à résister mais ils n’ont pas la capacité d’ôter toute liberté (Foddy, 2011). Démontrer que la notion de perte de contrôle n’est qu’une illusion ou une manifestation de mauvaise foi de la part des addicts s’avère être une des stratégies principales mises en place pour révéler que l’addiction est un mythe. Par exemple, pour Davies, l’addiction est un mythe parce qu'elle est le résultat d’un processus de « réification », « processus par lequel un symbole sémantique utile devient une entité à laquelle on attribue une existence réelle » (Davies, 1992). Ce processus est illustré par la postulation du craving, que les personnes disent ressentir pour expliquer pourquoi elles continuent leur comportement addictif. La recherche sur l’addiction, selon Davies, fait un usage naïf des self-reports des addicts qui vont nécessairement dire qu’ils sont impuissants face aux désirs addictifs pour échapper au blâme. Mais cette image ne fonctionne que parce que nous le voulons : nous croyons les addicts sur parole alors qu’il n’y a aucune preuve du craving que l’on peut inférer à partir du comportement. Certes, aujourd'hui, les neurosciences nous apportent des preuves plus « biologiques » sur le dysfonctionnement du système exécutif au profit du système impulsif, qui aurait tendance à prouver effectivement la compulsion (Noël & Bechara, 2006). En revanche, les neurosciences ne prouvent pas qu’il y ait une négation réelle de la volonté. En outre, cette perte de contrôle n’interviendrait qu’après un usage répété du comportement addictif. Or, l’entrée dans l’addiction est, elle, bel et bien volontaire.
Les sceptiques utilisent ainsi l’argument de la non-immédiateté de la perte de contrôle pour défendre la thèse de l’addiction comme mythe. La perte de contrôle, qui serait le symptôme final d’une progression inévitable de la maladie, est selon les sceptiques le fer de lance de ce « mythe élaboré », que résume ici Fingarette :
« Le symptôme crucial se développe : ‘la perte de contrôle’ (…). A ce stade, dès que la personne prend un verre, l’alcool déclenche automatiquement une incapacité à contrôler la boisson (…). De là s’ensuit un profond esclavage à l’alcool, qui dévaste la vie sociale, provoque la ruine financière et peut aller jusqu’à la mort »[15].
Avant cela, les sceptiques mettent en exergue l’idée qu’un comportement addictif, même avec des substances au potentiel dit très addictif comme l’héroïne ou le crack, est toujours le résultat d’une « trajectoire » ou d’une « carrière » (Becker), c'est-à-dire d’un apprentissage des gestes et rituels d’une consommation ou activité comme c’est le cas pour le fumeur de marijuana. En d’autres termes, il faut de nombreux efforts volontaires pour commencer un comportement addictif. Les tenants de l’addiction comme mythe partagent ainsi cette idée qu’il faut arrêter de considérer que l’addiction serait « quelque chose qui arrive aux gens » et qui serait « imposé de l’extérieur par les propriétés pharmacologiques d’une substance étrangère » : au contraire, « les gens prennent des drogues parce qu'ils le veulent et parce que cela a un sens pour eux, étant donné les choix disponibles » (Davies, 1992). Si certains sceptiques semblent ainsi adhérer à une perspective moralisante sur l’addiction, qui servirait d’excuse pour s’absoudre du blâme, ce n’est pas le cas de tous les partisans de l’addiction comme mythe qui reconnaissent souvent que l’addict possède des « raisons » pour agir ainsi et que ces raisons traduisent souvent un contexte difficile, des « problèmes dans l’existence humaine » selon Szasz. Selon ce dernier, il semble qu’il faudrait distinguer plusieurs types de responsabilités dans l’addiction :
« C’est une chose de maintenir qu’une personne n’est pas responsable d’être un alcoolique ; c’en est une autre de maintenir qu’elle n’est pas responsable pour les conséquences interpersonnelles, occupationnelles, économiques et légales de ses actions »[6].
Il peut paraître difficile de scinder ainsi la responsabilité, mais c’est ce que suggère une thèse comme celle de l’automédication par exemple. Nous ne sommes pas responsables de ce que nous avons quelque chose à soigner, mais seulement du moyen que nous utilisons et de ses conséquences. Nous utilisons alors l’addiction à dessein, de manière intentionnelle, pour soigner un mal préexistant : même dans ces circonstances, l’addiction reste un choix de l’agent, puisqu’elle est un moyen utilisé pour une fin qui peut être la réduction de souffrance par exemple.
Le phénomène du maturing out où des individus addicts arrivent à sortir de l’addiction à un certain moment, sans aide extérieure, mais par leurs ressources internes est à cet égard souvent utilisé par les tenants de l’addiction comme mythe pour montrer que l’addiction n’est pas une maladie. Fingarette avant l’émergence du terme de maturing out parlait d’amélioration naturelle (natural improvment), c'est-à-dire d’amélioration indépendante de tout traitement mais liée seulement au changement de certains facteurs comme le fait d’avoir un emploi plus régulier ou le fait de se marier (Fingarette, 1988). Le changement de contexte et la perception de nouvelles alternatives possibles rendraient l’addiction caduque, ce qui semble a priori jouer contre l’idée que l’addiction serait une maladie.
Le double écueil : le risque de stigmatisation face au risque de normalisation
De nombreux arguments sont avancés contre l’addiction-maladie par les tenants d’un scepticisme à propos de l’addiction : notre avis est qu’ils ciblent des problèmes précis des conceptions médicales de l’addiction sans pour autant réussir à établir que l’addiction est bel et bien un mythe. Le phénomène du maturing out est particulièrement éclairant à cet égard : s’il montre que l’addiction pourrait remplir une fonction pour l’individu et donc disparaître dès le moment où cette fonction serait satisfaite autrement, cet argument ne parvient pas à réfuter l’idée de l’addiction comme maladie mais seulement sa caractérisation en tant que maladie incurable (Benn, 2007). Les sceptiques dénoncent ainsi ce mythe du « addict un jour, addict toujours » et l’idée que la guérison de l’addiction soit à jamais impossible.
Or la donne commence aujourd'hui à changer sur ce point, sans forcément remettre en cause l’idée de maladie addictive. L’addiction peut être considérée comme une maladie, comme un état pathologique, mais le retour à un état normal peut être possible : c’est tout l’enjeu aujourd'hui de ce qu’on appelle la « réduction des risques », qui s’oppose en matière de politique publique à la promotion du prohibitionnisme et de l’abstinence, dont les politiques de « jeu responsable » en sont des exemples importants.
Dire ceci implique le risque d’un retour à une perspective morale, un risque globalement présent dès que nous acceptons de prendre sérieusement en compte les objections des tenants du mythe de l’addiction. En effet, dire qu’un comportement pathologique peut revenir à un stade normal implique qu’il revient à l’individu de prendre les mesures qui s’imposent pour y parvenir et qu’il est responsable de l’échec ou de la réussite de cette entreprise. Une majorité des conceptions de l’addiction comme maladie tentent au contraire de s’opposer à tout risque de stigmatisation de l’individu, quitte à parfois éluder le rôle de l’individu dans leur processus de guérison (un rôle qui n’est d’ailleurs pas présent que dans l’addiction). Pour Marc Valleur, dire que l'alcoolisme est une maladie est avant tout « un acte volontaire, un énoncé performatif à visée politique, tendant à invalider, sinon à supprimer, du moins à atténuer ou alléger la charge de stigmatisation religieuse ou morale affectée, depuis la nuit des temps, à l'ivrognerie » (Valleur, 2009). De nombreuses campagnes se sont données pour but, depuis une vingtaine d’années au moins, d’amener la société à une nouvelle compréhension des maladies mentales, c'est-à-dire d’en faire « des maladies comme les autres », sous-entendu organiques. L’on trouve souvent ce genre de slogans dans les articles scientifiques consacrés à l’addiction : « l’addiction n’est pas un problème de volonté mais une maladie comme les autres ». La volonté de déstigmatiser passe donc par la normalisation, et la normalisation par l’identification de racines organiques au problème, comme dans les autres maladies. Cette normalisation est très visible dans le modèle de l’addiction comme maladie cérébrale développée au milieu des années 1990 par Leshner, alors président du NIDA, et qui déclarait alors que « l’addiction doit plutôt être approchée comme les autres maladies chroniques – telles que le diabète ou l’hypertension » (Leshner, 1994).
Non seulement cette assimilation est problématique parce que le diabète comme l’hypertension sont également des maladies liés au mode de vie, qui tendent à définir l’addiction plutôt comme facteur de risque pour une maladie que comme maladie, mais encore dire que l’addiction est une maladie « comme les autres » implique qu’elle soit de même nature que les maladies somatiques. C’est la tendance à faire des maladies mentales des maladies neurologiques, qui culmine avec la conception de l’addiction comme maladie cérébrale c'est-à-dire comme fondamentalement « liée au dysfonctionnement du cerveau et non aux drogues », ou « neurologique et non liée à des facteurs externes » (ASAM, 2011).
Face à cette tendance biologisante de la psychiatrie, des critiques au sein même des sciences de l’addiction émergent. La conception de l’addiction comme maladie cérébrale est d’ailleurs loin d’être prédominante dans le champ des neurosciences elles-mêmes et que son influence résulte de ce que la plupart des financements alloués aux Etats-Unis l’ont été au NIDA, qui est l’organisme au sein duquel cette conception a principalement émergé. Il faut donc faire attention à ce genre de compréhension de l’addiction, qui à l’extrême inverse des conceptions sceptiques, font de l’addiction un phénomène quasiment entièrement biologique.
En définitive, les principaux arguments pour affirmer que l’addiction est un mythe – par ordre de puissance de conviction : le caractère socioculturel et relatif de l’addiction, son aspect flou et malléable et enfin la remise en cause de la perte de contrôle – ne parviennent pas selon nous à établir de manière définitive que l’addiction et en particulier l’addiction-maladie n’existe pas. Il faut selon nous éviter l’écueil selon lequel parce qu’un concept serait mal défini, le phénomène qu’il vise n’aurait aucune réalité, c'est-à-dire l’écueil du mythe. Pour autant, les réactions face au scepticisme à propos de l’addiction nous semblent faire état d’un écueil tout aussi grave, selon lequel l’addiction serait une maladie comme les autres, sans place pour la volonté et l’intentionnalité, ce que les arguments sceptiques ont pointé du doigt avec raison. Il faut prendre en compte ces éléments pour tenter de progresser quant à la question de la nature de l’addiction, ce qu’a bien compris le sociologue Patrick Pharo :
« Bien qu’on fasse souvent ce genre de comparaison, la maladie du cerveau ne paraît pas être du même ordre que des maladies chroniques telles que l’asthme, l’hypertension ou le diabète, puisqu’il est possible, même si c’est très difficile, de faire disparaître par une simple décision le principal symptôme de l’addiction qui est la consommation compulsive de quelque chose, alors que c’est totalement impossible pour les autres maladies chroniques »[7].
Le statut particulier de la maladie addictive tient justement au fait qu’elle implique l’agentivité, pas forcément sous la forme d’une décision rationnelle optimale, mais au moins une forme minimale de marche de manœuvre. C’est ce lien entre pathologie et agentivité qui semble jusque-là avoir été peu appréhendé, parce que les deux semblent justement contradictoires, la maladie étant considérée habituellement comme privant l’individu de toute agentivité et de toute liberté. Or il nous semble qu’une compréhension adéquate de la notion d’addiction passe au contraire par la reconnaissance et la recherche d’un rapport plus fin entre les deux notions. Il nous semble que les conceptions de l’addiction comme mythe et celles comme maladie reposent sur des présupposés communs qui ne laissent pas d’autre possibilité et que l’on doit maintenant examiner.
II. L’adhésion commune à un double présupposé
Nous développons ici cette idée qu’il y a un présupposé qu’ont en partage les deux camps adverses et qui réside dans une mécompréhension des rapports entre théorie de l’action et théorie de la maladie, mécompréhension catalysée par la notion de perte de contrôle. D’une part, les deux camps semblent adhérer une conception de la maladie qui fait du biologique l’élément fondamental et du dysfonctionnement la preuve de la maladie. D’autre part, les tenants de l’addiction comme mythe et comme maladie semblent partager un présupposé sur le mécanisme précis de l’addiction selon lequel la volonté serait impuissante face à des désirs extérieurs à elle.
Il nous semble avant tout que la majorité des explications de l’addiction s’inscrivent – même si c’est pour le rejeter dans le cas de l’addiction – dans un modèle particulier de la maladie que l’on peut qualifier de naturaliste. Selon ce modèle, les normes et jugements de valeur n’ont qu’une place secondaire dans la qualification de comportements en maladies ; ce qui compte avant tout, c’est l’aspect biologique, c’est qu’il y ait un dysfonctionnement. Selon la définition naturaliste de la maladie, elle est un état interne de l’organisme découlant du fonctionnement anormal de certains de ses organes, la référence étant souvent la norme statistique (Boorse, 1977). La tendance naturaliste est la tendance la plus proche de la manière dont le sens commun définit la maladie, comme l’état du corps ou d’une de ses parties ou organes dont les fonctions sont perturbées ou détériorées. Il existe des critères biologiques qui permettent de définir la maladie et de délimiter objectivement le normal du pathologique. La conception de l’addiction comme maladie cérébrale est le paradigme ultime d’une adhésion au modèle naturaliste de la maladie puisqu’elle est alors comprise comme un dysfonctionnement cérébral ou l’altération de certains circuits neuronaux comme celui de la récompense ou celui de la mémoire. Du côté des sceptiques, il semble surtout que ce soit à l’application de cette conception de la maladie à l’addiction qu’ils s’attaquent. Pour Davies, la notion de bon sens de la maladie, qui fait référence à quelque chose qui est perturbé, ne peut jamais avoir comme conséquence « la capacité directe de forcer des gens à voler (…), à se piquer les bras avec une aiguille alors qu’ils essayent de ne pas le faire » (Davies, 1992). La notion naturaliste de la maladie semble donc être la référence commune en vertu de laquelle on accepte ou on refuse à l’addiction le statut de maladie.
En outre, à l’intérieur de ce cadre, il nous semble que modèles médicaux et conceptions sceptiques commettent une erreur quant à la perte de contrôle et à la volonté, qu’ils conçoivent comme unilatérale : soit l’individu veut l’addiction, soit il ne la veut pas mais est obligé par une force impérieuse de satisfaire les désirs addictifs. En d’autres termes, soit les addicts sont forcés d’agir, soit ils agissent de manière totalement volontaire – cette dichotomie est bien marquée chez Davies par exemple – mais remarquons qu’ils ne peuvent en même temps avoir de la volonté et souffrir de compulsion. Ce qui est intéressant surtout, c’est que l’obligation porte sur l’action : ‘ils sont forcés de le faire » (Davies, 1992). Dans la plupart des cas, on parle d’une perte de contrôle sur les actes et on comprend la compulsion comme la perte de la liberté au sens précis de liberté d’agir sans contrainte, la compulsion représentant justement une contrainte interne, psychologique. Il y aurait une force irrésistible qui obligerait l’addict à agir contre ce qu’il veut vraiment. Pour la conception médicale, les désirs addictifs sont pathologiques et le comportement addictif est donc involontaire.
Les sceptiques, quant à eux, refusent l’idée qu’une telle force sur l’individu puisse exister et arguant de ce qu’elle est avant tout une idée purement occidentale, qui ne serait que la forme moderne de la force qui était investie à celle des démons ou dieux de certains systèmes religieux, qui prenaient le contrôle voire possession de la personne et la faisait agir contre sa volonté. C’est donc le même schéma d’une volonté totalement impuissante face à une force extérieure à elle qui constitue le cadre de la perte de contrôle dans l’addiction, qui est ensuite soit accepté soit refusé respectivement par les tenants de l’addiction-maladie et par les sceptiques.
Nous pensons que cette notion de perte de contrôle est pensée dans les deux camps de manière trop unilatérale pour rendre compte du conflit intérieur qui semble animer les personnes addictes, qui pourraient peut-être en même temps à la fois vouloir et ne pas vouloir leur addiction. Nous suggérons que la théorie naturaliste de la maladie est insuffisante pour sortir de ce cadre unilatéral et proposons donc dans un dernier temps une esquisse de nouveau modèle pour penser l’addiction comme phénomène complexe.
III. Esquisse d’un nouveau modèle de l’addiction
Avant toute chose, force est de constater qu’il y a un lien très fort entre l’idée qu’une maladie est réelle si elle est ancrée dans quelque chose de biologique, ce dont témoigne l’attachement à la théorie naturaliste de la maladie, très proche du sens commun ou de l’intuition que l’on a de ce qu’est une maladie. C’est la raison pour laquelle les maladies mentales ont largement été – et sont toujours – remises en cause, parce qu'elles ne seraient expliquées par aucune lésion biologique identifiable, au contraire des maladies neurologiques et somatiques. La volonté de lever ce soupçon à l’encontre des maladies mentales s’est accompagnée depuis quelques décennies d’un processus de biologisation de celles-ci, auquel n’a pas échappé l’addiction, comme on l’a esquissé plus haut avec le modèle de la maladie cérébrale. Marc Valleur montre comment certains chercheurs, pour faire accéder les addictions comportementales au rang de véritables maladies, ont tenté de mettre en évidence des traces organiques dans le cerveau : selon Constance Holden, dès lors qu’une récompense même naturelle serait concernée, il y aurait le risque pour le cerveau de tomber dans l’addiction (Holden, 2001). Pour Marc Valleur, cela implique que la pathologie doit être organique pour être « vraie », un lien que l’on peut selon lui remettre en cause (Valleur, 2011).
C’est ce que fait le courant normativiste en philosophie de la médecine qui s’est attaché, contre le naturalisme, à mettre en avant l’importance, dans le jugement clinique, des normes et des jugements par rapport au biologique. Parce que ce courant cherche aussi à appréhender les concepts de santé et de maladie à partir de concepts pratiques de l’action, il nous semble être le cadre adéquat d’une réévaluation de l’addiction comme maladie, qui pourrait peut-être nous aider à la penser comme maladie réelle mais non nécessairement comme les autres. Dans cette nouvelle piste, nous nous attachons principalement à la théorie développée par Lennart Nordenfelt qui insiste sur la nécessité d’appliquer la théorie de l’action à la théorie de la santé, notamment mentale. En outre, bien que Nordenfelt n’aborde jamais le sujet de l’addiction dans ses principaux ouvrages (1995, 2000, 2007) et qu’il ne se définisse pas comme un « spécialiste de l’addiction », il a cependant suggéré dans un article de 2010 que le cadre normativiste pourrait aider à penser un concept de maladie non radical de l’addiction. En effet, dans « On concepts and theories of addiction », il reprend la critique effectuée par deux philosophes de la conception médicale standard (Savulescu & Foddy, 2010) mais n’est pas d’accord avec leur conclusion selon laquelle toute théorie de l’addiction comme maladie doit être remplacée par une « explication libérale de l’addiction » parce que celle-ci ne prend pas en charge les cas véritablement pathologiques d’addiction. Si Nordenfelt refuse avec eux que ce soient des altérations neurologiques qui soient à l’origine de la maladie addictive – c'est-à-dire la vision standard de l’addiction-maladie, inscrite dans le cadre naturaliste – il fait cependant l’hypothèse d’une théorie de la santé différente de la théorie conventionnelle et médicale – la théorie naturaliste – c'est-à-dire une théorie « holistique ». Le terme « holistique » fait référence à la conception normativiste plutôt « modérée » de la maladie qui a été développée par Fulford, Pörn et lui-même ; elle se distingue d’un normativisme radical, comme celui de Engelhardt, qui penserait la maladie exclusivement selon le ressenti subjectif et les normes sociales. Nous proposons ici, comme le suggère Nordenfelt dans son article de 2010 sans l’approfondir, de comprendre l’addiction comme une maladie dans le sens où elle diminue cette « capacité d’un sujet à réaliser ses buts ». D’autre part, la façon dont Nordenfelt repense les liens entre théorie de la maladie et de l’action l’a amené à repenser le concept de compulsion dans le champ de la maladie mentale. Nous nous servons de cette analyse pour donner un sens à l’idée que la volonté n’est peut-être pas unilatérale dans l’addiction et repenser la perte de contrôle.
Repenser l’addiction au sein d’une conception naturaliste holiste de la maladie nous permettrait donc de ne pas adhérer au présupposé commun des théories de l’addiction-maladie traditionnelles et des conceptions sceptiques. Que la théorie de la santé doive être holistique signifie qu’il faut considérer l’individu dans son entier et non seulement dans la fonction qui pourrait dysfonctionner : « une personne est en bonne santé si elle se sent bien et peut fonctionner dans son contexte social » (Nordenfelt, 1995). La notion de santé est liée par Nordenfelt à celles de bien-être et d’action, et est ainsi redéfinie comme la « capacité d’un sujet à réaliser ses buts », celle de maladie signifiant l’incapacité à le faire. Pour qu’une maladie soit réelle, il ne faut donc pas forcément qu’elle soit organique mais qu’elle soit quelque chose qui gêne ou entrave la réalisation de nos « buts vitaux » c'est-à-dire conjointement des aspirations et projets des individus et des conditions de vie qui permettent de « vivre un bien-être minimal et durable » (Nordenfelt, 2000). Il nous semble que l’addiction, parce qu'elle implique un processus de centration autour d’elle dans la vie de l’individu – elle est au centre de ses préoccupations et de sa vie – rentre dans la catégorie de ce qui empêche la réalisation des buts vitaux parce que l’assouvissement des désirs addictifs devenus illimités empiète sur la réalisation d’autres buts vitaux. L’addiction ne devient addiction que lorsqu’un déséquilibre se produit chez l’individu dans la réalisation des différents buts de sa vie : la focalisation autour de l’addiction semble permettre de lui accorder le statut de pathologie dans la mesure où elle entraîne une perte ou une diminution de la capacité à réaliser d’autres buts que ceux imposés par l’addiction. Il nous semble que le concept de centration est crucial dans l’addiction, et c’est d’ailleurs par ce concept que nous voulons suggérer, pour finir, une piste pour redéfinir la notion de perte de contrôle.
En effet, nous avions indiqué que les tenants de l’addiction comme maladie radicale et ceux de l’addiction comme mythe semblaient voir la perte de contrôle comme une perte de contrôle sur les actes, ce qui ferait de l’addict un automate dont l’intentionnalité de l’action et la volonté seraient niées. Mais les addicts perdent-ils vraiment le contrôle de leur comportement en ce sens-ci ? Comment comprendre alors la série d’actes complexes impliqués dans l’addiction (recherche de la substance ou du comportement, rituel de la consommation etc.) si l’addict n’est effectivement pas maître de ses actes ? A la place, nous pensons que si l’addict perd le contrôle, c’est avant tout sur ses pensées : la focalisation ou centration autour de l’addiction semble rejoindre cette idée qu’il y aurait dans l’addiction quelque chose comme une « obsession » qui mènerait à la « compulsion ». Nous ne voulons pas dire que l’addiction appartient par-là au même genre que les troubles obsessionnels-compulsifs, même s’il serait intéressant de travailler sur le lien entre ces deux conditions. Nous voulons simplement dire que la perte de contrôle dans l’addiction pourrait être comprise comme le résultat d’une obsession, dans la mesure où l’addict ne peut cesser de penser à la même chose. Le sentiment de craving qui témoignait en faveur de la perte de contrôle de ses actes pourrait alors être compris comme le fait de céder à une action afin que nos pensées laissent enfin l’individu en paix. Ces pensées étant devenues obsédantes, elles empêchent l’individu d’entreprendre la réalisation d’autre chose. Nous ne pouvons ici que l’esquisser, mais Nordenfelt développe une idée de ce genre dans son ouvrage : Rationality and compulsion : il y a une maladie mentale comme une maladie physique, non en raison de dysfonctionnement des facultés de l’esprit, mais parce que certains états mentaux peuvent empêcher l’individu de réunir les conditions de son bonheur minimal. Au neuvième chapitre, Nordenfelt pose la question de savoir si les croyances obsessionnelles, dans les pensées délirantes et hallucinations, peuvent être dites compulsives ou non parce que ce sont des croyances que le sujet ne peut pas s’empêcher d’avoir même s’il le voudrait. De la même manière, il y aurait dans l’addiction quelque chose comme des volitions obsessionnelles vers une substance ou un comportement, qui seraient au départ voulues par le sujet, parce que cela remplit une fonction pour le sujet, de manière consciente ou non, mais qui ne quitteraient ensuite plus son esprit. Le craving pourrait ainsi être redéfini comme un désir obsédant et non irrésistible dans la mesure où l’individu ne serait pas obligé par une force impérieuse de le satisfaire, mais y serait obligé dans le sens où ce serait la seule façon d’avoir l’esprit libre pour un peu de temps. Dans ce cas, ce n’est plus une force extérieure à la volonté qui force l’agent à agir de manière compulsive, mais quelque chose qui fait intrinsèquement partie du processus de l’action à savoir l’idée ou la pensée, qui donne l’impulsion à l’action. L’addict agirait alors d’une certaine manière conformément à ce qu’il veut mais n’aurait pas la liberté de vouloir ce qu’il veut. Un travail ultérieur devra ainsi déterminer si cette façon de comprendre la perte de contrôle dans l’addiction, comme une perte de contrôle non sur les actes mais sur les pensées, est légitime et si on peut l’appliquer au phénomène addictif.
Conclusion
En définitive, les théories sceptiques de l’addiction ont, nous semble-t-il, le mérite de nous montrer qu’il faut remettre en question notre conception dominante de l’addiction comme maladie, caractérisée par l’idée de perte de contrôle sur les actes. Une analyse purement biologique de cette notion – ou psychologique, mais étayée par un substrat neuronal – ne permet pas selon nous de justifier la revendication selon laquelle l’addiction est une maladie, parce que certains arguments qui mettent en avant une capacité d’action, certes amoindrie, mais toujours présente, semblent remettre en cause l’idée d’une véritable perte de contrôle. Cependant, il faut bien voir que les rapports entre théorie de la maladie et théorie de l’action ont le plus souvent été pensés de manière antithétique, comme si l’une excluait l’autre et inversement. Une telle idée ne fonctionne pas avec l’addiction où une certaine perte de contrôle côtoie une forme d’intentionnalité de l’action. Peut-on penser la pathologie dans ce cadre-là ? C’est la perspective que nous suggérons, en lien avec l’idée que la pathologie serait celle de la volonté, plus impuissante face à des désirs pathologiques et extérieurs à elle, mais en lutte avec elle-même, parce que l’addict est celui qui est en proie à des idées qui peuvent bien être qualifiées de pathologiques, des obsessions qui mèneraient à la compulsion dans l’addiction parce que ce serait le seul moyen de pouvoir penser, pendant un peu de temps, à autre chose.
Bibliographie
Ascher, François. Le mangeur hypermoderne : Une figure de l’individu éclectique. Paris: Editions Odile Jacob, 2005.
Barberousse, Anouk, Denis Bonnay, and Mikael Cozic. Précis de philosophie des sciences. Paris: Vuibert, 2011.
Benn, Piers. “Disease, Addiction and the Freedom to Resist.” Philosophical Papers 36, no. 3 (November 1, 2007): 465–81.
Boorse, Christopher. “Health as a Theoretical Concept.” Philosophy of Science 44, no. 4 (1977): 542–73.
Brewer, Colin. “Addiction Myths?” The Lancet 362, no. 9391 (2003): 1240.
Carter, Adrian, and Wayne Hall. Addiction Neuroethics: The Promises and Perils of Neuroscience Research on Addiction. 1 edition. New York: Cambridge University Press, 2011.
Cohen, Peter. “Is the Addiction Doctor the Voodoo Priest of Western Man?” Addiction Research 8, no. 6 (2000): 589–98.
Darmon, Muriel. Devenir anorexique : Une approche sociologique. Paris: Editions La Découverte, 2003.
Davies, John Booth. Myth of Addiction: Second Edition. 2 edition. Amsterdam: Routledge, 1997.
Desforges, Frédérique. “Histoire et philosophie : une analyse de la notion de santé.” Histoire, économie et société 20, no. 3 (2001): 291–301.
Fingarette, Herbert. “Alcoholism: The Mythical Disease.” The Public Interest 91 (1988): 3–22.
Fingarette, Herbert. Heavy Drinking: The Myth of Alcoholism as a Disease. Berkeley: University of California Press, 1988.
Fitzpatrick, Mike. “Addiction Myths.” The Lancet 362, no. 9381 (August 2003): 412.
Foddy, Bennett. “Addiction and Its Sciences.” Addiction 106, no. 1 (2011): 25–31.
Foddy, Bennett, and Julian Savulescu. “A Liberal Account of Addiction.” Philosophy, Psychiatry, & Psychology 17, no. 1 (2010): 1–22.
Giroux, Élodie. Après Canguilhem. Définir La Santé et La Maladie. Philosophies. Paris: PUF, 2010.
Hammersley, Richard, and Marie Reid. “Why the Pervasive Addiction Myth Is Still Believed.” Addiction Research & Theory 10, no. 1 (January 1, 2002): 7–30.
Holden, Constance. “‘Behavioral’ Addictions: Do They Exist?.” Science 294, no. 5544 (2001): 980–82.
Leshner, A. I. “Addiction Is a Brain Disease, and It Matters.” Science (New York, N.Y.) 278, no. 5335 (1997): 45–47.
Levine, Harry G. “The Discovery of Addiction. Changing Conception of Habitual Drunkeness in America.” Journal of Studies on Alcohol, 1978, 493–506.
Netherland, Julie. Critical Perspectives on Addiction. Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited, 2012.
Noël, Xavier, and Antoine Bechara. “The Neurocognitive Mechanisms of Decision-Making, Impulse Control, and Loss of Willpower to Resist Drugs.” Psychiatry (Edgmont) 3, no. 5 (2006): 30–41.
Nordenfelt, Lennart. Action, Ability and Health - Essays in the Philosphy of Action and Welfare. 2000 edition. Dordrecht ; Boston: Springer, 2000.
Nordenfelt, Lennart. Rationality and Compulsion: Applying action theory to psychiatry. 1st ed. Oxford ; New York: OUP Oxford, 2007.
Nordenfelt, L. Y. On the Nature of Health: An Action-Theoretic Approach. Springer Science & Business Media, 1995.
Paubionsky, Peace. “Bad Habits or Diseases?” The Lancet 300, no. 7773 (August 1972): 375–76.
Pharo, Patrick. “Bien-être et dépendances.” Pensée plurielle 23, no. 1 (2010): 11–23.
“Prévention Des Maladies Psychiatriques: Pour En Finir Avec Le Retard Français.” Paris: Institut Montaigne, 2014.
Reinarman, Craig. “Addiction as Accomplishment: The Discursive Construction of Disease.” Addiction Research & Theory 13, no. 4 (2005): 307–20.
Room, Robin. “The Cultural Framing of Addiction.” Janus Head 6, no. 2 (n.d.): 221–34.
Schaler, Jeffrey A. Addiction Is a Choice. Chicago, Ill.: Open Court, 2000.
Szasz, Thomas S. “Bad Habits Are Not Diseases; a Refutation of the Claim That Alcoholism Is a Disease.” Lancet (London, England) 2, no. 7767 (1972): 83–84.
Szasz, Thomas S. “The Ethics of Addiction.” American Journal of Psychiatry 128, no. 5 (November 1, 1971): 541–46.
Szasz, Thomas S. The Myth of Mental Illness: Foundations of a Theory of Personal Conduct. Revised edition. New York: Harper Perennial, 2010.
Valleur, Marc. “L’addiction Au Jeu Est-Elle Une « Vraie» Maladie ?”. Vol. 65. Swaps, 2011.
Valleur, Marc. “La nature des addictions.” Psychotropes Vol. 15, no. 2 (2009): 21–44.
Vrecko, Scott. “Birth of a Brain Disease: Science, the State and Addiction Neuropolitics.” History of the Human Sciences 23, no. 4 (October 1, 2010): 52–67.
Wallace, Brendan. “Editorial Addiction.” Addiction Research and Theory 12, no. 3 (2004): 195–99.
Notes
[1] Cohen, Peter. “Is the Addiction Doctor the Voodoo Priest of Western Man?” Addiction Research 8, no. 6 (2000): 589–98.
[2] Schaler, Jeffrey A. Addiction Is a Choice. Chicago, Ill.: Open Court, 2000.
[3] Netherland, Julie. Critical Perspectives on Addiction. Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited, 2012.
[4] Szasz, Thomas S. “Bad Habits Are Not Diseases; a Refutation of the Claim That Alcoholism Is a Disease.” Lancet (London, England) 2, no. 7767 (1972): 83–84.
[5] Fingarette, Herbert. “Alcoholism: The Mythical Disease.” The Public Interest 91 (1988): 3–22.
[6] Szasz, Thomas S. “Bad Habits Are Not Diseases; a Refutation of the Claim That Alcoholism Is a Disease.” Lancet (London, England) 2, no. 7767 (1972): 83–84.
[7] Pharo, Patrick. “Bien-être et dépendances.” Pensée plurielle 23, no. 1 (2010): 11–23.


 DOAJ
Content
DOAJ
Content
newsletter subscription
www.analisiqualitativa.com